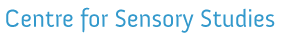Gabrielle Desgagné, Sherbrooke
TABLE DES MATIÈRES
Reconnaissance et Remerciements
Résumé et Préface
Liste des tableaux
I. Introduction
II. Revue de littérature
– Le patrimoine autochtone
– Pratiques muséales
– Institutions muséales autochtones
– Le patrimoine autochtone au Québec
– Relations entre Autochtones et Québécois-es
– Représentations autochtones
III. Question de recherche
IV. Problématique de recherche
– Survol de La Maison amérindienne
– Méthodologie
V. Analyse des résultats et discussion
1. Contexte et cadre théorique
1.1 Décolonisation des représentations
1.2 Théorie de l’encodage/décodage
1.3 Sociologie des émotions
2. Aspect géographique : lieux et territoires
2.1 Le territoire constitutif de l’identité
2.2 Lieu unique hors communauté
2.3 Lieu de bien-être
2.4 Lieu de rapprochement, de rayonnement
2.5 L’érablière en tant que patrimoine autochtone
3. Aspect organisationnel : le musée et ses publics
3.1 Naissance de l’organisme
3.2 Mission du musée
3.3 Fonctionnement interne
3.4 Savoir-faire de l’organisme
3.5 Relations publiques et diffusion
3.6 Adaptation et résilience des organisateurs
3.7 Souci de pérennité
4. Aspect interculturel : la rencontre au musée multi-nations
4.1 Le créneau multi-nations
4.2 Dialectique de « résistance/ouverture » sociale
4.3 Apprentissage, connaissance
4.4 Psychologie de l’apprentissage au musée
4.5 « Je me souviens » différemment : la rencontre
5. Aspect multisensoriel : l’expérience corporelle au musée
5.1 L’importance du sensorium en muséologie
5.2 La sensorialité est culturelle
5.3 Une expérience sensorielle complète
5.4 Émotions incarnées
6. Discussion : la rencontre sociale
6.1 Interprétation du sommaire des résultats
6.2 Le rôle des musées dans l’espace social
VI. Directions futures
Bibliographie
* This work is a revised version of the thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Arts (Sociology) in the Department of Sociology and Anthropology, Concordia University, Montreal in 2019. The supervisory committee consisted of Valerie de Courville Nicol (Principal Supervisor), Mark Watson, and David Howes.
RÉSUMÉ ET PRÉFACE
Cette recherche qualitative s’inscrit dans le contexte de « réconciliaction », de résurgence autochtone et de décolonisation des disciplines et des institutions québécoises, en appui à la continuité culturelle des Premières Nations, Métis et Inuits. Elle explore le contexte géographique, organisationnel, de rencontre interculturelle, et multisensoriel de mise en valeur patrimoniale au musée multi-nations La Maison amérindienne à Mont-Saint-Hilaire pour comprendre le phénomène général auprès de la société québécoise et son implication dans les relations sociales. Reposant sur les méthodologies autochtones, l’approche impliquait la collaboration avec l’équipe du musée – entrevues/discussions, bénévolat, droit de regard – et utilise la sociologie des émotions, les études sensorielles et l’anthropologie muséale. L’analyse montre un contexte généralement capacitant pour les parties impliquées (équipe, partenaires, visiteurs) et qui présente des défis singuliers, à travers l’expérience de rencontre vécue en tant que savoir corporel, facilitée par le musée dont la mission est d’être un lieu d’échange, de partage et de rapprochement entre peuples. Cette expérience peut se transposer dans le social, refermant le cercle en participant à une forme de solidarité sociale. Spécifiquement, le modèle multi-nations distinct, organisé par l’action commune d’Autochtones et de non-Autochtones, opère une mise en valeur significative malgré plusieurs obstacles systémiques sociaux. Sa position stratégique au cœur d’une érablière est essentielle à la mise en valeur de l’acériculture – qui, entre autres, influence fortement le patrimoine québécois – et de l’importance naturelle et territoriale chez les Premières Nations ; son approche explicitement multisensorielle, surtout gastronomique, permet la mise en valeur d’un ensemble de richesses culturelles pouvant être constatées corporellement dans les lieux.
RECONNAISSANCE ET REMERCIEMENTS
J’aimerais commencer par reconnaître que l’Université Concordia est située en territoire autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien’kehá :ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles ce projet est officialisé. Tiohtiá :ke/Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd’hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d’autres peuples, y résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l’avenir que je reconnais les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise[1].
J’aimerais remercier tous les membres de l’équipe de La Maison amérindienne sans qui ce projet n’aurait pu se concrétiser. Merci pour votre générosité de m’avoir ouvert la porte de la « Maison », notamment Chantal Millette et Audrey Renaud pour leur confiance à me partager leur perspective et me faire participer au travail du musée. Merci aussi à André Michel pour son long parcours qui témoigne d’actes de réparation.
Pour sa disponibilité et ses précieux conseils de réalignement en périodes de doute, un grand merci à Valérie de Courville Nicol qui m’a supervisée. J’aimerais également souligner l’apport et l’expertise des membres du comité de soutenance, Mark Watson et David Howes. Merci à mes enseignants, à la cohorte de sociologie 2016-2017, et aux membres du Centre for Sensory Studies pour tout leur approfondissement intellectuel partagé, et à tous ces gens socialement engagés qui ont présenté leur savoir lors de conférences, dans leurs écrits, expositions ou documentaires. Je tiens à mentionner le support financier reçu par la Faculty of Arts and Sciences de Concordia et par le Susan Russell Memorial Graduate Award, qui ont matérialisé l’encouragement à poursuivre ce projet. Sa publication est rendue possible grâce au soutien de l’équipe du musée ainsi que par ma participation à un projet dirigé par David Howes sur la régulation sensorielle, financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (no. 435-2015-1416).
Ce processus allant au-delà de la production d’un ouvrage de littérature universitaire m’a appris, en tant que sociologue « alliée », à accueillir l’incertitude et le travail émotionnel de l’auto-réflexion constante que demande l’engagement relationnel éthique en recherche en milieu autochtone. C’était aussi d’apprendre à délaisser les soucis reliés à « prendre les choses personnel », car je serais hors circuit par la somme de l’erreur humaine avant même d’avoir complété la revue de la littérature ! Ainsi, je remercie chaleureusement les membres de ma famille, mes parents Lucie et Tanguay, mon partenaire de vie Guillaume, et mes précieuses amies Rosie, Julie-Anne, Cynthia et Valérie pour leur encouragement constant à travers le cheminement de la maîtrise. Tant de gratitude va enfin à mon petit Zachary qui est arrivé au cours de cette aventure, apportant une joie contagieuse et un sens des priorités plus… sain.
LISTE DES TABLEAUX
Tableau I : Synthèse des aspects contextuels à la mise en valeur du patrimoine autochtone du musée
I. Introduction
Museums are a major factor in forming public perceptions of the nature, value, and contemporary vitality of Indigenous cultures.
Marie Battiste et James Youngblood Henderson
Dans le contexte actuel où le concept de décolonisation des pratiques institutionnelles est un impératif, et les rapports de nation à nation sont mis de l’avant sur la scène politique canadienne et québécoise, la résurgence autochtone est particulièrement vivante et vibrante. Je m’intéresse au phénomène de décolonisation des pratiques et à la rencontre interculturelle au musée, lieu désormais actif envers la continuité culturelle des Premières Nations, Métis et Inuits.
Les représentations et la mise en valeur contemporaines du patrimoine autochtone, idéalement et principalement prises en charge par les groupes autochtones concernés, sont nées d’un mouvement international de résurgence autochtone. Ce mouvement revendiquait des droits fondamentaux en tant que Premiers Peuples avec la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (Battiste & Henderson, 2000 ; Vernier, 2016). La Déclaration devenait alors un outil de décolonisation légalisant l’autodétermination des peuples autochtones opprimés par les états-nations. Le mouvement revendicateur a été particulièrement important dans les années 1960, qualifié de décolonisation tranquille par Bibaud (2015). Soutenu par le manifeste Custer Died for your Sins: An Indian Manifesto (1969) de l’académicien pionnier Vine Deloria Jr (Sioux Oglala), le mouvement est passé par les débats sur la propriété culturelle des Autochtones du Canada, des États-Unis, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande dans les années 1980. La Déclaration des Nations unies des Droits des Peuples autochtones voit le jour en 2007 sous la bannière de la retenue chez ces mêmes États-nations, et l’Assemblée des Premières Nations répond vivement la même année à la position réfractaire du Canada avec sa politique d’autogestion des données intitutlée Propriété, contrôle, accès et possession (PCAP) (Vernier, 2016, p. 4).
Battiste (Mi’kmaw) et Henderson (Chickasaw/Cheyenne) (2000) détaillent les défis contemporains de protection du patrimoine autochtone et des connaissances traditionnelles (Indigenous knowledge) qui alimentent ce patrimoine, défis réitérant l’actualité des politiques coloniales en Amérique du Nord (aussi Wiseman, 2001 ; Dubuc & Turgeon, 2004 ; Alfred & Corntassel, 2005 ; Coulthard, 2014 ; Simpson, 2014 ; Kovach, 2016). Battiste et Henderson proposent des réformes légales au Canada qui assureraient un futur viable pour tous les peuples en remettant en question les systèmes impérialistes prétendument universalistes et multiculturalistes. Pour Saul (2014), la résurgence autochtone (the comeback) passe aussi par la modification de la législation occidentale actuelle ainsi que le dépoussiérage d’une histoire nationale erronée dans les institutions de l’enseignement. Wiseman (Abénaki) (2001) et Simpson (Kanien’kehà :ka) (2014) identifient l’obstacle à la renaissance autochtone à surmonter au sein des communautés, à savoir la violence latérale ou l’oppression latérale surtout observée depuis les années 2000 (Wiseman, 2001, p. 190). Il s’agit de l’empêchement d’initiatives autochtones de la part d’autres Autochtones, notamment par un contrôle du membrariat d’une communauté donnée, pourtant initialement destiné à la continuité de cette dernière face aux diverses pressions sociolégales. En somme, ce contexte sociopolitique en est un, selon Alfred (Kanien’kehà :ka) et Corntassel (Cherokee), qui requiert de devoir coopérer individuellement et collectivement avec les autorités et structures étatiques afin d’assurer sa survie physique, soit l’ethnostress identifié par Agnes Williams (Seneca) (citée dans LaDuke, 1999) ; ils identifient la globalisation comme la nouvelle forme de colonialisme (aussi Battiste et Henderson, 2000 ; Adese, 2015).
Le musée entre alors en jeu : il est à la fois politique par ses affiliations institutionnelles et les contenus qu’il diffuse auprès de ses publics, et autonome face aux affaires politiques car répondant à ses propres impératifs de conservation, d’éducation à la citoyenneté, de gestion des collections, et de mise en valeur du patrimoine. Les Autochtones se réapproprient le musée et l’utilisent à des fins politiques ; en tant qu’institution relativement récente, le musée tribal est souvent vu comme un outil de décolonisation et de souveraineté culturelle (Cobb, 2005 ; Janin, 2005 ; Lonetree & Cobb, 2008). De plus, l’ère numérique participe de cette réappropriation en permettant à de nouvelles pratiques de conservation, de réseautage et de diffusion muséale d’émerger. J’explore donc la complexité du patrimoine autochtone au musée à travers sa mise en valeur auprès de la société québécoise avec le cas de La Maison amérindienne.
D’abord, le public québécois représente une société en complète refonte depuis la Révolution tranquille des années 1960, mettant de l’avant la préservation de la langue française et un modèle interculturaliste pour maintenir la continuité d’une minorité culturelle en Amérique du Nord (Bouchard, 2014). Le Québec suggère une situation de rencontre interculturelle singulière avec les Autochtones, partageant entre autres un certain vécu de la colonisation et un souci constant de préserver son héritage. Cette situation est complexifiée du fait que les ancêtres français des Québécois ont participé au projet impérialiste et colonial notamment avant la Conquête de 1760 et qui se poursuit sous certaines formes (on ne parle donc pas d’interculturalisme dans ce travail, mais de rapport de nation à nation), et du fait que l’héritage québécois comprend un patrimoine culturel et (moindrement) généalogique notable provenant des Premiers Peuples du nord-est du continent, ce qui est encore peu connu, reconnu et officialisé (Poliquin & Dubuc, 2015). Ensuite, ce musée multi-nations situé en territoire ancestral abénaki, à Mont-Saint-Hilaire, est un exemple de la valorisation du patrimoine autochtone couvrant et incluant le Québec. Utilisant son emplacement entouré d’une érablière pour notamment mettre de l’avant l’acériculture comme héritage des Premières Nations au Québec, cet organisme employant Autochtones et non-Autochtones a pour mission le partage, l’échange et le rapprochement des peuples en faisant mieux connaître les Premières Nations.
Précisément, j’explore la façon dont le patrimoine autochtone est mis en valeur par le musée auprès du public québécois à travers ses aspects géographique, institutionnel, multisensoriel et interculturel, tous interdépendants, pour comprendre l’application concrète de sa mission selon les membres de l’équipe ayant participé au projet. La théorie décoloniale et critique de la production du savoir de Margaret Kovach (Cree) (2016) et de Linda Tuhiway Smith (Maorie) (2012) est le fil conducteur de cette recherche qualitative. Les autrices situent cette production de savoir dans un vaste contexte historique, politique et culturel de colonialisme et de décolonisation. Elles mettent l’accent et laissent place à l’épistémologie autochtone plutôt qu’occidentale comme référent idéal pour appréhender la culture – donc le patrimoine autochtone. Cela semble plus approprié lorsque l’on constate l’héritage académique considérable ayant tronqué ou nui à l’intégrité des peuples « étudiés » : la recherche a souvent bénéficié uniquement aux chercheurs (Smith, 2012). Autrement dit, cette théorie rend légitime le savoir local et contextuel d’une réalité donnée pour en rendre compte de façon informée et relationnellement éthique.
Suite à une revue de littérature portant sur les thèmes du patrimoine autochtone en muséologie et des relations sociales entre Autochtones et Québécois, j’appuie donc mon analyse sur le point de vue décolonial de références autochtones dont Amanda Cobb (Chickasaw), spécialiste des questions de représentation et de production culturelle. J’appréhende également la complexité de l’expérience muséale avec la théorie sociale axée sur la sensorialité et la sociologie des émotions, notamment par la théorie d’in/capacité incorporée de Valérie de Courville Nicol (2011) et les discours de la société québécoise et de mise en valeur muséale à travers la théorie de la communication de Stuart Hall (1997). Je conclus ce mémoire par une discussion sur l’implication sociale de l’action muséale en général, et sur le modèle de mise en valeur unique que représente La Maison amérindienne au Québec et au Canada, qui suggère un contexte géographique, organisationnel, de rencontre interculturelle, et multisensoriel principalement capacitant pour les acteurs impliqués par les actions du musée.
Ce projet s’inscrit dans un contexte académique de décolonisation des disciplines et de mise en exergue de l’expérience corporelle vécue des individus et sociétés, laquelle a longtemps été théoriquement obscurcie au profit d’une rationalité dissociée du corps. En outre, Alfred et Corntassel (2005) appréhendent l’expérience individuelle et collective vécue des peuples autochtones comme l’une des meilleures pistes de régénération et de décolonisation (p. 601). Suivant ces tendances que je considère de circonstance dans le milieu académique, et puisque toute discussion sur les musées est politique de par la nature des ces institutions (Lonetree & Cobb, 2008), je me suis impliquée dans le milieu multisensoriel et tridimensionnel qu’est le musée en relation avec les membres de son équipe pour analyser la mise en valeur du patrimoine autochtone.
Le présent projet se situe dans la lignée d’une critique des représentations autochtones occidentales mais explore et laisse une plus grande place à la notion de mise en valeur patrimoniale, axée sur les relations sociales entre Autochtones et allochtones au Québec. Outre les travaux d’Élisabeth Kaine, Élise Dubuc et Marie-Pierre Bousquet, la littérature sur la muséologie autochtone au Québec est en amorce. Encore plus minime est celle sur la portée sociale de la mise en valeur muséale du patrimoine autochtone au Québec. Ce projet est donc à l’intersection de la sociologie culturelle mettant l’accent sur la signification culturelle, et la sociologie de la culture étudiant la production culturelle (Edles, 2002). J’analyserai le patrimoine autochtone comme signifiant et la structure du milieu culturel muséal qui reproduit ce patrimoine.
Outre le contexte décrit ci-haut, le choix de sujet d’enquête et la façon de l’appréhender découlent également de mon positionnement en tant que sociologue québécoise travaillant dans le milieu muséal et née au sein du grand territoire ancestral abénaki, dont l’héritage culturel et généalogique surtout canadien français et acadien est le résultat d’échanges interculturels. En effet, ce point de vue contextuel à l’objet de recherche suit la notion méthodologique de l’importance de se positionner de Kovach, qui implique que “self-location, purpose, and culture are the grounding for reflexive research processes” (citée dans Brown, 2012, p. 164). Enfin, ce choix découle d’écueils constatés de façon tantôt directe, tantôt diffuse à travers mes expériences de travail en milieu patrimonial, quant au discours historique linéaire et limité de plusieurs milieux muséaux et éducatifs au Québec, qui gagnent à pleinement reconnaître et honorer les Premiers Peuples dans le présent, et pour le futur.
II. Revue de littérature
Le patrimoine autochtone
La littérature d’anthropologie muséale, de muséologie et de droit fait référence au concept de patrimoine autochtone (Indigenous/Aboriginal heritage), qui répond aussi aux appellations « héritage culturel autochtone », « héritage indigène », ou « héritage autochtone ». Cela consiste en la culture matérielle autochtone incluant histoire, récits, langues, chants et valeurs spirituelles ainsi qu’en la mémoire collective (Canadian Conservation Institute [CCI], 2008). La définition cocréée par des groupes autochtones et les Nations unies en 1995 a pour prémisse que l’héritage est le savoir traditionnel (Indigenous knowledge) et que “[It] compris[es] of all objects, sites and knowledge the nature of which has been transmitted from generation to generation, and which is regarded as pertaining to a particular people or its territory” (Battiste & Henderson, 2000, p. 65-66). Ce patrimoine inclut les œuvres artistiques et les futurs travaux de nature patrimoniale. Il est la propriété traditionnelle de soit tout un peuple, d’une famille ou d’un clan, d’une association, ou encore des individus qui en ont été désignés les gardiens (Battiste & Henderson, 2000 ; Bell, Lai & Skorodenski, 2014). Cette propriété traditionnelle répond au nom de « droit coutumier » (Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador [APNQL], 2014, p. 13).
Puisque fusionné au savoir traditionnel, le patrimoine autochtone dépasse la notion occidentale courante de cultures comme entités statiques (Battiste & Henderson, 2000). Il est régi, tout comme la conscience autochtone, par les forces écologiques et leurs diverses formes interreliées (p. 9), tandis que la littérature muséale classifie souvent ce patrimoine de matériel ou d’immatériel selon un paradigme humanocentriste. Cette scission complique les notions de propriété intellectuelle (Bell, Lai & Skorodenski, 2014) et est même qualifiée de fausse dichotomie, le matériel et l’immatériel étant en fait indissociables selon le muséologue André Bergeron (2010).
Le patrimoine autochtone est relié de près mais n’est pas un substitut aux revendications territoriales, légales et de rapatriement (Clifford, 2004, p. 8). Le rapatriement de ce patrimoine est un élément clé de sa réappropriation et de sa protection (Battiste & Henderson, 2000), ainsi que de la guérison de l’oppression pluricentenaire des Premiers Peuples (Wiseman, 2001 ; Council for Museum Anthropology [CMA], 2017). Mélissa Vernier (2016) voit de façon similaire le rapatriement comme possibilité pour les communautés de maintenir et d’entreprendre leurs propres projets culturels.
Pratiques muséales
Les pratiques muséales de mise en valeur du patrimoine autochtone suivent la volonté d’affirmation identitaire, de préservation et de continuité culturelle, et d’actualisation face à des structures étatiques exerçant des pressions diverses. Là où le paradigme occidental était de conserver par divers moyens – dont le pillage – le patrimoine de peuples perçus comme en disparition au tournant du XXe siècle (salvage anthropology), les institutions de la mémoire ont reconnu participer à l’héritage colonial avant le changement majeur dans les relations entre peuples autochtones et musées dans les années 1970 (Lonetree & Cobb, 2008 ; Vernier, 2016) ainsi que le mouvement de rapatriement des années 1980 et 1990 (Cobb, 2005). Cobb qualifie l’institution muséale d’“institutional tool of culture”, voire de quatrième force majeure de colonisation après les armes, Dieu et les gouvernements, mais affirme que cette institution a été réappropriée par les peuples autochtones en tant qu’instrument de continuité culturelle et d’auto-définition (p. 486). Classen et Howes (2006) explorent également ces relations, cette fois sous l’angle de la sensorialité comme pratique sociale, suivant une hégémonie visuelle limitative au musée qui perdure encore. Les auteurs attribuent cette pratique au paradigme colonial occidental du milieu du XIXe siècle selon lequel les autres sens relevaient du barbarisme.
L’heure est à présent à la remise en question des pratiques muséales occidentales et à un standard de collaboration entre musées et communautés pour tout projet ou initiative impliquant le patrimoine des nations concernées (Task Force et al., 1992 ; Bousquet, 1996 ; Ames, 1992, 2000 ; Dubuc & Turgeon, 2004 ; Vernier, 2016). La muséographie standard de mise en espace du patrimoine autochtone suivant un modèle 1) géographique à visiter, 2) historique évolutionniste, 3) d’habitat avec diorama, ou 4) exposant tout (all-over), sont comprises comme de loin incomplètes et blessantes car « figeant », « fixant » les peuples dans le passé (Cobb, 2005, p. 495).
Amy Lonetree (Ho-Chunk) (2012) souligne également la tendance à la décolonisation des musées et à la critique des pratiques néocoloniales qui peuvent en émerger (aussi CMA, 2017). Ressortent également une stratégie d’autonomisation quant à la propriété culturelle (Vernier, 2016) ; la création et le financement d’institutions muséales autochtones, le contrôle partagé et idéalement cédé de l’information, des collections et des efforts de recherche touchant le patrimoine autochtone (Task Force et al., 1992 ; Clifford, 2004) ; puis enfin le rapatriement d’objets et de restes humains aux communautés concernées, légalisé notamment aux États-Unis avec le Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA) de 1990 (Task Force et al., 1992 ; Battiste & Henderson, 2000 ; Dubuc & Turgeon, 2004). Sont aussi mises de l’avant l’importance de considérer la multisensorialité dans l’élaboration d’expositions liées au patrimoine autochtone (Blanchard & Howes, 2014) et l’approche de la plurivocalité qui permet de laisser place à diverses voix autochtones (Soulier, 2015). Enfin, la nécessité de contextualiser l’acquisition et la signification des artefacts des collections muséales (Classen & Howes, 2006) était aussi proposée par Jacques Mathieu (1987) pour enrichir l’interprétation et éviter les possibles déformations.
Dubuc (2006) nuance que tout ce changement des mentalités et des pratiques a eu lieu grâce à des pressions autochtones externes au milieu muséal, le caractère conservateur des musées en soi alimentant une force d’inertie. S’appuyant sur les travaux de Gerald Conaty du Glenbow Museum, Dubuc et Turgeon (2004) rappellent aussi les limites du rapatriement contemporain dans un cadre juridique occidental strict et strictement axé sur l’écrit, impliquant la négociation individuelle nécessaire avec chaque institution muséale pour pouvoir effectuer un rapatriement au Canada. Vernier (2016) analyse aussi le contexte de collaboration et de décolonisation entourant le mouvement de réappropriation du patrimoine autochtone, mené conjointement par les Autochtones et les institutions de la mémoire. Tout comme Bell, Lai et Skorodenski (2014), elle souligne les défis des nouvelles pratiques, notamment en ce qui touche la propriété intellectuelle : celle-ci est en effet collective et non individuelle en contexte autochtone et diffère du paradigme occidental axé sur le domaine public. Vernier émet des recommandations telles que le rapatriement numérique et la préservation du patrimoine numérique de la jeunesse autochtone. Pour les communautés autochtones, le mouvement patrimonial sous la bannière de la collaboration participe d’une réappropriation de leur patrimoine (Clavir, 2002 ; Vernier, 2016), d’un contrôle sur celui-ci (Battiste & Henderson, 2000 ; Clifford, 2004), et essentiellement d’un processus de guérison et de continuité identitaire (Wiseman, 2001 ; Bell, Lai & Skorodenski, 2014).
Il y aurait un contexte muséal également caractérisé par des tensions et désaccords quant à la mise en exposition du patrimoine autochtone, et même un débat entre institutions qui collaborent ou non avec les communautés selon Soulier (2015), plusieurs étant peu au fait des réalités, savoirs et devoirs entourant le patrimoine autochtone ou encore se justifiant en se dissociant du régime colonial, envisagé comme une chose du passé (Clavir, 2002). L’analyse de Cobb (2005) souligne que certains acteurs, visiteurs et critiques non autochtones jugent les musées tribaux en assumant qu’un musée signifie nécessairement exposition, laquelle devrait suivre les standards scientifiques occidentaux, niant ainsi le but que sert le musée tribal, et les savoirs qui sous-tendent son action (p. 502-505). La nature de la relation entre musées et communautés est théorisée comme étant d’abord éthique – le musée étant intrinsèquement un amalgame de relations entre visiteurs, objets, équipes de travail, etc. – et l’anthropologie muséale se veut précisément un moyen de concilier ces relations à condition d’y mettre encore beaucoup de travail (CMA, 2017). Clavir (2002) et Cobb (2005) explicitent la relation trouble entre Premiers Peuples et musées de sorte que ces institutions sont emplies de savoir, d’expertise et de soin envers le patrimoine, mais elles orientent souvent des pratiques relevant d’épistémologies occidentales ayant significativement objectifié et exploité les Premiers Peuples dans leur application. Les frustrations du personnel des musées de n’en faire jamais assez et les frustrations des communautés de ne pas constater suffisamment de progrès étaient une réalité selon Clavir (2002). Ames (2000) réclamait un effort soutenu et redoublé de la part des musées de collaborer, d’employer et de contacter les Autochtones, ainsi que de laisser aux conservateurs autochtones davantage d’opportunités de rétablir un équilibre relationnel face à un rapport d’emblée inégal ; il diagnostiquait que le mandat du musée, ses publics, ses horaires, et l’intérêt des conservateurs ont généralement préséance.
La majorité de la littérature témoigne du potentiel du rôle du musée, qu’il soit tribal ou non autochtone, comme lieu de cohésion sociale malgré les différends politiques (Bousquet, 1996 ; Clavir, 2002 ; Cobb, 2005 ; Dubuc, 2006 ; Lonetree & Cobb, 2008 ; CMA, 2017), et comme porteur d’un même souci de préservation et de soin envers le patrimoine (Clavir, 2002 ; Cobb, 2005). Importante référence en muséologie, Jean Davallon (1986) décrivait en outre l’expérience du visiteur en exposition comme un dépaysement actif et ludique qui permet d’aller à la rencontre de ce qui nous est étranger : « L’exposition me propose un mode de rencontre et d’interprétation » (p. 260). Le musée devient aussi un symbole de contrôle sur la façon d’interpréter et de mettre en valeur sa culture (Bousquet, 1996 ; Cobb, 2005 ; Lonetree & Cobb, 2008 ; Bibaud, 2015), un outil de décolonisation (Dubuc & Turgeon, 2004 ; Bibaud, 2015) et de souveraineté culturelle (Cobb, 2005 ; Lonetree & Cobb, 2008), voire de contestation de la législation sur la propriété intellectuelle (Bell, Lai & Skorodenski, 2014). Pour Vernier (2016), le musée peut mettre son expertise de sensibilisation du public au service des communautés. Clifford (1997 ; 2004) apporte sa perspective de chercheur américain en immersion dans les réalités et institutions autochtones : il met de l’avant les erreurs du passé des anthropologues, archéologues et linguistes ayant étudié les peuples autochtones sous une lunette déformante, hiérarchique et linéaire, tout en observant que cet héritage présente autant de difficultés que d’opportunités à l’heure actuelle pour le travail patrimonial (heritage work). Son constat envers le potentiel de collaboration entre Autochtones et non-Autochtones du milieu académique porte la condition incontournable de reposer sur la réciprocité, le respect ainsi que le partage des ressources, des décisions et de l’autorité (2004).
Institutions muséales autochtones
Un mouvement de création de musées tribaux (tribal museums) apparaît surtout dans les années 1960 et 1970 à l’échelle des Amériques. En tant que sites plutôt récents, les musées tribaux sont aussi de nouveaux sites de performance et de consommation selon Clifford (2004). Leurs précurseurs sont le Osage Tribal Museum, plus ancien musée tribal des États-Unis (1938), ayant participé à l’émergence d’un modèle muséal autochtone selon Majel Boxer (Dakota) (2016), ainsi que le Musée des Cheyennes aux États-Unis (1948), né de l’importance de conserver et de faire connaître le patrimoine autochtone au plus grand nombre (Janin, 2005). Boxer détaille la réalisation de l’Osage Tribal Museum ayant découlé en grande partie de la position d’influence, du bilinguisme et de l’intérêt marqué de préservation culturelle de son fondateur, l’historien Osage John Joseph Mathews, et des efforts conjoints de la communauté. Faisant écho à la situation de plusieurs musées tribaux contemporains, la création de l’Osage s’inscrivait dans un contexte de revitalisation et de réorganisation tribale, ainsi que sous l’ombre de l’approche paternaliste du Bureau of Indian Affairs qui assurait un financement dans le cadre de l’Indian New Deal favorisant une relative souveraineté tribale (Boxer, 2016).
En 2004, le National Museum of the American Indian (NMAI) à Washington, DC, premier en son genre, ouvre ses portes en tant que plateforme identitaire pour les peuples autochtones à travers les Amériques en même temps qu’institution américaine nationale (Lonetree & Cobb, 2008). Initié depuis 1989 sous la loi publique 105-189 du Congrès des États-Unis, cette entité faisant partie du Smithsonian offre un modèle muséal tribal pour de nombreuses institutions en ce qu’il a été conçu, conserve ses collections et déploie sa programmation entièrement selon des épistémologies autochtones et le principe de collaboration avec les communautés. Cela demande du même coup à ses visiteurs un engagement critique, une lecture dialogique, alternative à ce que devraient être et faire les musées, précisément à travers l’exercice politique de souveraineté culturelle qu’est le musée (Cobb, 2005). Son guide de consultation initial, né des visites chez de nombreuses communautés aux Amériques, The Way of the People, continue d’informer la pratique future du musée (p. 490), et ce sont plutôt les disciplines scientifiques qui sont incorporées au savoir autochtone dans l’action interdisciplinaire du musée.
Les musées autochtones se distinguent par leur gestion assurée par des Autochtones et sont des musées d’identité qui travaillent à revaloriser cette dernière via les points positifs des cultures concernées (Bousquet, 1996). Boxer (2016) définit plutôt le musée autochtone comme lieu de résistance face à l’hégémonie occidentale et comme véhicule des perspectives autochtones ; comme lieu de résistance face à la globalisation de la culture par Janin (2005) ; et comme un hybride entre l’écomusée et le musée communautaire, qui comble les manques de transmission traditionnelle et intergénérationnelle pour Franco (2012). Clifford (2004) identifie le dénominateur commun de ce type de musée de s’adresser à divers publics géographiques à la fois – local, régional, étatique, international. Dubuc et Turgeon (2004) nuancent la présence multiple de pensées muséales tribales non monolithiques, selon les particularités propres à chaque nation et aux situations sociopolitiques qui lui sont liées.
Les pratiques muséales autochtones sont qualifiées de radicalement différentes de celles de la muséologie traditionnelle par Ames (2000) et Dubuc et Turgeon (2004), par exemple avec l’accent sur le récit et l’engagement très actif du visiteur pour apprendre (Lonetree et Cobb, 2008), apprentissage qui ne passe pas nécessairement par la leçon et le révisionnisme mais par l’autoportrait (Cobb, 2005). Il y a souvent une narration à la première personne ; des prestations en direct ; un accent sur l’interaction et la performance (Clifford, 2004) ; des valeurs pour la conservation des collections différentes (Clavir, 2002 ; Kreps, 2003 ; Bell, Lai & Skorodenski, 2014) ; un rapport aux objets axé sur le sens plutôt que l’esthétique (Clavir, 2002 ; Howes, 2003 ; Kaine, 2004 ; Cobb, 2005 ; Bergeron, 2010) et sur la notion animiste plutôt qu’inanimée des objets matériels ; une représentation se distanciant du romantisme et de la sentimentalisation ; et une sympathie, propre à chaque nation, pour la conservation de la propriété culturelle, présente dans l’argumentaire de Cobb (2005) ou encore dans le récit d’implantation de l’Osage Tribal Museum (Boxer, 2016). Ces approches modifient les pratiques muséales conventionnelles aux Amériques et dans tout pays où les peuples autochtones les ont contestées (Kreps, 2003 ; Dubuc & Turgeon, 2004 ; Dubuc, 2006), pratiques américaines qui, elles-mêmes, diffèrent des pratiques muséales européennes (Dubuc & Turgeon, 2004 ; Bergeron, 2010).
Lonetree et Cobb (2008) et Clifford (1997) observaient déjà le rapport différent entre muséologie autochtone et muséologie traditionnelle face à l’importance du lieu où se trouve le musée. Peers (2000) critiquait en effet ce qu’implique la distance physique et politique des musées européens représentant les peuples autochtones, soit l’absence d’une voix critique du colonialisme comparativement aux musées nord-américains, et l’application de standards muséographiques locaux représentant peu adéquatement la réalité autochtone. Peers prenait pour exemple le système d’identification des étiquettes inexistant à la Chase Manhattan Gallery du British Museum, de façon qu’une robe Béothuk exposée seule propose à prime abord un angle d’interprétation simplifié d’une robe autochtone quelconque. Dans les faits, l’histoire derrière cette robe faite de morceaux épars de peaux témoigne à elle seule le drame du peuple Béothuk éteint par les Anglais et les Portugais, mais rien de cela ni des réflexions qui en découlent n’apparaît au visiteur de la galerie, néophyte ou non (p. 11).
Vernier (2016) et Dubuc et Turgeon (2004) soulignent aussi l’importance de préserver le patrimoine dans son lieu d’origine et de situer la pratique muséale autochtone dans son contexte sociopolitique. Les musées ou les centres culturels autochtones ne sont non pas axés sur le passé mais sont des « “lieux de vie” et des espaces de création et de valorisation identitaire » (Dubuc & Turgeon, 2004, p. 15), où le passé sert les communautés dans le présent pour leur assurer un futur, selon un « mandat présentiste » au sens de Vernier (2016, p. 14). Pour Élisabeth Kaine (Wendat) (2004), les musées ont un rôle de transmission vivante et ne devraient justement pas être conservateurs dans leur rôle de conservation. Ils sont « au service de la collectivité » (Dubuc et Turgeon, 2004, p. 16). À titre d’exemple, Wiseman (2001) dirige l’Abenaki Tribal Museum au Vermont qui participe spécifiquement à la reconnaissance fédérale des Abénakis aux États-Unis. Cette procédure légale impose la preuve d’une continuité politique, culturelle, généalogique et de localisation (Obomsawin, 2006), et la mission du musée va en ce sens tout en promouvant la continuité et la souveraineté culturelle abénakise (Wiseman, 2001, p. 190).
Spécialiste de la question de la diffusion et la mise en valeur de la culture matérielle des sociétés autochtones traditionnelles et actuelles, Kaine (2004) voit la pédagogie, la diffusion par le biais des expositions et la création design (conception d’objets) comme vecteurs de la valorisation identitaire autochtone, tout en arrimant cette pédagogie du design à ses propres origines métisses. Clavir (2002) a mis de l’avant la perspective autochtone de la valorisation d’objets de musée qui repose sur leur « intégrité conceptuelle » provenant des réalités vécues rattachées à ces objets (p. xvii). Leur préservation est positive dans un contexte d’autodétermination, non pas dans tout contexte au sens de la muséologie traditionnelle. L’accès aux objets peut être restreint notamment lorsqu’ils sont sacrés, et leur préservation peut être remise en question surtout lorsqu’ils sont préservés dans une institution non autochtone, par exemple si les objets sont inutilisés ou inaccessibles dans le contexte culturel approprié.
Appliquées aux priorités des communautés autochtones, les technologies numériques sont porteuses d’un potentiel de transmission de savoirs-faire de diverses cultures, permettant identification et comparaison chez les participants qui les utilisent (Kaine, 2004) ; de partage de données entre institutions muséales, chercheurs et communautés (Dubuc & Turgeon, 2004) ; et dans certains cas d’avoir un rôle de renfort ou de complément aux cultures et communautés, permettant un moyen pour les Autochtones de se projeter dans le futur selon Skawennati (Kanien’kehà :ka) et Jason Edward Lewis (Cherokee/native Hawaiian/Samoan) (2017).
Les thèmes mis de l’avant dans plusieurs musées autochtones au Québec sont la spiritualité et la lutte contre les stéréotypes (Bousquet, 1996). Toutefois, les musées autochtones ont tendance à passer sous silence le contexte colonial et peuvent être critiqués pour cette neutralité face à leur mission éducative (Bousquet 1996 ; Lonetree & Cobb, 2008). De même, Franco (2012) analyse le rôle du Musée des Abénakis d’Odanak – premier musée autochtone au Québec – auprès de la communauté et explique les enjeux auxquels l’institution a fait face en voulant se professionnaliser (design, mise en exposition, etc.). L’institution se faisait reprocher d’être soumise au tourisme et d’invisibiliser les paniers tressés, hautement significatifs dans la culture abénakise, qui étaient jusqu’alors presque tous exposés. Franco recommande au Musée de conserver davantage le patrimoine immatériel de la communauté. Au même moment, l’exposition a l’impératif de toujours prendre en compte ses publics (Davallon, 1986) et le National Museum of the American Indian ne diffère pas des musées occidentaux sur ce point, cherchant à plaire aux visiteurs qui sont de plus en plus à la recherche d’une expérience d’apprentissage (Lonetree & Cobb, 2008). Le Centre culturel de Kahnawake, près de Montréal, contrôle quant à lui l’accès à ses espaces et dédie ses contenus principalement aux Haudenoshaunee (Bousquet, 1996).
Dubuc (2006) et Kaine et Dubuc (2010) résument le chemin qu’il reste à parcourir pour la muséologie autochtone : il est nécessaire d’adapter les pratiques à l’autorité autochtone, de fournir davantage de ressources notamment en formation et en financement, et d’adopter une position plus réaliste quant aux attentes des publics envers les musées tribaux. D’autre part, la mise en valeur est souvent celle du patrimoine matériel flamboyant de la côte Ouest, un certain isolement en résultant pour les peuples historiquement nomades dont le patrimoine est principalement immatériel, notamment ceux de l’est du continent (Dubuc, 2006, p. 31).
Le patrimoine autochtone au Québec
Au Québec, Bousquet (1996) situe l’émergence du musée autochtone surtout vers la fin des années 1970, grâce aux centres culturels situés dans les communautés, eux-mêmes apparentés aux musées autochtones. Outre l’isolement patrimonial décrit par Dubuc (2006), Gélinas (2007) explique le manque de grilles d’interprétation du patrimoine et de l’histoire autochtones jusqu’à récemment du fait que la discipline archéologique au Québec s’est professionalisée à partir des années 1970, et que les cours d’anthropologie tardaient à être dispensés dans les institutions du savoir.
L’événement clé quant aux changements des pratiques propres au patrimoine autochtone dans les musées du Québec et du Canada, mentionné par la plupart des sources (Task Force et al., 1992 ; Ames, 2000 ; Bell & Napoleon, 2008 ; Dubuc & Turgeon, 2004 ; Soulier, 2015 ; Adese, 2015 ; Vernier, 2016 ; CMA, 2017), est le boycott de l’exposition du Glenbow Museum The Spirit Sings: Artistic Traditions of Canada’s First Peoples, initialement intitulée Forget Not My World : Exploring the Canadian Native Heritage tel que souligné par Adese (Otipemisiw Metis) (2015, p. 137). Ce boycott a été mené par les Cris de Lubicon Lake en Alberta, qui dénonçaient l’exposition centrée sur un passé pré-contact, non représentative de leur présence et leurs voix contemporaines, de surcroît financée par Shell Canada qui dépossédait leur territoire traditionnel au même moment et ce, depuis les années 1950. Les Cris critiquaient l’acte politique contradictoire d’un message honorant les peuples autochtones dans le cadre des Jeux Olympiques à Calgary en 1988, tout en acceptant le financement de Shell. Cette occasion de faire entendre leur voix à l’échelle internationale, conjointement au support d’artistes et étudiants autochtones locaux (Adese, 2015, p. 137-140) a mené à la mise en place, la même année, d’un colloque convoqué par le chef Georges Erasmus à l’endroit de George MacDonald, alors directeur du Musée des Civilisations (aujourd’hui Musée Canadien de l’Histoire à Hull, QC). La conférence Préserver notre héritage en est née, menée par l’Assemblée des Premières Nations et l’Association des Musées Canadiens, dont faisait partie l’organisme phare de la muséologie au Québec, la Société des musées québécois (SMQ) (Task Force et al., 1992).
Le rapport charnière qui donne encore le ton aux pratiques muséales contemporaines sera issu de cette suite d’événements : il s’agit du Rapport de travail (Tourner la page/Turning the page: Task Force Report on Museums and First Peoples). Il met de l’avant des recommandations de partenariat qui visent la reconnaissance de l’importance fondamentale des objets culturels des musées ; l’implication accrue des Premiers Peuples dans l’interprétation historique et culturelle du patrimoine ; l’accès amélioré aux collections de musée pour ceux-ci ; le rapatriement national et international ; la formation du personnel autochtone et non-autochtone ; le soutien aux institutions culturelles autochtones et un appui financier urgent (Task Force et al., 1992, p. 5-8).
Certains auteurs soulignent les résultats modérés du Rapport de travail (Ames, 2000 ; Bolton, 2004) et les rapports entretenant directement le colonialisme dans les musées traditionnels (Desmarais-Tremblay, 2016). Bolton (2004) nuance qu’avant le Rapport, la représentation autochtone au Canada n’était pas une priorité et était à peine reconnue ; elle observe le cas du Musée McCord à Montréal qui s’affiche national, et conclut que la participation autochtone aux projets est bel et bien réussie, qu’il y a davantage de conscience face au patrimoine autochtone au musée, mais qu’il demeure du travail à faire pour que des Autochtones siègent au Conseil d’administration et fassent partie du personnel du musée, ainsi que pour créer des affiliations entre musées, communautés et universités.
En tant qu’institution phare dans la province ayant un impact sur les institutions culturelles québécoises, le Musée de la Civilisation à Québec (MCQ) créé en 1988 devançait en quelque sorte les recommandations du Rapport notamment à travers le travail d’Henri Dorion à orienter l’action du musée selon les notions de « mise en commun, respect et partenariat » (Bousquet, 1996, p. 522-523). Desmarais-Tremblay (2016) remet en question ses pratiques actuelles avec une approche critique anticolonialiste des rapports de force nécessairement impliqués par les structures muséales euro-américaines. L’exposition phare permanente faisant la fierté du MCQ, C’est notre histoire (2013-…), a rassemblé le travail de quelque 800 personnes : Premières Nations, Inuits, Métis, et personnel du musée et de l’organisme autochtone la Boîte Rouge Vif. Son principal chargé de projet, Yves Sioui Durand (Wendat), met de l’avant l’objectif de l’exposition d’imprégner les visiteurs de la résilience et des destins des Autochtones dans le présent (MCQ, 2013, panneau d’entrée et sortie).
Battiste et Henderson (2000) mentionnent plutôt qu’un point tournant dans le milieu muséal à l’échelle nationale est le rapatriement du Starlight Bundle au peuple Tsuu T’ina (Sarcee) en 1986, selon l’initiative du Musée de la Civilisation et conformément à l’Éthique Professionnelle du milieu. John Moses (Six Nations Delaware) (CMA, 2017) détaillait l’héritage de conservation du patrimoine autochtone grâce au pavillon autochtone de l’exposition universelle de 1967 à Montréal. Celui-ci rejoignait des millions de visiteurs venus de partout dans le monde, et exprimait le souci des Autochtones de raconter leur propre histoire en mettant de l’avant les thèmes du travail, du gouvernement, du futur et de l’homme blanc. La Société pour l’éducation et la muséologie en milieu autochtone (SEMMA), créée vers la fin des années 1980, a également joué un rôle dans le milieu du patrimoine autochtone au Québec selon Bibaud (2015). La Commission royale sur les peuples autochtones (1991-1996), qui établissait la nécessité d’un changement radical dans les relations entre Autochtones et non-Autochtones à l’échelle nationale, a aussi eu un impact sur les représentations muséales (Bolton, 2004). Plus récemment, la Déclaration des Nations unies (Organisation des Nations unies, 2007) et la politique PCAP de 2007, et notamment la Commission de vérité et réconciliation (2015) orientent et diagnostiquent la révision des pratiques muséales et archivistiques québécoises. La Commission de 2015 émet des recommandations au niveau de l’accessibilité publique aux fonds et ressources traitant des pensionnats, et du financement d’un examen national sur les relations entre institutions de la mémoire et communautés (Vernier, 2016, p. 6). Cet examen national est mené par le Conseil de la réconciliation de l’AMC, lancé en 2018 en réponse directe à l’appel à action no. 67 (AMC, s.d.).
Relations entre Autochtones et Québécois-es
Gervais, Beaulieu et Papillon (2013) font un tour d’horizon des rencontres historiques, culturelles et économiques entre Autochtones et Québécois-es, réitérant la nécessité d’une relation de nation à nation dans un contexte colonial toujours existant, ayant des lacunes juridiques et propageant une vision encore folklorique des Premiers Peuples. Ils statuent qu’il y aurait un potentiel de changement relationnel dans la signature de traités et la notion de réciprocité. En effet, outre les échanges et traités ancrés dans les rapports entre Autochtones et Canadiens français depuis le XVIᵉ siècle, qui ont historiquement requis que ces derniers s’adaptent au mode de vie, à la diplomatie et à la réciprocité autochtones surtout avant la Conquête pour survivre (Saul, 2014 ; Poliquin et Dubuc, 2015), Gélinas (2007) expose aussi un portrait exhaustif du rôle qu’ont joué les Premières Nations au sein de la société nationale québécoise pendant la période post-confédérale. Il souligne leur participation constante à l’économie canadienne française en dressant un portrait des faits de la cohabitation qui tendent plutôt à rapprocher les deux entités : il s’agit d’un « métissage social et culturel à grande échelle » (p. 12). Gélinas mentionne l’inadéquation entre une Loi sur les Indiens de 1876 élaborée en lien avec l’expansion de l’Ouest canadien et la réalité autochtone au Québec, ayant brouillé les faits du métissage et des traits communs. En outre, Gélinas souligne que dans un tel contexte post-confédéral d’affirmation et de maintien identitaire pour la société québécoise, l’attention était peu orientée envers les questions autochtones.
Sylvie Vincent (1995) retraçait la confrontation entre les peuples dans leur volonté de s’affirmer et d’être reconnus comme peuples distincts face au Canada, tout comme Bousquet (1996) le proposait. Bouchard (2014) nuance l’action discriminatoire et d’injustice sociale au Québec, non moins existante mais plus réduite par rapport à la plupart des sociétés occidentales en raison de ce que ce peuple a lui-même dû résister à l’assimilation pendant plus d’un siècle, entre 1840 et 1960 (p. 171-172). La confrontation entre Autochtones et Québécois a très souvent trait à la gestion des ressources et des droits territoriaux. Selon Vincent (1995) et Michaud-Ouellet (2014), les Québécois doivent se positionner clairement quant aux droits autochtones territoriaux via leur système politique et législatif pour atteindre une relation plus solide, comme en témoigne l’expérience de la Commission royale sur les peuples autochtones.
Pour beaucoup d’Autochtones, c’est du ressentiment et de la méfiance à l’endroit des « Blancs » et leur legs colonial, et la décision de mettre de l’énergie au service de leurs communautés avant tout ; une aînée innue d’Uashat, Évelyne Saint-Onge, dit : « Le fait d’être déracinée, je vais en vouloir toute ma vie, les gestes que je vais faire vont être en fonction de sauver ce qui reste » (citée dans Carrier et Higgins, 2014, 34:27). Simpson (2014) aborde avec le cas de la communauté mohawk de Kahnawake la dynamique des politiques très précises de membrariat et d’appartenance aux communautés, élaborées selon un souci de protection identitaire, et critiquées de part et d’autre pour leur dynamique d’exclusion qui dérive pourtant de la législation fédérale définissant le statut d’ « Indien » selon des référents occidentaux. La question du statut du Québec en tant que minorité nationale est également sujet à débat parmi les communautés tandis qu’il est une réalité du vécu québécois contemporain selon Bouchard (2014, p. 16). Les débats entourant l’appropriation culturelle, reliée de près à la politique identitaire (identity politics), sont également présents dans le chapitre relationnel Autochtones-Québécois, dont l’épisode controversé entourant la diffusion de l’œuvre théâtrale Kanata de Robert Lepage, critiquée pour son manque de collaboration avec des artistes autochtones, limité à la consultation (Bardou, 2019). Il n’en demeure pas moins, pour Dubuc et Turgeon (2004), que le contexte nord-américain en est un où il existe la volonté de part et d’autre de « renégocier le lien colonial » (p. 11).
Des documentaires québécois tels que Rencontre (Carrier & Higgins, 2011), Québékoisie (Carrier & Higgins, 2014) et L’Empreinte (Poliquin & Dubuc, 2015) dénotent une volonté de rapprochement et de reconnaissance de points communs sur les plans culturel et (moindrement) généalogique de la part des Québécois, mettant de l’avant l’héritage autochtone considérable au sein de leur patrimoine, peu connu et reconnu publiquement. Gélinas (2007) ancre la curiosité voire l’attrait des Québécois pour les Premières Nations dès les années 1930, en raison du particularisme culturel de ces derniers, malgré et en relation avec l’éclipsement identitaire dans les discours nationaux. En effet, la fin de la Crise économique est le moment déterminant où les initiatives venaient désormais des Affaires Indiennes fédérales, non plus du palier provincial. Vincent (1995) ancrait plutôt l’intérêt des Québécois pour les Autochtones dans la foulée de la Révolution tranquille et son ouverture sur le monde. Gélinas souligne similairement la fin de la prévalence d’une matrice négative ou absente à l’endroit des Autochtones dans les écoles vers les années 1960, les générations précédentes ayant perpétué les préjugés. Conjointement, il y a une fierté grandissante quant à l’autochtonie (aboriginal pride) et un renforcement de l’identité culturelle des Premières Nations, Métis et Inuits à l’échelle internationale, notamment reliés à l’augmentation démographique de ces groupes selon Forte et al. (2013) et Trovato et Romaniuk (2014). Cette augmentation se traduit selon ces derniers notamment par le phénomène de mobilité ethnique (ethnic shift) consistant à déclarer son identité autochtone officiellement dans le census pour la première fois. D’autre part, les travaux de Darryl Leroux (2018) détaillent un phénomène social à l’échelle canadienne depuis le moment charnière du jugement Powley en 2003 : cela consiste à s’identifier Métis étant donné la prolifération d’organisations octroyant un membrariat sur la base d’un ancêtre autochtone éloigné ou d’une auto-identification. Surtout lorsqu’opéré pour bénéficier de certains droits, notamment de chasse ou de pêche sans toutefois entretenir de relation tangible avec les communautés métisses historiques, Leroux diagnostique ce phénomène comme une nouvelle forme d’exploitation et de colonialisme envers les peuples autochtones.
Plusieurs moments charnière dans les relations de paix entre Autochtones et Québécois sont à retenir. La Convention de la Baie James et du Nord Québécois en 1975 constituait une entente sur les revendications territoriales des Eeyouch et Inuits, puis des Naskapis avec la Convention du nord-est québécois en 1978 ; la résolution de l’Assemblée nationale du Québec en 1985 reconnaissait les peuples autochtones et leurs droits, la signature de l’entente politique et économique dite Paix des Braves entre Eeyouch et gouvernement du Québec s’est tenue en 2002, ainsi que la création du Conseil conjoint des élus en 2003, destiné au maintien d’une relation harmonieuse, sont tous évoqués par le Secrétariat aux affaires autochtones (2014). Le gouvernement provincial vise « une relation harmonieuse et durable » (Secrétariat aux affaires autochtones, 2008, p. 2). Le portail officiel de l’Assemblée des Premières Nations (2017) statue qu’elle vise des relations de collaboration avec les représentants des paliers gouvernementaux et que chaque gouvernement doit travailler avec elle pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies.
En termes de relations politiques entourant la notion mitigée de reconnaissance, le Québec a reconnu le droit de vote aux Premiers Peuples en 1969, tandis que le gouvernement fédéral reconnaissait ce droit en 1960 (Gélinas, 2007, p. 50). Apportant sympathie et sensibilisation des Québécois envers la cause crie et inuite face à la convoitise du gouvernement provincial envers les ressources naturelles de la Baie James dans les années 1970, le succès de la résistance autochtone a été officialisé avec la Convention de la Baie James et du Nord Québécois. Il s’est poursuivi avec l’auto-gouvernance du territoire reconnu avec l’entente de principe de création du gouvernement régional du Nunavik en 2007, propulsé par le mouvement des coopératives inuites des années 1960-1970 (Lepage, 2009). En vertu notamment des résolutions de 1985 et 1989 (reconnaissant la nation Wolastoqiyik), réitérées lors de la Paix des Braves, divers accords, ententes de principe et ententes de collaboration de « nation à nation » ont cours et se redessinent entre le gouvernement du Québec et les Premières Nations, Métis et Inuit ; la notion du Québec comme « État plurinational » est un acquis selon l’analyse de Bouchard (2014, p. 17).
Puis, le sondage Truth and Reconciliation Commission 2015 de l’Institut Angus Reid (2015), évaluant les attitudes de la population canadienne face à la Commission, dénote que celle-ci est perçue comme pertinente, mais que l’action gouvernementale en ce sens est insuffisante. Les résultats montrent un souci plus prononcé de la part des Québécois (72,1 %) par rapport à l’ensemble des provinces (64 %) quant à la recommandation de protection des langues autochtones, ainsi que la nécessité de porter plus d’attention aux enjeux autochtones (46,4 % par rapport à 40 %) (Angus Reid Institute, 2015).
Acteur clé de l’organisation de soutien québécois de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Pierre Lepage (2009) sensibilise un lectorat québécois aux réalités des peuples autochtones dont les territoires incluent la province. Il puise des exemples de projets communs réussis, dont la Convention de 1975, et déconstruit les croyances et les stéréotypes (sur les prétendus avantages sociaux, la situation d’emploi…) que les Québécois peuvent entretenir à l’endroit des Autochtones. L’obstacle principal aux relations harmonieuses demeure la méconnaissance selon Lepage, et une image négative des Premières Nations, notamment des Kanien’kehà :ka, circule dans la province depuis le siège de Kanehsatà :ke (Crise d’Oka) en 1990 (p. iii). Cet événement est qualifié de désastreux pour les relations entre Autochtones et Québécois par le Secrétariat aux Affaires autochtones (2016), de bris dans les relations malgré une possible réparation (Carrier & Higgins, 2014) ; et par ailleurs il y a l’hypothèse d’Alexandre Bacon (Innu) selon laquelle la Crise serait à l’origine d’un intérêt grandissant pour les Premières Nations (cité dans Vaudry, 2016) ayant fait réaliser à beaucoup de gens que les Autochtones existent toujours (Carrier & Higgins, 2014). En entrevue, Lepage (Tourisme autochtone Québec, 2018, p. 10) souligne que la vision des Québécois à l’endroit des Autochtones s’est grandement améliorée, et que le dialogue maintenant ouvert permettra d’atténuer d’une part les peurs des revendications territoriales des Premières Nations et de l’autre, la discrimination en emploi et en logement.
Représentations autochtones
De façon générale, la littérature culturelle et sociale abordant les représentations des Autochtones traite de ce que celles-ci sont présentes ou non dans une sphère donnée et, si elles le sont, de leur inexactitude ; les Autochtones ont été systématiquement représentés selon une loupe folklorique ou romantique appartenant au passé (Clifford, 1988, 2004 ; Bird et al., 1996 ; Cobb, 2005 ; Smith, 2012 ; Adese, 2015). Adese (2015) nomme ce genre de représentation déformée “the fixed figure of the colonial imagination” (p. 144). Similairement, pour Kaine (2004), l’image stéréotypée de ce que doit être « l’Indien d’Amérique » a figé celui-ci de sorte que la capacité d’actualisation de la culture s’en est trouvée atteinte jusque dans son art, à l’intérieur comme à l’extérieur des communautés (p. 142). Les images occidentales fixées dans le passé heurtent en ce qu’elles omettent de montrer les peuples autochtones dans le présent (Adese, 2015) et aussi dans le futur (Skawennati & Lewis, 2017).
L’anthropologie muséale montre, tel qu’abordé ci-haut, le souci généralisé de réaliser des projets collaboratifs et de consulter les Premiers Peuples dès lors qu’ils sont représentés afin qu’ils contrôlent ces représentations (Task Force et al., 1992 ; Bousquet, 1996 ; Ames, 2000 ; Dubuc & Turgeon, 2004 ; Vernier, 2016 ; Boxer, 2016 ; CMA, 2017). Une tendance similaire en recherche académique à propos des Autochtones favorise une méthodologie les impliquant automatiquement à des fins de contrôle également (Smith, 2012 ; APNQL, 2014 ; Kovach, 2016). Moreton-Robinson (2004) critique les représentations issues d’une épistémologie occidentale blanche qui construit le savoir en effaçant sa propre identité sous le couvert d’un savoir universaliste, appréhendant ainsi les Autochtones comme objets connus plutôt que sujets connaisseurs. Pour Boxer (2016), l’autoreprésentation est fondamentale, la perspective outsider ne faisant que tordre la réalité représentée. Smith (2012) avance que la lutte pour s’autoreprésenter date de la colonisation et que la prise de décisions est encore largement empreinte de paternalisme. Son travail pionnier clarifie la représentation de soi autochtone : “Representation of indigenous peoples by indigenous people is about countering the dominant society’s image of indigenous peoples, their lifestyles and belief systems. It is also about proposing solutions to the real-life dilemmas that indigenous communities confront, and trying to capture the complexities of being indigenous.” (p. 152)
En muséologie, les représentations des Autochtones ont subi un changement significatif, passant de peuples en disparition et appartenant au passé dont il fallait préserver le patrimoine, à des représentations de peuples ancrés dans le présent, valorisant et puisant dans le savoir traditionnel pour orienter leur futur, à travers les musées tribaux entre autres (Ames, 2000 ; Bolton, 2004 ; Cobb, 2005 ; Lonetree & Cobb, 2008 ; Vernier, 2016 ; Boxer, 2016). Les images du passé ont prévalu dans les musées nationaux, surtout d’anthropologie, jusqu’au début des années 1990 selon Janin (2005), d’où le désir de s’en éloigner qui s’incarne par le titre du Rapport du Groupe de Travail, Tourner la page. En Amérique du Nord, la question de « comment exposer » les peuples autochtones est devenue « comment entretenir des relations » avec les communautés, et la critique abondante du travail d’anthropologues et d’institutions muséales a eu un effet à l’échelle globale (Dubuc & Turgeon, 2004 ; CMA, 2017). Le débat entourant l’analyse critique incomplète de la chercheuse américaine Sandra Niessen de l’exposition sur les Ainu du Musée National d’Ethnologie du Japon (Niessen, 1994, 1996 ; Ohtsuka, 1996 ; Shimizu, 1996) a notamment joué un rôle de conscientisation quant à assumer des pratiques muséales et de représentation selon son propre paradigme culturel. Battiste et Henderson (2000) affirment qu’avant le boycott des Cris de Lubicon Lake et le Rapport de Travail, la représentation autochtone au Canada n’était pas reconnue en grande majorité (unacknowledged).
Concernant l’appropriation culturelle et d’un point de vue plus matérialiste, Upton (2012) et Adese (2015) se penchent sur le problème de la fausse représentation et l’appropriation d’œuvres artistiques et métiers d’art autochtones en Amérique du Nord à des fins commerciales. Upton explique le rôle du Indian and Crafts Board créé dans la première moitié du XXe siècle aux États-Unis, afin de protéger et faire la promotion de l’art autochtone pour le bénéfice de l’économie des communautés. De même, Adese (2015) souligne que les représentations autochtones artistiques, cinématographiques, littéraires et de mode par des peuples non-autochtones sont majoritairement régies par des soucis d’ordre matériel, rendant ces images inexactes – plusieurs provenant des premiers stades de la colonisation – en commodités qui circulent de plus en plus à l’ère de la globalisation. Battiste et Henderson (2000) critiquent aussi le côté légal et la notion d’autorisation qu’implique la représentation, en traitant de la propriété culturelle et intellectuelle autochtone surtout collective qui diffère du point de vue occidental surtout individuel (p. 15-16 ; GRIAAC-UQÀM, 2018). Ces chercheurs affirment que la Loi sur le Droit d’auteur est présentement pensée par et pour la société occidentale, représentant peu et inadéquatement les peuples autochtones.
On constate par ailleurs encore une sous-représentation autochtone dans l’art contemporain au Québec et en général (GRIAAC-UQÀM, 2018, Conseil des Arts de Montréal [CAM], 2018). Nadine Saint-Louis (Acadienne), créatrice de l’Espace Ashukan (« pont ») dédié à la promotion de l’art autochtone contemporain à Montréal, stipule qu’il y a une nuance entre le droit de réclamer et reconnecter avec ses racines et l’appropriation et l’exploitation économique de savoirs et de productions autochtones sans redonner à la communauté d’origine ; et que la Loi sur les Indiens (1876-1951) a rendu la culture autochtone absente dans son entièreté (GRIAAC-UQÀM, 2018). Gélinas (2007) apporte le même argument d’absentéisme, surtout d’un point de vue économique, quant à la participation et la représentation des Autochtones au Québec en relation avec l’économie provinciale et fédérale pendant la période post-confédérale.
Plus globalement, James Clifford (1988 ; 1991 ; 2004) a abondamment détaillé et critiqué les représentations occidentales exotiques des cultures autochtones dans l’art, l’anthropologie, les collections et les écrits de voyage à l’ère dite postcoloniale. Citant Clifford, Howes (2003) soutient que la conscience accrue des anthropologues vient précisément de cette crise de la représentation et de la remise en question de l’autorité scientifique traditionnelle (i.e. les ethnologues) (p. 24-25). Bird et al. (1996) critiquaient fortement la construction des images des Autochtones dans la culture populaire américaine depuis 1830 (par exemple, les films Pocahontas et Dances with wolves) présentant une image simplifiée et relevant du passé. Geddes (Tlingit) (s.d.) fait état des représentations cinématographiques de l’Office National du Film et de la CBC au fil du temps : l’image des Autochtones évolue en même temps que la situation politique qu’ils vivent. Une image péjorative, primitive ou sans avenir, a effectivement laissé place à une image de victime passive où le contexte colonial est absent, puis à des comptes-rendus du « problème indien », pour enfin devenir des images plus complexes, représentées par les Autochtones eux-mêmes, depuis les années 1980. Alanis Obomsawin est une cinéaste pionnière en la matière.
Adese (2015) détaille l’importance du travail artistique autochtone qui, à travers une souveraineté visuelle qui affirme qui sont réellement les peuples autochtones, remet en question les discours racialisants portés par « l’impérialisme visuel » qui prétend établir ce qui est vrai (p. 131-133). L’autrice stipule que les enjeux de représentation ne peuvent être détachés de l’héritage colonial et impérialiste. L’impérialisme visuel consiste en la construction et l’exportation de représentations visuelles de l’autochtonie, facilitant l’oppression des Premiers Peuples et ayant misé à son origine sur des images très dichotomiques entre ce qui est « civilisé » et ce qui ne l’est pas (p. 130-133). Les artistes jouent un rôle public majeur dans la représentation des peuples autochtones de ce fait selon Adese.
Tout comme Smith (2012), Havard et al. (2014) rendent compte à travers l’histoire de représentations déformées à caractère ethnocentrique que les explorateurs européens du temps des premiers contacts ont fait circuler à l’endroit de la sexualité, du genre et des mœurs des Autochtones des Amériques. Ces représentations étaient réitérées et condamnées par les dirigeants religieux pendant de nombreuses décennies. Ces interprétations ont par exemple exclu le rôle pourtant notable des femmes dans les négociations des traités comme l’explique Smith (2012).
Thalia Anthony (2013) traite des représentations légales des Autochtones en Australie et au Canada et stipule que la reconnaissance de l’indigénéité la défavorise dans les faits, au sein d’un système légal racialisant qui ne reconnaît pas les lois autochtones. La cour peut aussi faire de la discrimination positive envers les Autochtones en donnant des sentences clémentes sur la base de l’appartenance culturelle. Forte et al. (2013) posent la question politique de l’identité autochtone, qui doit aller au-delà des typologies raciales existantes ; celle dite de l’anti-indigenous essentialism, plus présente dans la sphère publique canadienne, australienne et américaine que dans le domaine académique, repose sur la validation de l’identité autochtone selon que la personne démontre une soi-disant authenticité dans sa façon de se vêtir, de parler, ou de vivre. Forte et al. détaillent les réalités d’une représentation populaire de l’identité autochtone liée au « privilège » et à la « propriété » territoriale, donc requérant une preuve donnant accès à ces éléments (2013, p. 239), tout comme en traite l’anthropologue Simpson (2014) dans son analyse du membrariat mohawk à Kahnawake. De façon similaire, Alfred et Corntassel (2005) critiquent la construction juridique de l’identité autochtone en tant que production étatique, ainsi que les diverses organisations qui tentent de définir qui fait partie de l’indigénéité, telles les Nations unies et le World Bank group.
La théorie sociale, notamment en sociologie historique comparative, a abondamment traité de la variété des formes d’organisation sociale (familiale et politique), des valeurs culturelles, et de la relation à la nature des sociétés autochtones, les contrastant avec le néolibéralisme moderne mettant l’accent sur les droits individuels. Cela a contribué à démontrer la diversité de sociétés possibles dans le monde en s’appuyant sur les mouvements contemporains de résistance et d’autodétermination de nombreux groupes autochtones (Nagel, 2012). La théorie des peuples en voie d’extinction du XIXe siècle, dont témoignent par exemple les travaux de Friedrich Engel et de Louis Henry Morgan sur l’organisation sociale des Haudenosaunee s’est donc vue et se voit largement remise en question (voir Forte et al., 2013 ; Simpson, 2014 ; Coulthard, 2014).
En conclusion, la revue de littérature fait état de la reprise en charge majeure de la part des Autochtones et d’une collaboration en devenir autour des représentations et du patrimoine autochtones à l’échelle internationale. En même temps, il y a la conscience critique partagée de l’héritage préjudiciable de la recherche, de l’art, des institutions culturelles dont les musées, de l’histoire et des sciences sociales. La mise en valeur du patrimoine autochtone au Québec s’inscrit dans cette dynamique et semble pouvoir trouver un terrain propice, et le rendre encore plus propice, étant donné l’état des relations sociales entre Premières Nations, Métis et Inuits et Québécois-es.
III. Question de recherche
Le thème de cette recherche exploratoire est la mise en valeur du patrimoine autochtone auprès des Québécois-es. La question de recherche est : « Comment la mise en valeur muséale du patrimoine autochtone auprès du public québécois par La Maison amérindienne s’articule-t-elle pour créer un changement dans les relations sociales des peuples ? »
L’hypothèse est que le succès de cette mise en valeur dépendra étroitement du contexte géographique, organisationnel, multisensoriel, et interculturel capacitant du musée pour atteindre la solidarité interculturelle[2], voire participer à une guérison collective. Je fais référence à l’aspect géographique, car si la préservation du patrimoine autochtone doit se faire dans son lieu d’origine selon Vernier (2016) et Dubuc et Turgeon (2004), le patrimoine de l’acériculture prend tout son sens avec l’érablière située en territoire ancestral abénaki, plutôt que l’exposer dans une institution urbaine européenne, par exemple, qui serait déconnectée de ce même patrimoine. Organisationnel, car ce musée est lui-même le produit d’une institution occidentale réappropriée, indigénisée, il est né de la rencontre interculturelle entre le fondateur et notamment avec les Innus de la Côte-Nord, et incite à cette rencontre à travers son fonctionnement. Interculturel concerne les différentes Premières Nations au Québec mises en valeur et en dialogue au musée, et la composition de son équipe ainsi que de ses publics, permettant une rencontre interculturelle. Enfin, multisensoriel, car le musée doit faire appel à tous les sens du public, il permet à celui-ci d’expérimenter, de connaître corporellement le patrimoine, non de l’appréhender seulement par la vision, à l’instar d’autres médias, institutions ou supports. Ces aspects ont été générés suivant mes contacts initiaux avec l’équipe, selon ma réflexion découlant autant que faire se peut d’une épistémologie autochtone, et ils concernent spécifiquement l’institution muséale collaborant à cette recherche.
Je parle de solidarité (relations sociales reposant sur une plus grande compréhension mutuelle) et de guérison collective là où Autochtones et Québécois-es ont des blessures propres à leur histoire respective, blessures parfois enchevêtrées, qui peuvent être déconstruites ou expliquées par le biais de la rencontre sur un pied d’égalité, vécue corporellement dans un espace autochtone.
IV. Problématique de recherche
Survol de La Maison amérindienne
En tant qu’organisme muséal multi-nations situé hors communauté autochtone et géré par un conseil d’administration composé exclusivement de membres de diverses nations autochtones, organisme unique en son genre au Québec et au Canada (Labrosse, 2018), La Maison amérindienne a pour mission sociale d’« être un lieu d’échanges, de partage et de rapprochement des peuples » (La Maison amérindienne [MA], 2012, page d’accueil). Implanté en 2000 par l’artiste peintre et sculpteur d’origine française André Michel, le musée d’art et d’histoire est mis sur pied à Mont-Saint-Hilaire via la Fondation Ushket-André-Michel, qui vise aussi à mieux faire connaître les Premières Nations. Le musée résulte de la collaboration et du soutien entre Autochtones et allochtones, s’inscrivant au sein de la Décennie internationale des peuples autochtones lancée en 1994. Récipiendaire de nombreux prix, l’organisme muséal dit Entreprise culturelle d’économie sociale a aussi été reconnu par la Commission de lieux et monuments historiques du Canada comme le seul « lieu de référence national des Produits de l’érable pour l’origine de l’acériculture » (MA, 2012, page d’accueil), et s’est fait octroyer le statut d’institution muséale agréée du Ministère de la Culture et des Communications au printemps 2019.
La programmation culturelle du musée tourne autour des volets artistique, environnemental et gastronomique présentés à travers des expositions (permanente, temporaires, itinérantes) ; des conférences ; des animations pour jeunes et adultes dont des visites guidées (sur mesure ou tous les jeudis aux « Jeudis culturels » du musée, et hors les murs dans les écoles des régions environnantes ou pour les groupes : les animateurs et animatrices sont dits « nomades », et « sédentaires » lorsque recevant des groupes sur place) ; des repas de gastronomie à saveur autochtone ; et des événements et ateliers ponctuels tels la fabrication de capteurs de rêves ou les concerts musicaux Découverte autochtone (MA, 2012).
L’exposition permanente porte sur le patrimoine autochtone de l’acériculture au Québec tandis que les expositions temporaires artistiques contemporaines mettent de l’avant diverses thématiques propres aux Premières Nations. Les ateliers et conférences portent sur diverses facettes et savoirs-faire de la vie des Premières Nations. Le musée vend également à sa boutique des œuvres et objets confectionnées par des artistes et artisans autochtones (mocassins, ornements, livres, fourrures…), et vend des produits d’inspiration culinaire autochtone cuisinés sur place au petit café Le Mishtan, opérationnel à l’année. Le coût d’entrée modique pour visiter le musée inclut son site extérieur comprenant des sentiers sillonnant l’érablière, dont un sentier d’interprétation, des jardins (cultivant les Trois Sœurs et des baies sauvages) et un potager. En termes de présence virtuelle, le musée est surtout actif via son site Internet et le réseau social Facebook.
Méthodologie
Une méthodologie qualitative a été utilisée pour ce projet de recherche. Dans un premier temps, sur une base volontaire et après consentement éclairé, il y a eu des entrevues/discussions individuelles ou à deux selon les circonstances de travail et les préférences des participants, à l’exception d’un membre de l’équipe qui préférait répondre par écrit pour des raisons pratiques. Les propos de sept membres de l’équipe du musée (équipe terrain, conseil d’administration, fondateur) forment la source principale de l’étude. Initiées avec l’aide de la directrice du musée, ces rencontres entouraient la question de la mise en valeur du patrimoine autochtone à La Maison amérindienne, avec des sous-questions ouvertes parmi lesquelles « quelles représentations autochtones sont privilégiées, lesquelles ont fonctionné le mieux au fil des ans ? Comment la mise en valeur du patrimoine de plusieurs nations à La Maison diffère-t-elle de celle d’une nation en particulier ? Quelles sont les réactions de vos publics, que devraient-ils savoir ? » Tous les participants tenaient à ce que leur identité soit divulguée dans ce travail.
Cette approche de discussion laisse place aux voix autochtones et non-autochtones qui organisent et vivent la réalité de la rencontre interculturelle au musée, et s’inscrit dans le contexte de privilégier l’oralité comme mode de transmission du savoir. Dans le cas de la rencontre avec plusieurs participants ensemble (la méthodologie initialement privilégiée), elle permet de susciter la mémoire et de facilement identifier les accords et divergences d’opinion parmi les participants (Tanguay, 2010). Un codage thématique a été appliqué aux propos des entretiens enregistrés pour dégager les constantes dans la mise en valeur du patrimoine au musée, les thèmes ainsi générés étant ensuite regroupés selon les quatre aspects géographique, organisationnel, interculturel et multisensoriel à des fins de clarté.
En complément aux entretiens et à leur analyse, il y a eu la participation à des activités de la programmation du musée pour une période donnée (été, automne 2018 et hiver 2019), en tant que visiteuse « régulière ». Cette participation a permis de constater l’application tangible de la mise en valeur du patrimoine à La Maison amérindienne et d’enrichir la compréhension des propos entendus lors des discussions. Il s’agissait
- des expositions en cours (De l’eau… à la bouche, exposition permanente, Poésie de la Nature et La célébration du beau – Jean-Paul Riopelle, et Joyce Panadis, l’essence d’un peuple, expositions temporaires) incluant celles hors les murs (Nomades ou itinérants – peuples en danger à l’Écomusée du Fier Monde de Montréal et J’épie… le maïs à la Maison LePailleur de Châteauguay) ;
- d’une visite guidée (les «Jeudis culturels ») ;
- de la visite de l’érablière environnante ;
- de tout autre élément jugé pertinent par La Maison (ex : entrevues télé et radio, assister à l’animation suivant les Repas amérindiens du temps des sucres, documentation interne des valeurs du musée).
Il y a eu enfin la participation comme bénévole lors de l’activité « Repas à saveur amérindienne du temps des sucres » de mi-mars à mi-avril 2018, ainsi que lors du « Festin de crabes Wolastoqiyik Wahsipekuk » plus tard au printemps 2018. Le service aux tables a permis d’observer en amont les réactions des visiteurs face au patrimoine (surtout culinaire) mis de l’avant. Il y a aussi eu la proposition d’une quarantaine d’heures bénévoles en muséologie, étant donné ma formation et mon expérience qui pouvaient être mises à profit : le démontage de l’exposition Nomades ou itinérants, rédaction de communiqués de presse, développer les listes de contacts média, touristiques, etc., ayant cours au moment de la rédaction.
Ce dernier point sur le bénévolat concerne avant tout la relation de réciprocité entamée dans la collaboration avec l’équipe de La Maison amérindienne pour ce projet. Le partage des résultats et du mémoire au musée avant son partage au public fait également partie de ce processus et s’inscrit dans les recommandations du Protocole de recherche des Premières Nations au Québec et au Labrador (APNQL, 2014). Dans la même veine et suivant le droit de double regard recommandé par le Protocole de recherche ainsi que ma perspective d’une éthique de recherche relationnelle qui vise à éviter de répéter les erreurs de représentation du passé, la proposition de projet, les questions de discussion, le formulaire de consentement et l’interprétation des résultats ont été validées ou modifiées au besoin par l’équipe du musée avant soit la collecte de données ou la défense du projet de maîtrise, selon l’étape du projet concernée. Au terme de ce processus visant l’adéquation des savoirs traditionnels et scientifiques et de ce fait une prise de décisions et des résultats de meilleure qualité (APNQL, 2014, p. 18), il y a eu approbation de la direction pour la proposition du projet, et approbation de tous les participants pour les questions et le formulaire de consentement ; une réponse positive de tous les membres de l’équipe ayant collaboré quant à l’analyse des résultats au terme d’un délai de quatre semaines pour prendre connaissance de ces résultats ; et quelques précisions ont été apportées par le fondateur quant à la genèse du musée ainsi que la visibilité de l’équipe sur la plateforme web du musée.
Trois approches méthodologiques orientent le projet, soit les méthodologies autochtones, l’analyse discursive et la sensation participante nuancée par rapport à l’observation participante. La première méthode a été utilisée du début à la fin du projet, impliquant une auto-réflexion constante. Telles que définies par Kovach (2010, 2016) les méthodologies autochtones reposent sur une épistémologie autochtone holistique en contraste avec une épistémologie scientifique occidentale, afin de conduire une recherche sensible aux réalités autochtones et reconnaissant leur point de vue en l’impliquant nécessairement. Je porte par exemple une attention particulière à l’interconnexion entre les éléments plutôt qu’à leur dualité ; à la pensée circulaire plutôt que linéaire ; aux symboles culturels, aux animaux symboliques (aigle, ours, loup…) et aux métaphores liées à la nature et leur récurrence, ainsi qu’au patrimoine en relation constante avec le passé, le présent et l’avenir.
Cette approche paradigmatique holistique est compatible avec toute méthode choisie qui se rapproche d’une vision du monde autochtone. Elle favorise l’affirmation de la sagesse corporelle (bodily wisdom) et l’expérience corporelle en tant que composantes méthodologiques majeures, le corps étant central au processus de décolonisation et d’indigénisation (Kovach et al., 2014, p. 68). Sont également favorisées l’histoire orale et la narrativité comme méthode et comme contenu significatif (Kovach citée dans Brown, 2012), en favorisant et en laissant place ici au récit des principaux actrices et acteurs du musée et de chercheurs autochtones dans la littérature. Leur appartenance culturelle est systématiquement mentionnée comme dans une grande part de la littérature autochtone[3]. Kovach invite tout le monde, indépendamment de sa nationalité, à utiliser cette méthode participant de la décolonisation des pratiques académiques.
La seconde approche est la sensation participante abordée par Blanchard et Howes (2014), qui fait appel à la multisensorialité comme façon de conduire la recherche, contrastant avec l’observation participante qui met carrément l’accent sur la vue, mais tout en maintenant la dimension de participation active de cette dernière. En complémentarité avec les méthodologies autochtones, la sensation participante répond mieux aux réalités muséales (expérience corporelle d’expositions tridimensionnelles, dégustations, audiovisuel, manipulation d’objets) et autochtones (accent sur l’histoire orale, expérience et savoir corporels). Howes (2003) nuance toutefois que s’appuyer uniquement sur ses propres perceptions pour appréhender l’univers sensoriel d’autrui est une erreur et demande plutôt de conceptualiser les sens selon l’importance et la signification que les phénomènes sensoriels ont et portent pour autrui (p. 50). En outre, aucune théorie occidentale des sens ne pourra substituer toutes les épistémologies autochtones si culturellement spécifiques ; il faut nécessairement se pencher sur les théories et pratiques développées par les sociétés en question (p. 54). Cette approche était surtout utilisée au musée, lors de la participation à la programmation et pendant le bénévolat.
La troisième approche est l’analyse discursive des données collectées sur le terrain afin d’identifier clairement les messages produits et diffusés par le musée et leur signification quant à la mise en valeur du patrimoine autochtone au Québec, suivant le point de vue du sociologue d’origine jamaïcaine Stuart Hall (1997 ; 1999) sur la dissémination communicationnelle. Si la signification dérive de la pratique comme il le soutient, on peut voir par exemple comment le goût est encodé dans les pratiques du musée pour faire valoir le patrimoine de l’acériculture ou de la culture des Trois Sœurs. Cette théorie polyvalente et relationnelle permet aussi de comprendre comment le musée décode à sa façon les messages de la société québécoise concernant les Autochtones pour les contester ou les approuver, façonnant ou non un sens d’agentivité chez celles et ceux qui sont en contact avec ces messages.
V. Analyse des résultats et discussion
Dans cette section, je situe d’abord le contexte de réappropriation des représentations autochtones dans lequel s’inscrit le travail patrimonial étudié ici. J’explique le cadre théorique utilisé pour l’analyse discursive des éléments de mise en valeur du patrimoine provenant de mon expérience à La Maison amérindienne. Tout en se tissant un à l’autre, ces éléments clés sont regroupés par souci de clarté selon les quatre aspects contextuels énumérés ci-haut (géographique, organisationnel, interculturel, et multisensoriel) entourant le phénomène de mise en valeur muséale du patrimoine autochtone à La Maison. Cet enchaînement permettra d’étendre la réflexion sur ce phénomène à l’échelle des relations sociales entre Québécois et Premières Nations, Métis et Inuits.
1. Contexte et cadre théorique
1.1 Décolonisation des représentations
La revue de littérature a montré que le paradigme muséal euro-américain entourant le patrimoine autochtone en est idéalement un de collaboration prometteuse, et qu’au quotidien, il s’agit souvent d’un manque de savoir ou de sensibilité, et de silence de la part de nombreuses institutions euro-américaines. Tout en étant agents de changement dans le milieu, les communautés autochtones vont accommoder les impératifs des institutions comme en fait état Ames (2000), sans négliger bien évidemment le succès de projets collaboratifs d’un Musée McCord (voir, par exemple, l’exposition permanente Porter son identité, 2013) ou d’un Musée Canadien de l’Histoire, et d’une poignée d’autres qui jouent aussi un rôle actif dans le rapatriement d’objets. La nuance entre collaboration et accommodement repose sur ce que la première mise sur les défis, les solutions gagnantes pour tous et la volonté de résoudre les conflits, tandis que le second signifie la négociation, le compromis et les solutions acceptables (Morgan, 1999, p. 200).
Le terme d’imaginisation de Gareth Morgan (1999), i.e. l’art de déchiffrer les problèmes organisationnels, est non sans lien avec la situation muséale au Québec quant au patrimoine autochtone : j’imaginise ce patrimoine comme étant (encore) peu officialisé dans les institutions de la mémoire, et comme étant définitoire et un défi lancé envers le patrimoine québécois largement diffusé. La narration historique muséale chronologique ou même thématique relègue souvent le patrimoine autochtone à un passé romantique qui s’éclipse subtilement dès la Conquête, et présente des objets avec une contextualisation (et de l’information) très limitée : nom de l’objet, date, matériau, lieu d’origine. Pourtant, les patrimoines autochtones précèdent, influencent et côtoient le patrimoine québécois. D’où la légitimité du musée autochtone (qui sert les besoins des communautés avant tout), de pratiques muséales collaboratives et de la décolonisation et de l’indigénisation des musées. Linda Tuhiwai Smith (2012) avance que le projet intellectuel de décolonisation “has to set out ways to proceed through a colonizing world. It needs a radical compassion that reaches out, that seeks collaboration, and that is open to possibilities that can only be imagined as other things fall into place.” (p. xii)
Ainsi, dans un contexte de reprise de contrôle de leurs représentations culturelles au sein d’un univers empreint de tenaces rebuts coloniaux et néocoloniaux, les Premiers Peuples adaptent l’institution muséale à leurs pratiques et à leurs visions du monde, ce qui correspond à la décolonisation au sens de Smith (2012) et Kovach (2016). Kovach (et al., 2014 ; 2016) réclame la création d’espaces de diverses natures qui honorent les savoirs autochtones ; la décolonisation implique une action qui revalorise le savoir traditionnel autochtone et qui transforme les histoires personnelles et politiques (2014, p. 72). Battiste et Henderson (2000) prônent la récupération de la terre, du patrimoine et du savoir autochtones comme éléments vitaux de décolonisation. La notion de création conjointe à la déconstruction se trouve aussi dans l’analyse d’Adese (2015) suivant le concept de souveraineté selon Cobb (2005) : cette analyse montre le travail décolonial et définitoire d’artistes tels que Rebecca Belmore (Anishinaabe), Kent Monkman (Cree) et Terrance Houle (Blood) comme des œuvres de souveraineté visuelle qui « “represent back” and challenge White North America’s image machine, but they also “write forward” » (p. 134), par exemple avec les Urban Indian Series de Houle qui dépeignent un Autochtone en tenue d’apparât dans des scènes de la vie quotidienne en ville.
Smith (2012) mentionne qu’à la plus simple expression du projet global de représentation autochtone, la représentation dominante mélange souvent les Premiers Peuples parmi les minorités (sic) culturelles, “as one voice amongst many” (p. 152). Les politiques de souveraineté et d’autodétermination sont une résistance à ce phénomène sur l’assise de droits ancestraux. En fait, autochtonie et diversité issue de l’immigration sont presque des pôles opposés (CAM, 2018). Pour Franco (2012), l’identité relaie la culture ; l’affirmation de l’identité autochtone passe par une relecture historique d’un point de vue nécessairement autochtone. Ames (1992), l’un des pionniers de la muséologie collaborative au Canada, disait d’ailleurs que le musée occidental n’a pas à présenter le point de vue autochtone, ce qu’il ne pourrait faire adéquatement de toute manière, mais bien à travailler en partenariat avec les musées et organismes autochtones qui se représentent.
L’auto-représentation autochtone selon Smith (2012) se définit donc par la résistance à l’image proposée par la société dominante, par les solutions à apporter auprès des communautés, et par les complexités entourant le fait d’être indigène. De même, le travail patrimonial de La Maison amérindienne vise à valoriser les Premières Nations auprès de ses publics et à contrer les préjugés de la société majoritaire. Ce type de représentation va à l’encontre d’un discours dominant, phénomène que Hall (1999) définit en tant que lecture oppositionnelle (oppositional code). J’utilise la théorie relationnelle de l’encodage/décodage de Hall pour comprendre la dynamique de représentation et de résistance liée à la mise en valeur du patrimoine autochtone. Smith fait référence à cette théorie dans sa fine analyse du système de représentation occidental des Autochtones ; cela résume bien le point de vue décolonial et critique envers les discours occidentaux que j’adopte :
Stuart Hall makes the point that the West is an idea or concept, a language for imagining a set of complex stories, ideas, historical events and social relationships. Hall suggests that the concept of the West functions in ways which (1) allow “us” to characterize and classify societies in categories, (2) condense complex images of other societies through a system of representation, (3) provide a standard model of comparison, and (4) provide criteria of evaluation against which other societies can be ranked. These are the procedures by which indigenous peoples and their societies were coded into the Western system of knowledge (p. 44-45).
1.2 Théorie de l’encodage/décodage
Stuart Hall, acteur clé du champ des études culturelles analysant la culture populaire, a élaboré une théorie de la communication en 1973. Cette théorie questionne la prétendue transparence des messages médiatiques (surtout télévisuels), pourtant toujours influencés par une culture donnée. Hall détaille quatre moments liés mais autonomes que sont la production des messages (encoding), leur circulation, leur consommation et distribution (decoding) puis leur reproduction. Particulièrement pertinente ici, l’étape du décodage est celle où la signification du message prend forme et a une utilité sociale (social use) (Procter, 2007, § 4). S’inscrivant dans la tradition sociologique du structuralisme et du constructionnisme, où le langage au sens large est non pas un reflet de la réalité mais un élément constituant la réalité, la théorie de Hall est pertinente en ce qu’elle s’intéresse aux “social relations of the communicative process” et non seulement à ses caractéristiques techniques ou esthétiques (Procter, 2007, § 4). De la même manière, je me penche sur les processus sociaux engendrés par la pratique communicationnelle muséale en général et par la pratique de La Maison amérindienne en particulier. Je vais d’abord définir les notions théoriques de représentation, de « signes » et de « codes » de Hall pour ensuite analyser plus précisément la pratique muséale et sa réception sociale.
La représentation fait partie de la production culturelle de ce qui fait sens, selon Hall : “Representation means using language to say something meaningful about, or to represent, the world meaningfully, to other people” (1997, p. 79). Deux systèmes de représentation sont impliqués et reliés : celui des concepts classés et organisés (mental representations), et celui du langage dans son sens très large – composé d’images, gestes, mots, sons, style vestimentaire, etc. qui ont un sens, nommés signes (signs) – afin de partager et exprimer ces concepts. Donc, Hall soutient que le sens est non pas inhérent aux choses dans le monde, mais bien construit par la pratique de la représentation ; il est le résultat d’une pratique signifiante. Autrement dit, le sens n’est pas dans un élément donné ou le mot qui le désigne (ex : arbre) mais bien dans le système de représentation de l’élément (soit le signe conceptuel et linguistique « arbre » d’une société) (p. 85-88).
Cette vision relationnelle et constructionniste a préséance car ce sont les gens qui attribuent un sens aux choses réelles pour entrer en relation avec leur environnement. Ainsi, la représentation est un processus dynamique qui lie les éléments, les concepts et les signes (Hall, 1997). Quant au code (code), sorte de règle qui relierait et fixerait arbitrairement les deux systèmes de représentation identifiés ci-haut, soit les concepts et le langage composé de signes, fait en sorte que lorsqu’on se réfère à un arbre par le langage, le code nous incite automatiquement à dire « arbre » avec les lettres organisées A,R,B,R,E (p. 85), ou alors « abazi » (abénaki), « tree », ou « arbol » selon une culture donnée ; ou lorsqu’on voit un cercle composé de quatre quarts noir, blanc, rouge et jaune, on identifie les quatre directions de la roue de médecine autochtone. Le sens dépend donc de la relation entre un signe et un concept, fixés par un code : “[Codes] tell us which language to use to convey which idea. The reverse is also true. Codes tell us which concepts are being referred to when we hear or read which signs” (p. 85). Cette relation arbitraire entre signe et concept serait responsable de la nature prétendument transparente des images médiatiques pour Hall. Par contre, la façon dont se déploient les « codes » est tout sauf arbitraire ; elle est ce que chaque enfant apprend lors de sa socialisation, et est partie intégrante des conventions sociales d’une culture donnée.
Le décodage, soit la circulation et la consommation des messages, est donc seulement possible sous la forme langagière propre à son entité de production, donc suivant les règles qui régissent ce langage : un programme télévisuel « encodera » l’histoire d’une tragédie à travers les conventions télévisuelles, mais jamais sous la forme crue qu’avait la tragédie lorsqu’elle s’est réellement déroulée (Hall, 1999, p. 91-92). Une exposition passera un message à travers les standards de conservation préventive, d’éclairage, etc. qu’elle requiert. Hall propose trois façons de décoder les messages, soit dominante-hégémonique (dominant-hegemonic position), négociée (negotiated position) et oppositionnelle (oppositional code) (p. 101-103). En effet, ces lectures possibles ne seront pas nécessairement en harmonie avec l’encodage proposé par un producteur. Cette complexité de façons de décoder, et même d’encoder les messages est due, selon Hall, à la structure des organisations et des audiences qui diffère abondamment (p. 93-96). La lecture dominante-hégémonique correspond à celle souhaitée par l’entité productrice ; la lecture négociée reconnaît comme globalement légitime ce qui a été signifié tout en laissant la place à sa propre interprétation et action selon une situation donnée. Enfin, la lecture oppositionnelle est alternative au discours dominant, globalement contraire à ce discours.
Ainsi, je cherche à savoir comment La Maison encode un discours de mise en valeur du patrimoine autochtone auprès de la société québécoise ; comment celle-ci le décode sommairement (faute d’études de visiteurs approfondies en raison des limites de ce travail) ; et comment ces deux entités décodent les discours concernant les relations sociales entre Québécois et Premières Nations. Hall (1999) positionne l’interactivité nécessaire entre la production communicationnelle et l’environnement qui l’entoure : “Codes […] clearly contract relations for the sign with the wider universe of ideologies in a society” (p. 98). En élaborant sa théorie des champs, Bourdieu (1992) illustrait aussi l’aspect relationnel et la position obligée d’un champ de production culturelle donné au sein d’un champ de pouvoir, eux-mêmes intrinsèques à celui de l’espace social national – et j’ajouterais, suivant une épistémologie autochtone, que tous ces champs sont en relation et au sein de l’ordre écologique.
1.3 Sociologie des émotions
La sociologie des émotions permet de s’éloigner des dualismes et impasses théoriques entre raison et émotion, psychologique et physique, objectivité et subjectivité. Un précepte difficilement reconnu par l’ensemble des disciplines, est que chaque action, aussi logique et rationnelle qu’elle puisse sembler, implique nécessairement une ou plusieurs émotions. Le principe holistique autochtone des quatre directions alliant le spirituel, le physique, l’émotionnel et le mental repose sur la reconnaissance que les éléments s’influencent les uns les autres et sont d’importance égale, ce que l’épistémologie occidentale continue souvent d’occulter à travers diverses approches reposant sur des principes hiérarchiques (ex. : la raison est supérieure aux émotions). En outre, Barbalet (2001) critique fortement le dualisme propre à l’épistémologie occidentale en explicitant le rôle d’orientation que jouent les émotions auprès de la raison. Ainsi, les émotions ne sont pas des états ressentis arbitrairement ou réduites à des états qui vont et viennent au gré de notre interaction avec notre environnement, mais bien des “felt incapacities and capacities that structure agency” selon Valérie de Courville Nicol (2011, p. 11).
Recourir théoriquement aux émotions s’appuie sur les faits notables que celles-ci sont centrales à la culture (Jasper, 2013) et à l’orientation de la vie sociale (Williams, 2001), et que l’interaction sociale est d’abord affectée par l’expérience du sentiment d’empathie, qui en est à la base, comme le met de l’avant De Courville Nicol (2011). L’expérience émotionnelle sociale passe donc par l’habileté à assimiler émotionnellement une situation donnée. Nous sommes toujours « en émotion », même la personne qui semble la plus neutre ou la plus blasée (De Courville Nicol, communication personnelle).
Par l’accent qu’elle met sur la dimension du ressenti comme condition pour agir en relation avec ce qui nous entoure et nous influence, j’ai recours à la théorie de l’in/capacité incorporée (embodied in/capacity theory) de De Courville Nicol (2011) qui permet de constater la dynamique émotionnelle des relations sociales entre Autochtones et Québécois-es dans cette analyse. Cette théorie permet en outre de voir comment certaines émotions et stratégies émotionnelles incapacitent ou « capacitent » à l’échelle personnelle et collective selon qu’elles sont liées à des objets suscitant le désir et la peur – ici, le désir en tant qu’envie de rapprochement envers un élément donné assurant ainsi une sécurité émotionnelle, telle la notion de collaboration entourant la mise en valeur du patrimoine autochtone, afin d’éviter l’insécurité émotionnelle des représentations erronées et conflictuelles. L’expérience émotionnelle signifie donc une incapacité agentielle (agential incapacity) si propulsée par la peur, et une capacité agentielle (agential capacity) si propulsée par le désir, ces deux états impliquant de manière dialectique et non dualiste la forme de l’un et de l’autre (p. 25).
L’autrice théorise cette tension constante entre peur et désir comme une condition de la réalité vécue, et la capacité (et par extension, l’adjectif « capacitant-e » que j’utilise) est pensée selon le sens d’habileté. Cette capacité est nécessairement un sentiment vécu par le corps, qui structure l’agentivité ainsi que le soin envers soi, les autres, et l’environnement avec lequel nous interagissons (p. 11, 170). Ainsi, les concepts de normes émotionnelles dialectiques, regroupées selon une orientation stratégique de confrontation, d’évitement, de prévention (p. 31-41) et de collaboration (De Courville Nicol, 2021) permettent d’illustrer le caractère pratique et social des émotions. Par exemple, l’expérience émotionnelle de l’ignorance/connaissance (ignorance/knowledge) en tant que perception d’in/capacité à confronter son manque de compréhension à travers l’apprentissage (p. 32) peut être appliquée au musée visant à mieux faire connaître les Premières Nations ainsi que le commentaire de Lepage (2009) sur la connaissance comme solution vers des relations harmonieuses entre Québécois et Autochtones. Cette norme émotionnelle participerait d’une orientation de confrontation ainsi que de collaboration, laquelle vise la transformation d’une relation antagoniste en une relation de symbiose à travers le temps (De Courville Nicol, 2021, p. 4).
J’utilise la théorie de l’in/capacité incorporée pour appréhender les émotions à la source de la mise en valeur du patrimoine autochtone au musée et les émotions suscitées par la rencontre interculturelle, analysant le degré de capacité qui en découle. Mon hypothèse d’un contexte géographique, organisationnel, interculturel et multisensoriel capacitant du musée pour atteindre la solidarité entre peuples impliquerait la capacité incorporée des acteurs impliqués par l’action du musée à contrer les tensions sociales et préjugés envers les Autochtones comme « danger moral » grâce à la valorisation patrimoniale qui participe à une « sécurité morale » (De Courville Nicol, 2011, p. 6). Voyons des exemples concrets du phénomène de mise en valeur du patrimoine autochtone, d’abord en relation avec la notion de lieux et de territoire.
2. Aspect géographique : lieux et territoires
La notion du musée en tant que lieu significatif ou empli de potentiel revenait souvent dans les propos de l’équipe du musée et apparaît comme primordiale au succès d’une mise en valeur du patrimoine autochtone à La Maison amérindienne. Ce mot a d’ailleurs sa place dans la définition de la mission du musée, en tant que lieu d’échange, de partage et de rapprochement. J’expose d’abord l’importance identitaire du territoire pour les Premières Nations, Métis et Inuits puis j’exemplifie les sous-aspects géographiques de mise en valeur particulièrement significatifs que sont un lieu unique hors réserve, un lieu où l’on se sent bien, qui permet le rapprochement et le rayonnement ; et le lieu de l’érablière en tant que patrimoine autochtone.
2.1 Le territoire constitutif de l’identité
Le lien au territoire est si important et partie intégrante, ou plutôt partie intégrative de l’identité autochtone qu’Alfred et Corntassel (2005) prônent le retour aux territoires d’origine (homelands) en tant qu’impératif de décolonisation, conjointement à se libérer des mythes hérités du colonialisme et à se souvenir des cérémonies (p. 601). Ils citent Kim Anderson (Cree/Métis) sur la connexion au territoire en tant que l’une des fondations de la résistance. Ils élaborent un manifeste pour la liberté autochtone, dont le mantra “land is life”, signifiant que se reconnecter aux terres de leur héritage est le passage obligé pour comprendre les enseignements et les valeurs des ancêtres (p. 613). Cela rejoint même l’identification identitaire Alutiiq en Alaska de l’ethnographe Partnow (citée dans Clifford, 2004, p. 17) d’abord selon les liens au territoire (ties to land), puis selon une continuité avec le passé, et le langage.
En faisant référence à l’ordre écologique de toute chose dans la vision du monde autochtone, Battiste et Henderson (2000) dénotent que les écologies sont bien plus que des emplacements ; on leur appartient. Carrément, “Indigenous order, consciousness, and heritage are shaped and sustained by ecological forces and by the interrelationship of their changing forms” (p. 9). Les auteurs démontrent toute la gravité de délocaliser les membres des Premiers Peuples de leur territoire, comme une extension d’eux que l’on enlève ; on peut y relier la notion de solastalgie élaborée par le philosophe de l’environnement Albrecht (et al., 2007), en tant que détresse due aux changements environnementaux, qu’exil dans son propre territoire. La terre est en elle-même une valeur autochtone, et porte des enseignements et responsabilités propres à chaque nation occupant un territoire donné. Alexandre Bacon (cité dans Vaudry, 2016) résume bien l’importance d’être en contact avec la nature dans la programmation du Cercle Kisis, un organisme basé à Québec et dédié à la rencontre entre peuples :
L’humain est absolument génial pour structurer son environnement. Le problème est que l’on se coupe du lien sacré que l’on a aussi avec la nature, de laquelle nous sommes issus. Or, chez les Premiers peuples, dans plusieurs continents, le principe de base c’est le cercle. Le cercle symbolise l’intégration de l’humain au reste du cosmos (p. 101).
Ce lien sacré n’est pas sans évoquer le « métabolisme » auquel faisait référence Karl Marx, c’est-à-dire la relation réciproque et fondamentale entre l’humain et la nature. Marx critiquait fortement la rupture avec la nature (metabolic rift) qui s’est répandue parmi les sociétés occidentales depuis l’avènement de la seconde vague industrielle agricole sous l’ère capitaliste, exploitant dès lors les sols massivement sans en permettre la régénération (Foster, 1999). Ainsi, l’équilibre entre les divers éléments des écologies est une recherche constante et primordiale car, comme l’analogie le montre, on appartient au territoire tout comme le poisson appartient à la rivière (Siouï Labelle, 1998).
Cette vision du monde contraste avec la grande mobilité régionale, nationale et internationale qui est normalisée, voire valorisée, au sein de nombreux États-nations. Cette mobilité illustre le fait sociologique que chaque ordre social produit sa forme de souffrance pour certains et non pour d’autres (De Courville Nicol, communication personnelle), par exemple pour une société ayant vécu de façon répétée la délocalisation, et l’autre non.
Les territoires ancestraux des Premiers Peuples des Amériques sont fréquemment rendus invisibles sur les cartes géographiques massivement en usage ; les frontières récentes des États-nations superposent ces territoires réels (voir entre autres l’atlas d’Anton Treuer (Ojibway), 2010). Cet état de fait a informé la conceptualisation du National Museum of the American Indian dédié aux peuples autochtones du nord au sud des Amériques, “recognizing that the boundaries of contemporary nation-states in no way reflected tribal cultural boundaries” (Cobb, 2005, p. 489). Alfred et Corntassel (2005) qualifient justement ce phénomène par lequel les gouvernements ont de plus en plus affirmé une autorité juridictionnelle “over Indigenous people and the territories of Indigenous nations that exist within arbitrary boundaries established by the colonial states” (p. 604).
Si le lieu est si important à l’analyse, outre son aspect identitaire, c’est qu’au Québec et au Canada aussi il s’agit d’une « relation géopolitique qui n’est pas claire[4] » selon André Michel. Selon lui, les Québécois et Canadiens en général devraient se souvenir que les Autochtones n’ont pas été conquis ; leurs territoires ont été appropriés à travers la colonisation. À cette même question de ce que les gens en visite au musée devraient savoir et apprendre, Richard Ruest (Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, président du conseil d’administration de La Maison) rappelait qu’« un Autochtone devrait être reconnu partout au Canada CHEZ LUI […] même s’il n’est pas de Saint-Hilaire, C’EST un Autochtone, il devrait être reconnu […] On est sur un territoire autochtone ici », et cette reconnaissance doit se faire quelle que soit la nation à laquelle la personne appartient. Audrey Renaud (métisse abénakise, adjointe administrative) mentionne en effet que « les frontières d’aujourd’hui empiètent sur les territoires d’autrefois », détaillant avec Chantal Millette (Québécoise, directrice générale), le territoire Abénaki allant presque du bas du fleuve Saint-Laurent jusqu’au Maine aux États-Unis. En effet, dans le cas qui nous concerne, le territoire abénaki Ndakina sur lequel se situe La Maison amérindienne comprend originellement le sud-est du Québec, le Vermont et le New Hampshire pour les Abénakis de l’Ouest, et le Maine et une partie du Nouveau-Brunswick pour les Abénakis de l’Est, les White Mountains formant une délimitation territoriale entre deux groupes linguistiquement distincts après l’an 1800 environ (Savoie, 2003, p. 4). D’une perspective autochtone, ce sont les éléments naturels qui font office de frontières, telles les White Mountains, ainsi que la rivière Richelieu, Bitawbagwizibok et le Lac Champlain, Bitawbagok, littéralement “The Lake Between” en abénaki pour les nations Abébakise et Kanien’kehá :ka (Wiseman, 2001).
Ce lien avec le territoire abénaki est présent dans les animations et les Repas du temps des sucres du musée, qui impliquent fréquemment des chants abénakis ; le chant de bienvenue « Yaweda » m’a été partagé au début de la visite du Jeudi culturel, ainsi qu’à l’entrée des espaces d’exposition lors d’une visite libre, tel que faisant partie de la procédure à La Maison. Lors de l’animation suivant un Repas des sucres, Audrey mentionnait que la rue de la Montée des Trente partant de la rivière Richelieu (Bitawbagwizibok) et montant jusqu’à la montagne, sur laquelle est sise La Maison, n’était nul autre qu’un sentier abénaki ; et que le manoir Rouville en bordure de la rivière était un lieu de campement et de rassemblement abénaki ainsi qu’une érablière auparavant. La force d’évocation de lieux connus des visiteurs, les projetant dans le passé et les enracinant dans le présent à l’endroit où ils se situent, est d’ailleurs une façon de faire souvent utilisée et utile dans le milieu patrimonial. Le toponyme abénaki du Mont-Saint-Hilaire, Wigwomadensis, la « colline en forme de wigwam [maison] », et celui de la rivière attenante, Bitawbagwizibok, sont des témoins tangibles d’un patrimoine autochtone lié au territoire. Toutefois, le lien abénaki est mentionné mais non amplifié au musée, afin de mettre en valeur toutes les Premières Nations tel que porté par la mission du musée.
Le message encodé derrière ces propos et approches au musée semble donc être la vitalité des cultures et la présence autochtone indéniable, actuelle et qui doit être davantage officialisée sur le territoire de ce qui est couramment nommé Québec, ce que les visiteurs sont invités à décoder. Les chants et toponymes partagés sont des façons capacitantes d’affirmer et de véhiculer cette présence autochtone liée au territoire.
2.2 Un lieu unique hors communauté
La situation particulière du musée localisé en dehors d’une communauté autochtone est un thème souvent évoqué par les membres de l’équipe du musée. Cette localisation unique est une force, un atout, autant pour être au service des Premières Nations, Métis et Inuits que pour la pérennité de l’organisme :
Bien le fait d’être à l’extérieur d’une communauté c’est ça qui fait que tu es là pour représenter TOUTES les communautés (Michel Noël, métis Algonquin, vice-président).
On a aussi développé une offre qui permet à des Autochtones qui vivent aussi HORS communauté et pour qui c’est bénéfique de se reconnecter avec leur nation spécifique (Chantal).
[Le musée] représente cette viabilité-là, c’est-à-dire d’être un musée autochtone situé hors communauté qui a pignon sur rue depuis 18 ans et qui fait ses frais. Son public est varié. Nous travaillons avec des Autochtones, des non-Autochtones, des Européens, des bénévoles et des personnes ayant de la déficience mentale. C’est incroyable (Chantal).
C’est le seul organisme autochtone de diffusion culturelle de cette envergure-là situé HORS réserve […] il y a quelque chose d’original dans l’approche de La Maison amérindienne (Michel N.).
Cette situation géographique joue un rôle clé dans la façon d’encoder les propos de mise en valeur de toutes les nations autochtones (principalement au Québec) dont le musée traite, et dans l’accès physique pour ses publics (celles et ceux qui vivent hors communauté, par exemple). Parfois, cette situation géographique était indirectement évoquée comme un revers de la médaille en raison de la distance géographique des communautés autochtones au Québec :
On a un problème FOU à avoir du personnel autochtone. [J’évoque le collège Kiuna à Odanak] à Odanak oui […] ils vont, ils viennent, les jeunes qui viennent travailler ici ils ont peut-être de la difficulté à s’éloigner de leur milieu (Michel N.).
Au début, les gens qui siégeaient [au C.A.] […] venaient d’assez loin, faire des réunions ça coûtait cher, il fallait défrayer le voyage […] petit à petit [les membres du C.A.] ont coopté des gens d’ici de différentes nations (André).
La notion de quatrième musée (fourth museum), incarnée par les expositions itinérantes et virtuelles d’un musée donné, permet de contourner la distance géographique des communautés et de rendre accessible le contenu muséal hors les murs selon Cobb (2005, p. 493), qui détaille l’importance du quatrième musée dans l’implantation du NMAI. La Maison amérindienne souscrit à ce principe avec sa diffusion et ses animations « nomades » étendues hors les murs (MA, 2012, page Éducation), qui sont abordées dans le prochain chapitre. Néanmoins, la position d’un musée autochtone relativement à une communauté donnée est un élément clé de son succès et de la rencontre, selon André. À la question du rôle social et du potentiel de l’institution muséale pour faire avancer les revendications autochtones, il a répondu
Que La Maison amérindienne soit le seul musée multi-nations mais surtout situé hors communauté amérindienne a une grande importance puisque son succès est dû à ça. Je passe mon temps à le dire aux décideurs, le fait que l’institution soit en dehors [d’une] « réserve », et que les Québécois ne se rendent pas facilement sur les territoires des communautés rencontrer les Autochtones, expliquent ses succès. Ils viennent « sans crainte » à Mont-Saint-Hilaire qui est une « ville bourgeoise », entre rivière et montagne. Alors, si les musées qui ont été ghettoïsés sur les territoires des communautés par les gouvernements étaient en dehors des communautés, ils auraient certainement plus de succès. La sensibilisation et la réconciliation avec les citoyens serait plus efficace. J’en suis convaincu, l’expérience vécue ici depuis bientôt 20 ans en est la preuve. Pourquoi La Maison reçoit à peu près 30 à 35 000 visiteurs par année, qu’elle arrive à s’autosuffire financièrement à 90 %, qu’elle ne reçoit à ce jour aucune subvention gouvernementale pour son fonctionnement, et alors que les autres musées autochtones plafonnent à un max de 10 à 18 000 visiteurs […] subventionnés par le conseil de bande et/ou par le gouvernement. Ils auraient beaucoup plus de visiteurs s’ils étaient en-dehors des communautés.
Il suggère donc que si les musées tribaux étaient dorénavant situés à proximité de leur communauté respective – ce qui est compatible avec le fait d’être localisé au sein du territoire, qui dépasse toujours la communauté malgré ce que l’opinion publique peut croire – ce serait davantage gagnant ; il évoque le succès du musée de Wendake en raison de sa grande proximité avec la ville de Québec. Dans la situation présente où les Québécois hésitent à aller à la rencontre de leurs voisins au sein des communautés, et où il y a des cas d’accès volontairement restreint pour diverses raisons comme au musée de Kahnawake, le message qui est encodé dans ce terrain neutre, à défaut d’un meilleur terme, aide à la diffusion et à la rencontre avec les publics. Carrément, selon Chantal, « le fait que le musée est situé hors réserve joue pour beaucoup dans la rencontre », ce qui suppose un lien indéniable entre la géographie et la mise en valeur effective du patrimoine autochtone auprès de ses publics. André évoque sa maxime, qui suppose l’importance d’une mise en valeur localisée :
Plus on parle d’un peuple plus il sera difficile de le faire disparaître. […] Si tu es à l’extérieur de la réserve et que tu parles de TON peuple, de ta communauté, de ta nation, là ça a de l’impact parce que les gens vont repartir avec un bagage et peut-être iront-ils par la suite dans ta communauté.
L’anthropologue David Howes (2003) explore le concept d’emplacement (emplacement) en tant que réaction sensorielle des gens aux lieux. Cette réalité résonne avec les non-Autochtones qui évitent l’espace délimité des communautés selon André. Pour leur part, Lonetree et Cobb (2008) détaillent la réaction des visiteurs qui sentent qu’ils sont ou ne sont pas chez eux dans l’espace des musées tribaux au sein d’une communauté. Pour beaucoup d’Autochtones, ce sont des espaces sécuritaires (safe spaces) désignés comme autochtones, des espaces de résistance et de souveraineté :
The propriety of place, the relationship of Native bodies to sites that ground identity, can be explored by examining the experience of the non-Native visiting a tribal museum. The sites of these museums, often located on reservations, help to produce narratives that are greatly influenced by the visitor’s approach and departure from the building, which often involves negotiating a Native space, a space often clearly designated as sovereign. This relationship to place, to the setting that provides a prologue for the museum’s narration, is crucial for noting the differences in the ways museums function on the reservation versus off the reservation. This is especially true for the non-Native visitor whose performance of the tribal museum can be a somewhat uncanny experience, the infelicitous experience of not belonging to a place, of being a foreigner (p. 439-440)
Telle que décrite par les autrices, la relation à l’espace est une clé pour comprendre le fonctionnement muséal selon sa localisation, et offre un « prologue » à la narration, ou l’encodage, du musée. L’expérience de visite d’un musée tribal au sein d’une communauté suggère à prime abord un sentiment capacitant d’appartenance pour la personne autochtone et un sentiment incapacitant pour la personne non-autochtone : celle-ci se sent étrangère en se situant dans le musée autochtone puis au sein d’une communauté selon Lonetree et Cobb, tout comme la personne autochtone pourrait se sentir ne pas appartenir hors communauté et dans un musée euro-américain. Il semble toutefois que La Maison compose explicitement avec cet état d’être avec sa localisation hors communauté, et son approche inclusive et hospitalière (qui n’est pas unique à ce musée) : les membres de l’équipe accueillent les gens entrant dans l’enceinte du musée par un « Bienvenue à La Maison amérindienne », et mentionnent lors d’événements que c’est la maison de tous, invitant les gens à se sentir comme chez eux. Le message encodé semble être « vous êtes dans un espace autochtone même si vous n’êtes pas situé-e-s dans une communauté, et vous êtes bienvenu-e-s dans cet espace ». L’ambiance conviviale et la réaction positive de l’ensemble des visiteurs constatée lors des Repas du temps des sucres, du Festin de crabes et du Jeudi culturel, ainsi que la composition mixte de l’équipe dirigée par des Autochtones, et l’identité autre qu’autochtone de la majorité des visiteurs sont autant d’autres éléments qui suggèrent une capacité incorporée dans ce lieu stratégique.
2.3 Lieu de bien-être
En expliquant la façon dont elles constatent le déploiement de la mission du musée au quotidien, Chantal et Audrey ont évoqué l’atmosphère de bien-être à laquelle invitait La Maison amérindienne, y compris sa boutique, ce qui fait aussi écho à la notion d’emplacement :
Une personne qui était en phase terminale, elle s’est fait amener par un bénévole en voiture. Pour venir à La Maison amérindienne, pourquoi ? Parce qu’elle se sent bien ICI, parce qu’on a su créer autour d’elle un environnement. […] c’est quelqu’un […] qui a fait le choix de venir dans notre boutique pour trouver quelque chose […] qui va l’accompagner (Chantal).
Audrey a aussi accueilli un groupe parmi lequel une jeune métisse Mi’kmaq qui a trouvé un objet en boutique utile pour aider sa mère : « juste le fait d’être ici c’est pas le PROPOS, comme le LIEU, elle se sentait bien, elle a trouvé quelque chose qui lui a rappelé ses origines, sa mère qui ne va pas bien. » Cet aspect de bien-être lié de près à la guérison spirituelle est particulièrement intéressant, du fait que le côté spirituel n’est pas mis de l’avant dans la programmation muséale, cela étant laissé au cheminement personnel de chacun-e ; des cérémonies de hutte de sudation ou des événements similaires organisés par d’autres groupes se tiennent parfois sur le site. Cette approche se distingue de plusieurs musées autochtones au Québec qui abordent ce thème comme en témoigne la revue de littérature. En mentionnant la fois où une personne est venue se reconnecter en tournant autour de sculptures dans une exposition, Chantal résume que
Ça m’est pas arrivé souvent de devoir accueillir des gens en détresse comme ça, mais c’est des lieux où des fois, des gens viennent se recharger en énergie aussi […] c’est l’environnement […] chaleureux, ce contact avec la nature si omniprésent autour de nous, la présence d’espace où les gens peuvent être libres, il y a des gens qui viennent ici seulement pour jouer du tamBOUR, pas de problème, c’est bien correct.
Elle évoque la nature environnante qui tient une place prépondérante dans la vision du monde autochtone, un environnement qui suscite un sentiment de bien-être capacitant chez de nombreuses personnes. Cet espace devient un endroit où les Autochtones sont d’emblée acceptés et leur culture respective valorisée, où elles et ils peuvent se sentir « chez eux » à leur « maison ». L’appartenance vécue au musée est, tel qu’évoqué plus haut dans l’analyse de Lonetree et Cobb, un sentiment capacitant du point de vue autochtone. Il l’est particulièrement dans un contexte nord-américain néolibéral où la gouvernance politique, empreinte d’un héritage colonial, prône l’atteinte du bonheur et la réalisation de soi en occultant les inégalités sociales. Ce sentiment d’appartenance assure une continuité d’être dans le temps, rattachée à des éléments tangibles et accessibles dont notamment la culture et le territoire, et il alimente des relations existantes ou potentielles en contraste avec la précarité de la recherche du bonheur et de la performance de la réalisation de soi (Desgagné, 2019).
L’inclusion et l’ouverture semblent aussi être des valeurs véhiculées au musée, ce qui peut en partie expliquer ce bien-être que ressentent les gens en visite. De nombreux événements et rencontres de diverses natures peuvent s’y dérouler, et Chantal se demande
dans quel musée il y a autant de showers de bébé, de mariages ou de cérémonies funéraires, oui, c’est pas nous qui les tenons, c’est les gens qui désirent venir vivre un moment spécial, vivre leur deuil […] ils vont venir ici louer les espaces parce que ils se sentent bien, ils se sentent bien accueillis, pour passer à autre chose, mais selon moi ça n’a pas nécessairement à voir avec l’autochtonie du lieu.
Cette évocation d’un lieu-maison où la perception d’un accueil et d’espaces chaleureux quelle que soit l’identité, couplée à la formule d’un lieu qui s’affiche comme autochtone et qui permet d’accueillir de nombreux visiteurs du fait de son emplacement hors réserve, propose les assises d’une réception favorable à la mise en valeur du patrimoine autochtone. Cela nous amène au prochain exemple de mise en valeur par le rapprochement social que symbolise le lieu de La Maison amérindienne selon l’équipe.
2.4 Lieu de rapprochement, de rayonnement
En détaillant les contacts qu’entretient le musée avec différentes nations et groupes, André fait appel à la mission de l’organisme : « c’est le rôle de La Maison d’être un lieu d’échanges, de partage, de rapprochement », que Chantal et Audrey mentionnent également lors de l’entrevue. Audrey a mis l’accent sur le fait que « c’est un endroit pour faire rayonner les cultures des Premières Nations pour amener plus de connaissances aux gens vraiment, c’est ça de les rapprocher » puis « pour moi c’est un lieu qui a tellement de potentiel d’amener ailleurs » en évoquant son rayonnement auprès de différentes audiences (régionale, internationale, etc.), comparant le musée à une plaque tournante. Pareillement, pour Louis-Xavier Aubin-Bérubé (Wolastoqey-Québécois, accueil et événements), le musée représente « un lieu important de diffusion pour les Autochtones ». Un autre exemple du genre de rayonnement qu’implique la présence d’un lieu physique autochtone est lors du Jeudi culturel auquel j’ai pris part avec mon fils, quand un visiteur québécois a vanté l’ingéniosité autochtone après que j’aie mentionné que mon porte-bébé, qu’il pointait, est une invention héritée des Premières Nations. L’espace invitait à ce type de conversation.
Pour Richard, l’image du musée comme croisée des chemins des diverses Premières Nations se manifeste directement en réponse à ma question sur le rôle du musée pour amener l’échange entre les peuples :
Moi ce que je veux, c’est d’approcher de plus en plus de nations, c’est d’avoir tous les drapeaux de toutes les nations devant le musée, que ça devienne un lieu encore plus rassembleur […] que La Maison amérindienne soit un carrefour pour inviter leurs membres à plus de partage.
La métaphore significative du carrefour, anciennement appelé Maison des cultures amérindiennes, représente donc un lieu où toutes les Premières Nations sont invitées à venir faire découvrir leurs particularités selon Richard : « c’est un site ouvert à TOUTES les nations […] que ce soit des Abénakis, des Wendat, des Mohawks et autres nations qui peuvent y exposer leurs artistes ». De même, Cobb (2005) définissait toute institution muséale comme “a community-centered gathering place for the celebration of living cultures” (p. 489), démontrant de ce fait le changement depuis les racines historiques de l’institution en tant que cabinet de curiosités pour devenir “museum-as-gathering-place” (p. 493) qui doit aussi faire de l’espace (make space) pour les cultures vivantes, par une approche qui tourne autour de la notion de communauté. Il y a donc, dans les propos de l’équipe sur ce que représente le musée, un rapport au lieu patrimonial très ancré dans le présent pour assurer un futur, suivant la perspective répandue des musées autochtones comme lieux de vie, évoquée par Dubuc et Turgeon (2004).
Les sentiments d’inclusion et d’ouverture émergent encore de ces propos, le musée encodant son message d’un lieu de rapprochement à travers par exemple la possibilité d’exposer son art et de mettre en valeur sa nation distincte au musée, puis de voir le travail d’autres nations exposées. En outre, le dépliant promotionnel du musée mentionne un « lieu magique […] où deux mondes se côtoient en harmonie », faisant référence à la possibilité de rapprochement entre Autochtones et non-Autochtones à travers la notion du lieu. Je reviendrai au rapprochement social, mais il apparaît que la présence d’un espace physique qui y est dédié est une précondition à ce rapprochement.
2.5 L’érablière en tant que patrimoine autochtone
L’érablière ancestrale a façonné et façonne significativement la vocation et la mise en valeur du patrimoine autochtone au musée, car La Maison amérindienne était destinée à être un musée d’art autochtone dans le Vieux-Montréal au départ. En effet, la sous-représentation et la grande compétition dans le milieu artistique l’amenaient à vouloir contribuer à une vitrine pour les artistes autochtones. Toutefois, le momentum faisant que l’érablière patrimoniale venait d’être rachetée par un promoteur immobilier, et que la ville de Mont-Saint-Hilaire envisageait une expropriation avec l’appui de la population locale pour la préserver, André Michel a alors soumis son projet de « Maison des cultures amérindiennes » de Montréal aux élus locaux. Il a été sélectionné parmi les projets d’organismes divers pour assurer l’entretien et la mise en valeur de l’érablière ; la vieille cabane à sucre, trop coûteuse à mettre aux normes gouvernementales par la ville, a été remplacée par un édifice neuf à l’architecture rappelant une maison longue. Toutefois, aucune somme ne devait être demandée à la ville pour construire et aménager les jardins. Étant donné
sa situation dans une érablière ancestrale, il a fallu trouver une manière de mettre en valeur l’érablière et en faire, pourquoi pas, un attrait qui aiderait au financement des activités éducatives. J’avais déjà un intérêt pour la cuisine […] puisque j’avais écrit un livre de cuisine amérindienne, en 1995.
En plus du souci de complémentarité avec les lieux et des intérêts culinaires du fondateur, le savoir-faire de l’acériculture est précisément hérité des Premières Nations, l’exposition permanente De l’eau… à la bouche en faisant son thème principal. En ce sens, Chantal notait que « l’animation thématique autour des sucres et l’origine, ça, ça ne change pas, c’est le cœur de notre mission » en discutant des représentations autochtones qui avaient changé au fil du temps au musée.
Ma visite du site et de l’érablière était informée du fait de cet héritage, de cette origine : la présence autochtone était évoquée d’abord par les animations lors des Repas du temps des sucres débutant sur la terrasse extérieure, autour du grand chaudron entouré de raquettes de babiche, pendant la dégustation de la tire, puis par les petits capteurs de rêves accrochés à des branches réalisés lors d’un atelier familial du musée, et par les sculptures d’animaux emblématiques (ex. : un ours) et d’un Autochtone bandant un arc, ainsi que les structures en bois de wigwams à l’entrée du site. Pour ne pas répéter les textes de l’exposition permanente, les panneaux du sentier d’interprétation dans l’érablière n’évoquent toutefois pas directement l’origine autochtone de ce patrimoine, détaillant plutôt le travail et les défis d’entretien d’une érablière. Un sentiment de gratitude et de communion émergeait de cette visite : d’être présente dans un petit îlot de nature surplombé par la montagne à proximité, me tenant dans un espace qui a pour but la valorisation des Premières Nations, entouré de part et d’autre par des quartiers résidentiels. Le commentaire de Chantal sur l’environnement chaleureux et le « contact avec la nature si omniprésent » entourant le musée fait écho à cette visite. Michel Noël en faisait aussi état en mentionnant le caractère unique de La Maison amérindienne, « avec tout l’environnement et l’érablière », suggérant un caractère original participant au succès du musée, reconnu comme « lieu de référence national des Produits de l’érable pour l’origine de l’acériculture » (MA, 2012, page d’accueil).
Le patrimoine autochtone qui est mis en valeur au musée est donc d’abord ancré dans son lieu d’origine et ses racines (littéralement), explicitant les liens identitaires intrinsèques au territoire. Le mouvement de rapatriement amorcé depuis les années 1980, et la position de Vernier (2016) et Dubuc et Turgeon (2004) sur l’importance de préserver le patrimoine dans son lieu d’origine, montrent que le patrimoine de l’acériculture prend son sens avec la mise en valeur de cette érablière située en territoire ancestral abénaki. Considérant les nombreux objets des cultures autochtones éparpillés et exposés un peu partout à travers le monde comme l’anthropologie muséale en fait état avec force critique, il apparaît évident d’entretenir une relation marquée entre un patrimoine donné et son lieu d’origine : le Musée des beaux-arts de Sherbrooke est à Nikitotegwak/Sherbrooke, le musée Victoria & Albert est au cœur de Londres, La Maison amérindienne est au cœur d’une érablière en territoire autochtone où ce type de culture est historiquement présent.
Encore, en appuyant sur l’importance du lieu d’exposition de créations d’élèves inuits participant à son projet pédagogique Design et culture matérielle, Kaine (2004) établit que ce lieu doit être signifiant pour les visiteurs et les exposants, et cohérent quant à son contenu exposé : « en fait, le lieu lui-même doit être un vecteur de transmission de la culture actuelle » (p. 152). La Maison amérindienne officialise l’origine indigène de l’acériculture à travers l’érablière et la programmation de son institution in situ, et transmet sa pratique ancienne et moderne à la fois aux Premières Nations et aux Québécois en visite. Ce savoir fait en effet partie des cultures abénakise, mohawk, attikamekw, algonquine, micmaque (et plusieurs autres, ma connaissance étant ici limitée) et québécoise. En outre, Nicole Obomsawin, ancienne directrice du Musée des Abénakis, conteuse, conférencière et militante pour les droits des femmes et l’environnement, souligne que l’érable relève du travail familial, en contraste avec le maïs qui est traditionnellement la tâche des femmes (2015, 48:00). Enfants et adultes avaient chacun leur tâche dans le processus générant les produits de l’érable, et ce travail historiquement communautaire est en lien avec la mission sociale de rapprochement et l’ambiance familiale du musée-maison sis dans l’érablière.
En parallèle à la signification spatiale dont il est question ici, l’implantation du National Museum of the American Indian y a porté une attention particulière. Il reconceptualise carrément l’espace selon Cobb (2005, p. 492) : ce musée a non seulement une architecture curvilinéaire qui suggère et s’intègre à l’environnement naturel suivant une vision du monde autochtone, il est entouré d’habitats organisés abritant plus de 150 espèces végétales indigènes rappelant les racines territoriales et le savoir-faire des Premiers Peuples, et il est situé le plus près du Capitole par rapport aux autres bâtiments du National Mall, “both symbolically and physically reclaim[ing] Washington, D.C., as Indian Country” (p. 490). On peut donc dire que La Maison amérindienne s’est intégrée directement à l’environnement et l’a réclamé comme autochtone à travers sa programmation.
La présence et le maintien de cette érablière ancestrale propose enfin une mise en valeur distincte quant aux pratiques muséales de conservation et d’exposition plus standard. Louis-Xavier souligne cette particularité : « Nous avons la chance d’avoir une érablière ancestrale qui fait partie de notre patrimoine que nous luttons pour conserver. » Envisager l’ensemble de l’érablière comme patrimoine à protéger – le thème de l’exposition temporaire du printemps 2019, Nipatau la nature. L’art de tuer la Nature, en raison de l’augmentation de sentiers et de déchets sur les lieux dus à la fréquentation humaine – nourrit chez l’équipe et les visiteurs le sens des responsabilités quant à un ordre écologique dépassant l’institution muséale. Cette vision diffère des pratiques plus traditionnelles axées sur l’objet conservé dans des réserves ou restaurant exclusivement les bâtiments patrimoniaux abritant les musées. Cette perspective se rapproche de la pratique d’institutions telles le Jardin botanique avec le Jardin des Premières-Nations qui diffuse les traditions et le savoir-faire autochtones (Espace pour la vie, s.d.), ou les habitats d’espèces végétales du NMAI.
À la lumière de ces résultats, l’espace physique du site du musée avec l’érablière est essentiel et constitutif de la mise en valeur du patrimoine autochtone, et il témoigne d’une relation harmonieuse entre patrimoine et lieu d’origine. Cet espace souhaite honorer ses liens à l’écologie qui l’anime, inciter au rapprochement et au bien-être de ses visiteurs et partenaires dans le présent, et se positionne stratégiquement hors communauté pour rejoindre les Autochtones de diverses nations tout comme les non-Autochtones. Je vais à présent observer comment le fonctionnement de cet organisme interagit avec la mise en valeur du patrimoine autochtone.
3. Aspect organisationnel : le musée et ses publics
L’aspect organisationnel de La Maison amérindienne est particulièrement pertinent à l’analyse car, comme en faisait état son contexte sociohistorique, ce musée agit au sein d’un mouvement global de réappropriation patrimoniale et d’indigénisation d’un type d’institution originellement occidentale ayant participé et participant au colonialisme. Cet organisme est né de l’effort collectif de membres de diverses Premières Nations, du fondateur d’origine française et de ses partenaires québécois et d’autres origines ; et la composition de son équipe et de ses publics incarnent cette diversité. Je vais observer ici comment la nature de l’organisation, son fonctionnement décisionnel axé sur la collaboration entre Autochtones et non-Autochtones et les partenariats, ainsi que la dynamique de diffusion auprès de ses publics interagit avec la mise en valeur du patrimoine autochtone auprès d’un vaste public.
Un constat saisissant ressort des propos des participant-e-s et de mes observations. Le succès de l’équipe à faire rayonner, maintenir et faire cheminer l’organisme malgré ce que je nomme les blocages (structurels, sociaux, du milieu culturel et muséal) est impressionnant. Il en ressort que la mise en valeur du patrimoine autochtone est facilitée par un savoir-faire de l’organisme, par son adaptation et sa résilience marquées, ainsi que sa diffusion et ses relations publiques variées. En même temps, le souci de pérenniser l’organisme était un thème partagé par la plupart des participant-e-s. Je donne un avant-goût de ces sous-thèmes organisationnels à travers le contexte entourant la création du musée, sa mission et son fonctionnement interne.
3.1 Naissance de l’organisme
André Michel raconte son apport quant à la fondation du Musée Shaputuan en 1998, le musée innu de Uashat dont la mission est le dialogue et le rassemblement, et partage la réflexion qui en est née :
C’est là, le jour de l’ouverture, que j’ai réalisé que sans le vouloir j’avais accentué la division entre la population non-autochtone de Sept-Îles et la population innue puisqu’au vernissage, à l’ouverture officielle, il y avait plein d’Autochtones, nous n’étions que trois Blancs : le maire de Sept-Îles, la ministre [de la Culture et des Communications de l’époque] Louise Beaudoin et moi. Le musée autochtone était à quelque part boudé un peu par les Blancs et je me suis dit, les gens au Québec ne sont pas faits pour vivre en parallèle mais en complémentarité, donc il faut construire des musées autochtones hors réserve, hors communauté, et c’est de là qu’est venue l’idée de La Maison amérindienne.
Initialement destinée à se situer rue de la Commune dans le Vieux-Montréal, La Maison amérindienne a vu le jour à Mont-Saint-Hilaire selon un concours de circonstances : l’élément déclencheur a été en effet la pression citoyenne et d’André pour préserver l’ancienne érablière sise à l’actuel emplacement du musée, et faire exproprier par la Ville le promoteur immobilier ayant acquis le site, ouvrant la voie aux possibilités pour les organismes de proposer leurs projets. Les contacts d’André auprès du maire d’alors qui le soutenait, du Fonds des Travailleurs du Québec et de syndicats, l’expérience concluante dans la création du Musée des Beaux-Arts de Saint-Hilaire que l’artiste avait pilotée, et l’autonomie financière du projet pour sa construction ont joué en la faveur de La Maison amérindienne. Un bail emphytéotique de 49 ans a été signé avec la Fondation Ushket-André Michel.
La construction s’est réalisée non sans opposition, notamment d’un groupe d’opposants très virulent qui martelait « on n’a rien contre les Indiens mais pas à Saint-Hilaire » (André), menaces anonymes incluses et même intimidation du fils de l’artiste à l’école (en entrevue avec Labrosse, 2018). Le musée a donc vu le jour « contre vents et marées » (André) sans soutien financier provincial ou fédéral de programmes normés et quelque 30 000 visiteurs sont passés à La Maison la première année de son ouverture en 2000 (DesChâtelets, 2013) ; la tendance se maintient depuis.
3.2 Mission du musée
La valorisation du patrimoine autochtone passe évidemment par sa mission d’être un « lieu d’échanges, de partage et de rapprochement des peuples » pour amener une meilleure connaissance des Premières Nations (MA, 2012, page d’accueil). Par exemple, la réussite de la mission au sens de Louix-Xavier est effective « lorsque nous organisons des spectacles, conférences, événements où les gens ont des rencontres enrichissantes avec des membres des Premières Nations » et pour Michel Noël, lorsqu’il y a des contacts, qu’il y a échange verbal. S’inspirant de l’approche de De Courville Nicol (2011), on pourrait associer les trois caractéristiques de la mission à des normes émotionnelles dans l’espace social global, que je définis comme renfermement/partage comme in/capacité à être dans une dynamique de réciprocité, égoïsme/échange comme in/capacité à donner une partie de soi, et éloignement/rapprochement comme in/capacité à tisser des liens avec autrui. À travers son action, le musée vise évidemment les formes de capacité qui permettent de s’éloigner des conséquences sociales du renfermement, de l’égoïsme et de l’éloignement.
La mission du musée se décline concrètement, ou son message est encodé à travers ses volets artistique, environnemental et gastronomique : « on met en valeur le volet gastronomique, le volet artistique, les valeurs environnementales […] pour chacun des volets, tu as des conférences, des expos » (André). À propos du volet environnemental, les pratiques du musée véhiculent le principe autochtone de prendre ce dont on a besoin, ni plus ni moins : toutes les lumières sont éteintes en fin de journée et lorsqu’une salle est inutilisée de jour (y compris les salles d’exposition et la salle de bains) ; le papier est recupéré pour faire des pense-bête plutôt qu’en acheter ; la préparation des Repas des sucres se fait sans acheter plus de nourriture que pour la quantité de personnes attendues (Chantal) ; la télévision projetant le documentaire sur le temps des sucres attikamekw demeure éteinte en l’absence de visiteurs dans l’exposition permanente. J’étais invitée à l’allumer et la fermer moi-même lors de mes visites. Lors des Repas, on demandait aux convives s’ils désiraient emporter leurs restants de nourriture. Même la visite de l’érablière avec les groupes, qui permet évidemment d’aborder l’origine du sirop d’érable, sert à mettre en valeur les principes environnementaux autochtones selon une « approche circulaire » parlant du « cercle de la vie », des « quatre directions », et porte une conscience environnementale « en termes d’utilisateur de l’espace » (Chantal).
La présence marquée de l’érablière autour du musée, de ses jardins, de plantes dans la salle d’accueil, et même de feuilles séchées dans l’exposition permanente sont autant de rappels de l’ordre écologique habitant l’univers des Premières Nations. Toutes les formes de vie sont reconnues et autant respectées que ce qui est humain suivant cet ordre écologique : dans l’exposition C’est notre histoire présentée au Musée de la civilisation à Québec, une citation de Della Adams (Kanien’kehà :ka) résume cette vision du monde : « Nous croyons que les animaux et les plantes ont un esprit, tout comme nous. On n’est pas plus importants qu’eux sur Terre » (MCQ, 2013). Un grand nombre de représentations d’animaux – peintures, illustrations, sculptures, taxidermie – est donc présent au musée, et les animations abordent très souvent la symbolique des animaux chez les Premières Nations : le loup et la loyauté, l’orignal et la générosité, l’ours et la sagesse, par exemple. Les gestes et visions du monde écologiques encouragées par l’équipe du musée, individuellement et collectivement, ou encore cet encodage muséal, semblent capacitants en ce qu’ils poursuivent la valeur autochtone fondamentale du respect envers toute forme de vie. En effet, il semble y avoir une capacité incorporée pour les employés du musée à pratiquer et encourager ces gestes écoresponsables, ce savoir-être autochtone, ainsi qu’une capacité pour les visiteurs qui apprennent, constatent ou vivent déjà ce savoir-être.
Le volet gastronomique est très présent dans le choix des activités, que ce soit aux « Repas amérindiens du temps des sucres », la dégustation de thés, tisanes et collations au café Mishtan, le « cassoulet amérindien » à l’automne, l’activité de levée de fonds du Festin de crabes au printemps organisé avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, ou la vente de tarte sans croûte d’inspiration attikamekw ; la cuisine du musée et le café Le Mishtan (extérieur ou intérieur) sont fonctionnels à l’année. Cette mise en valeur gastronomique est aussi palpable dans les thèmes d’exposition (le sirop d’érable, le maïs…) et les affiches illustrées de la salle d’accueil (“Berries”, “Indian Corn of the Americas”…). C’est une mise en valeur d’un patrimoine gustatif qui est organisée respectivement par la dégustation et l’évocation, qui met de l’avant le savoir-faire culinaire autochtone.
L’application continue de ce volet à La Maison, qualifié de « musée qui se déguste » dans le dépliant promotionnel, se distingue des pratiques muséales traditionnelles qui, dans le cas général de plus grandes institutions, réservent un espace dédié de type café ou cafétéria à des fins pratiques, rarement de mise en valeur du patrimoine ; ou qui, selon les standards de conservation, évitent tout contact avec la nourriture étant donné l’environnement contrôlé des collections par crainte d’attirer des insectes nuisibles. Cela montre que l’un n’exclut pas l’autre et suggère une approche adaptée et intégrative dans la façon de mettre en valeur le patrimoine autochtone. C’est le cas au NMAI avec son Mitsitam Native Foods Cafe (du Piscataway, “Let’s Eat”) qui symbolise les valeurs autochtones de communauté et d’hospitalité avec ses plats traditionnels provenant de cinq régions géographiques, et qui contribue à la mission “as a place of contemporary cultural continuance” (Cobb, 2005, p. 493). Le Mishtan est pensé relativement à la mission du musée, sa page de présentation sur le site internet résumant : « Un rendez-vous dans un lieu unique et inspirant, né du désir d’échanges, de partage et de rapprochement des peuples à travers l’expérience gastronomique… » (MA, 2012, page Café Le Mishtan). Je détaillerai ce volet gastronomique plus loin dans la section sur l’aspect multisensoriel du musée, mais on peut déjà constater la notion de partage, de rassemblement et de plaisir à découvrir entourant la nourriture qui est mise en valeur.
Quant au volet artistique présenté au musée, les représentations artistiques ont pour but de « faire connaître les artistes autochtones et métis contemporains afin d’instaurer un dialogue sans délaisser pour autant la démarche artistique », ainsi que de « faire comprendre le contexte social » actuel des Autochtones (MA, 2012, page Expositions temporaires). Le dépliant promotionnel définit les expositions temporaires d’artistes autochtones comme « L’art de créer des liens ». Le volet artistique passe par la diffusion d’œuvres d’artistes autochtones au Québec et d’ailleurs, et à l’occasion par l’intérêt et l’engagement artistique exceptionnel d’artistes non-autochtones. Dans le premier cas, l’exposition Essence d’un peuple de Joyce Panadis, artiste abénakise d’Odanak, présentait des œuvres au graphite ayant pour thème l’identité, et la série de spectacles annuelle « Découverte autochtone » en partenariat avec le centre culturel de Beloeil mettait en scène entre autres les musiciens Twin Flames (Inuk Mohawk et Algonquine/Crie), Kathia Rock (Innue), Laura Niquay (Attikamekw) et les Buffalo Hat Singers (nations multiples) pour la série 2018-2019.
Dans le deuxième cas, l’exposition La célébration du beau présentée en été 2018, qui s’inscrivait dans les 70 années du manifeste québécois du Refus Global, mettait de l’avant les sculptures animalières en bronze de Jean-Paul Riopelle et la relation profonde qu’entretenait l’artiste avec les cultures des Premières Nations. La feuille explicative de l’exposition mentionne son approche, « La nature, un modèle », thème récurrent malgré la quantité importante de médiums explorés par l’artiste. Le livre de Guy Sioui Durand (Wendat) accompagnant l’exposition et portant sur l’œuvre de Riopelle affirme que l’artiste réalise l’éthique autochtone, ce qui encode un message sur le rapprochement possible entre peuples. Cette exposition établissait un parallèle avec l’exposition temporaire précédente du peintre naturaliste vénézuélien Amneris Fernandez avec ses toiles nées d’un émerveillement pour les animaux nord-américains s’adaptant ingénieusement au climat nordique – le loup, l’ours, puis le lynx. Cette mise en valeur d’autres formes de vie est l’expression encore une fois de la pensée autochtone non anthropocentrique, que l’on retrouve cette fois exposée par des non-Autochtones.
La valorisation est donc explicite quelle que soit la thématique abordée, ou même implicite. Par exemple, malgré que Nomades ou itinérants : peuples en danger, en partenariat avec l’Écomusée du Fier Monde, sensibilise fortement au phénomène alarmant et grandissant d’itinérance-nomadisme autochtone à Montréal, les peintures ethnographiques d’André Michel présentent les Autochtones dans toute leur dignité, tête haute et regard franc, que l’artiste a côtoyés dans les rues de Montréal avec l’appui de Centre d’amitié autochtone. Le nom de chaque personne est inscrit sur une vignette à côté de son portrait, enlevant l’anonymat souvent associé à l’itinérance. Des objets utilitaires du mode de vie traditionnel innu tels un hochet, un canot et des mocassins sont ensuite exposés, ce qui nuance un discours seulement axé sur la perte que présente l’itinérance et montre aussi l’incroyable savoir-faire à perpétuer.
En somme, la mise en valeur généralement intrinsèque au principe d’exposition de tout musée est au cœur de la mission de La Maison amérindienne avec le « langage » et les « codes » propres à ses volets gastronomique, environnemental et artistique. Parallèlement au travail patrimonial de plusieurs institutions autochtones dont l’Alaska Native Heritage Center qui est défini comme un site d’échange culturel, de célébration et d’éducation, la préséance est donnée au succès – la reconnaissance publique, la survie – plutôt qu’au colonialisme et à la marginalisation, non moins réelles, dans les représentations pédagogiques (Clifford, 2004, p. 21), ou plutôt qu’aux leçons et au révisionnisme (Cobb, 2005). Au même titre que l’accent sera mis sur la guérison et l’atteinte d’équilibre plutôt que la maladie selon une vision du monde autochtone. Voyons à présent l’organisation derrière le déploiement de la mission de La Maison amérindienne.
3.3 Fonctionnement interne
La Maison amérindienne est dirigée par un conseil d’administration composé exclusivement de cinq membres autochtones obligatoirement de nations différentes depuis le jour de son ouverture. Elle réalise ses activités par le travail de sa petite équipe terrain – directrice générale, adjointe administrative, animateurs et animatrices, chargé des événements spéciaux – d’origine culturelle variée (au moment de la rédaction, ils sont métis, des Premières Nations et Québécois). Des bénévoles s’impliquent également dans les activités du musée. Lorsqu’un-e membre du C.A. quitte son poste, deux membres sélectionnent un nouveau ou une nouvelle candidate d’une nation différente afin d’éviter de « tire[r] la couverture de son côté » s’il y avait deux membres d’une même nation, « et ça fonctionne bien. C’est une manière d’aller à l’encontre des préjugés, des clichés […] Ils gèrent bien. Aucun emprunt, aucune demande de marge de crédit, aucun déficit en 18 ans » (André). Cette politique organisationnelle concrétise le souci d’inclure et de représenter la diversité des Premières Nations tout en contrant les préjugés des non-Autochtones en matière de gestion organisationnelle.
André mentionnait aussi, à propos du C.A. autochtone dès l’ouverture du musée : « comme je suis très présent à faire du bénévolat quasiment tous les jours, il y a des gens qui pensent que c’est moi qui gère ça, j’ai dirigé bénévolement pendant 10 ans, mais le C.A. je n’y ai jamais siégé, ce ne sont que des Autochtones de cinq nations différentes ». Il semble que la politique de recrutement des membres du C.A. ainsi que la composition de l’équipe de travail, que l’on pourrait qualifier de travail patrimonial collaboratif entre Autochtones et non-Autochtones soient explicites à l’interne. Tout visiteur ou partenaire ne connaissant pas l’équipe et l’organisation du travail au musée et qui se référera au site Internet, verra le détail du travail fondateur d’André et son parcours. En raison de la visibilité de l’artiste et de ses réalisations muséales et artistiques, le premier C.A. de La Maison l’a mis de l’avant sur la page d’accueil tout en mentionnant clairement que le conseil d’administration est exclusivement composé d’« Autochtones de diverses nations » (André et MA, 2012, page d’accueil). Cette information peut avoir un double sens : montrer d’office un travail de collaboration, d’échanges, de partage et de rapprochement entre Autochtones et non-Autochtones, mais aussi soulever les questions suivantes : qui compose l’équipe et qui sont les membres du C.A. ? De quelle nation sont ces membres du C.A. ? Quelles sont les valeurs qu’ils mettent de l’avant dans leur travail ? Comment travaille l’équipe pour mener à bien une telle mission inspirante ? Depuis plusieurs mois au moment de la rédaction, la mention des membres du C.A. est planifiée lors de la reconfiguration du portail officiel du musée. Ensuite, le document-clé Engagements et Valeurs du musée met de l’avant le respect, l’engagement, l’esprit d’équipe et la complicité, ainsi que la responsabilisation comme principes. Ces informations semblent effectivement bénéficier à être communiquées explicitement sur le site Internet et le groupe Facebook à l’intention de publics et de partenaires actuels et potentiels. Cette approche positionne davantage publiquement une autorité partagée et la diversité de l’équipe, qui s’enlignent avec l’idéal collaboratif entourant le patrimoine autochtone. Elle pourrait contribuer au positionnement de La Maison amérindienne comme modèle muséal d’un « lieu multi-nations » (MA, 2012, page d’accueil).
Si le musée tribal est vu comme porteur d’une nouvelle muséologie par Dubuc (2006) et Dubuc et Turgeon (2004), La Maison amérindienne travaille effectivement à indigéniser, « tout le temps autochtoniser » ce qu’elle fait selon Michel Noël, notamment à travers l’identité et le travail de son personnel. La gestion de collection ne diffère pas particulièrement des normes muséales de conservation, sinon que la politique de conservation est logiquement axée sur les matériaux surtout (ex. : cuir) qui caractérisent les collections d’objets autochtones. La collection du musée s’agrandit et repose principalement sur le côté « ethnographique, un peu plus historique pour documenter » (Chantal) ; ce sont par exemple des tambours, des paniers de frêne abénakis, des plumes cérémonielles, des fourrures ou des mocassins. Le musée fait également l’aquisition d’objets fabriqués par des artisans et artistes autochtones contemporains, par exemple la collection de fancy shawls pour la danse du papillon datant d’environ 2013 (Chantal). Conjointement à l’achat d’art et artisanat autochtone pour vendre en boutique, cela inscrit encore l’action patrimoniale du musée dans le présent, en lien avec le passé et le futur et en relation avec les membres des Premières Nations. Il n’y a pas de protocole de collaboration officiel entre Autochtones et non-Autochtones au sein du fonctionnement du musée tel qu’on pourrait l’assumer avec la nouvelle muséologie autochtone ; Louis-Xavier confirme toutefois à travers son expérience à La Maison « que nous essayons le plus possible d’inclure les échanges et partages entre Autochtones et non-Autochtones ». En réponse à cette question de la présence d’un protocole interne, Chantal explique que sa façon d’échanger diffère plutôt, en tant que gestionnaire, selon la personne avec qui elle développe un partenariat, par exemple avec les artisans en provenance des communautés avec qui elle peut avoir une négociation extensive : « c’est une approche distinctive disons, qui est différente, et qui se passe plus dans l’échange, dans la connaissance et le respect de l’autre, en fait dans la tradition. »
Les représentations du musée sont surtout liées à son personnel et ses connaissances : Chantal explique qu’Audrey étant métisse abénakise, « c’est clair que c’est plus facile pour elle d’aborder ces sujets-là », et que Louis-Xavier amène son bagage culturel Wolastoqey dans son travail. Ainsi, l’idée est de passer « le message général » en s’appuyant « sur un levier sur lequel on se sent confortable ». La mise en valeur est encodée aussi à travers le savoir et la position propre au personnel, capacitant émotionnellement l’équipe en reconnaissant d’emblée son bagage. Il m’apparaît aussi comme une particularité d’indigénisation de l’institution muséale occidentale traditionnelle que d’avoir le souci, à La Maison amérindienne, de « développer nos gens à l’intérieur » (Chantal) à travers leur expérience de travail ; le document Engagements et Valeurs stipule, sous la valeur d’esprit d’équipe et de complicité, que La Maison « encourage la complicité dans l’atteinte des objectifs en tenant compte de chacun ». De nombreuses institutions muséales abordent peu cet aspect dans leur fonctionnement interne officiel. Il se dégage de cette forme d’organisation les valeurs d’inclusivité et de diversité personnifiée par tous les acteurs du musée. Ici aussi, il apparaît qu’officiellement expliciter cette approche « levier » et collaborative entre Autochtones et non-Autochtones en mettant en valeur l’identité du personnel sur les plateformes de présentation du musée (site Internet, Facebook) puisse apporter un rayonnement augmenté des cultures des Premières Nations et montrer un exemple fonctionnel de collaboration muséale au quotidien. Louis-Xavier associe pour sa part les représentations récentes des Premières Nations au musée aux nombreuses expositions et événements qui y ont cours : d’abord l’exposition au moment de notre échange – sur la culture abénakise par l’art de Joyce Panadis – puis des représentations des nations Wolastoqiyik « du fait que nous avons eu plusieurs événements en lien avec cette nation. Repas, concerts, conférences. » et Innue « étant donné les liens d’André avec cette nation. »
Les valeurs fondamentales autochtones sont encodées dans le fonctionnement de La Maison, comme le volet environnemental en témoignait. Notons son travail patrimonial qui implique largement la notion relationnelle de continuité temporelle, comme en témoignent l’exposition et la conservation du travail d’artistes contemporains, les concerts, les conférences et ateliers avec des spécialistes autochtones, et la mission orientée vers un rapprochement des peuples. Cela contraste avec plusieurs musées euro-américains opérant un récit chronologique souvent limité à « avant aujourd’hui », oblitérant de ce fait cette continuité. C’est comme si cette forme de narration muséale ne valorisait que le passé de ses aïeux en laissant de côté les liens avec le présent et l’avenir, éléments par ailleurs réservés à d’autres institutions d’art actuel ou contemporain, par exemple. Utilisée adéquatement ou piètrement, l’exposition en tant que média rend néanmoins compte du passé dans le présent, et quoiqu’elle représente, elle actualise aussi selon Soulier (2015).
La reconnaissance d’une continuité temporelle dans les discours et récits des animations et des textes d’exposition est aussi présente : ces récits oscillent entre passé et présent à la manière de certains récits de tradition orale tel que détaillé par Trimble (Oglala Sioux), Sommer et Quinlan (2008), établissant non pas une coupure temporelle mais une continuité et une interconnexion quant aux savoir-faire, nations, lieux, toponymes et autres éléments reliés à la culture des Premières Nations. Audrey mentionnait lors d’une animation sur l’acériculture : « On prenait les sceaux […] quand les bulles de sirop collent lorsqu’on souffle à travers la grande cuillère percée d’un trou, c’est signe que le sirop est prêt ». Il était aussi mentionné par exemple que le kayak est toujours utilisé par les Inuits dans leurs activités quotidiennes, ou que le mode de pensée circulaire et cyclique hérité des temps anciens concerne aussi les visiteurs qui entrent par la porte de La Maison amérindienne, puis vont repartir à la fin de leur visite. Cela suit la position de Dubuc et Turgeon (2004) qui, dans l’article « Musées et Premières Nations : la trace du passé, l’empreinte du futur », détaillent le musée en tant que lieu de vie au service des collectivités, créant des ponts entre passé, présent et avenir. Même la vision autochtone des objets de musée n’est pas celle de témoins du passé mais plutôt d’objets porteurs d’histoires et de la continuité d’une culture, comme le détaillait Clavir (2002) et comme en témoigne la pratique de La Maison d’acquérir des objets récents. En ce sens, le travail patrimonial de La Maison dans le présent contribue à assurer un futur où il y a une meilleure connaissance et un rapprochement social entre peuples.
Est donc valorisée auprès des visiteurs une autre façon de décoder et de vivre le temps. Le fonctionnement interne unique au musée contribue en lui-même à la mise en valeur des cultures des Premières Nations. Les prochaines sections concernent ce fonctionnement en action et en relation aux autres institutions culturelles, de l’éducation, etc.
3.4 Savoir-faire de l’organisme
Les membres de l’équipe témoignent de l’avant-gardisme du musée depuis ses débuts quant à la question des relations sociales et de la valorisation des Premières Nations au Québec :
[…] c’est pour ça [l’intérêt et la sensibilisation au Québec] qu’une Maison amérindienne a sa raison d’être, a été pensée, mais là, enfin on arrive à ça dans l’espace public. Déjà, il y a cinq ans, nous avons lancé au Canada et déposé à l’Assemblée Nationale du Québec une pétition bilingue pour faire du 21 juin, Journée nationale des Autochtones, un jour férié comme le 24 juin, la St-Jean-Baptiste ou le 1er juillet, la Fête du Canada. On était déjà en amont, on a toujours été en avant de toutes ces actions-là. La Maison est depuis sa création un lieu de réconciliation, bien avant que ce mot devienne populaire. Si on a pu aider hé bien tant mieux (Chantal).
Le musée c’est une tête de pont. […] disons que t’es à la guerre, à un moment donné tu as une équipe qui ouvre la route, qui permet aux autres d’avancer, ça s’appelle une tête de pont. C’est possiblement le seul organisme hors réserve qui a son autonomie, qui fonctionne bien […] (Michel N.).
[…] sur divers volets que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau gastronomique, au niveau social, La Maison amérindienne joue un rôle qu’aucun autre musée ne joue (André).
Cet avant-gardisme suggère un défi de positionnement pour l’organisme à travers le paysage social, muséal et culturel, mais qui lui a valu plusieurs reconnaissances telles le lieu de référence national des Produits de l’érable pour l’origine de l’acériculture par la Commission de lieux et monuments historiques du Canada, ou la mention officielle d’Entreprise culturelle d’économie sociale. Ensuite, le musée a aussi développé une expertise par l’organisation de travail et l’action quotidienne de son personnel, expertise qui gagne à être connue et soutenue financièrement :
Le musée amérindien a une très très belle programmation, très diversifiée, et puis je trouve que ça été bien conçu dès le départ avec cette salle d’exposition qui est très très mobile, avec la cuisine […] (Michel N.).
Le personnel va jouer un RÔLE efficace et plus lié à ses connaissances […] (Chantal).
Ça va faire bientôt 20 ans qu’elle est là. Elle passe à travers les années. Son C.A. n’a jamais emprunté, jamais demandé de marge de crédit à une banque, pas de dettes, ils ne sont pas riches, mais selon moi tout le monde est très mal payé même si tout le monde travaille beaucoup. Elle a remporté de nombreux prix (André).
À ce jour la reconnaissance du travail fait n’existe pas vraiment chez les décideurs, c’est comme ça : [donne une petite tape sur l’épaule d’Audrey avec un sourire entendu.] […] Encore dernièrement au Festin de crabes malécite il y avait beaucoup de monde présent pour dire « good job, continuez » on se fait dire par le ministre présent et le maire de notre ville à qui un bâtiment construit au coût d’un million cinq cent mille, sans hypothèque, a été remis ! La Maison est un organisme qui a une très bonne réputation et attire énormément de gens. C’est notre récompense ! (Chantal)
Ils sont venus me chercher pour que j’applique la même recette au Musée des Beaux-Arts parce que la performance de La Maison amérindienne était extraordinaire. Les instances gouvernementales devraient consolider ce qui est là, ce qui a permis de développer une expertise (Chantal).
Le musée s’autofinance effectivement, contrairement à la majorité des institutions muséales subventionnées au Québec, reconnues et/ou soutenues. Au moment de la rédaction, l’institution obtenait son agrément par le gouvernement après presque vingt années d’existence, et des négociations étaient en cours pour que la Ville s’implique financièrement auprès de La Maison amérindienne, comme elle le fait déjà pour son Musée des Beaux-Arts. André ajoute : « La ville devait s’impliquer financièrement pour une aide au fonctionnement, comme pour le musée, après deux années de fonctionnement. Malheureusement ce n’était pas écrit dans le bail. » L’Osage Tribal Museum, l’un des musées tribaux précurseurs aux États-Unis, peinait à s’établir comme institution autochtone en s’éloignant d’un modèle ethnographique et d’histoire naturelle fermement établi dans le monde occidental. Selon ce modèle, les légendes de création autochtones n’étaient pas des « témoins » tangibles de documentation, l’histoire orale était peu crédible, et le passé était privilégié par rapport au présent (Boxer, 2016). La nouvelle muséologie autochtone (Dubuc, 2006) s’est sans conteste déployée et fait reconnaître davantage qu’au temps de l’Osage, mais il est à se demander si, à l’instar de ce dernier, et puisqu’unique en son genre au Québec et au Canada, La Maison vit ce défi similaire. Elle doit se distinguer et faire financer son modèle de musée multi-nations hors communauté par rapport aux musées tribaux et traditionnels occidentaux ; elle est pourtant reconnue publiquement pour son savoir-faire. L’article de De Julio Paquin (2007) dans Vie des Arts met effectivement en exergue, outre les « nombreuses révélations que vous réserve La Maison amérindienne », « un des points forts de ce centre d’exposition et d’interprétation est son programme d’animation destiné à un public scolaire » qui offre « une information inédite sur l’histoire » des Premiers Peuples (p. 60).
La contradiction entre reconnaissance capacitante et sous-financement incapacitant, la présence des blocages n’en sont que plus frappantes, et l’insatisfaction entourant la question d’un financement équitable, fréquemment abordée dans les propos de l’équipe du musée, est palpable. Ainsi, Chantal estime que ce « qui serait important actuellement, ce serait de pérenniser des lieux qui ont déjà développé une expertise, qui font un travail remarquable avec peu de moyens, pour leur donner les moyens d’encore mieux rayonner, pas être bloqués financièrement ».
3.5 Relations publiques et diffusion
Chantal mentionnait fréquemment des partenariats entre institutions et a souligné l’importance de « garder les relations déjà établies » avec divers musées, communautés des Premières Nations, artisan-es autochtones, municipalités, centres d’amitié autochtones, collège Kiuna et écoles, Projets Autochtones du Québec, et plusieurs autres. Implicites à sa mission, les contacts et les relations publiques sont essentielles au maintien du musée selon l’équipe :
Je pense qu’elles sont très bonnes [les réactions du public], parce que il y a un public fidèle, il y a ceux qui reviennent à chaque année, on a les amis de La Maison amérindienne, il y a des membres, il y a des gens qui nous aident, sinon on serait déjà morts, puisque sans subvention possible […] (André).
Pour un organisme de ce type-là il y a beaucoup de relations publiques à faire. Il y a beaucoup de POLitique. Faut que tu rencontres les ministres, faut que tu rencontres les députés, faut que tu t’entendes bien avec le maire […] faut que tu aies aussi une ouverture sur l’international, ça aussi c’est un aspect intéressant avec les Muséales [ton bas]. L’ouverture sur l’international, ça c’est la force d’André, il a développé des liens lors de la présentation de ses propres expositions dans des musées. C’est inné chez lui. Engager une relève serait dispendieux et prendrait beaucoup beaucoup de temps pour tisser la toile d’araignée qu’André a TISSÉE au cours des années, puis, cette toile d’araignée-là, elle est primordiale pour l’avenir de La Maison amérindienne. (Michel N.).
[…] Parfois nous avons un protocole d’entente avec une Première Nation qui va nous octroyer une aide financière pour tenir un événement précis comme inviter un peintre, un conteur de la Première Nation, ou encore nous aider à défrayer les coûts pour le crabe […] (Chantal).
[Jean-Paul] Riopelle […] m’a beaucoup appuyé et aidé pour La Maison amérindienne […] il a signé avec moi et ma fondation un contrat, qu’on aurait jamais de droits d’auteurs à REDONNER aux héritiers et ça c’est énorme, parce que les deux expositions qu’il y a actuellement nous coûteraient une fortune en droits d’AUTEUR (André).
Sur le portail virtuel officiel du musée, la section « Liens », la mention en page d’accueil de Diffusions de la coulisse et du Conseil des arts du Canada, et la page à propos du Salon Riopelle sont des signes qui encodent ce partenariat. Puisqu’essentiels et inhérents à la mission du musée, les nombreux partenaires (notamment la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk) pourraient être constamment mentionnés de la même manière sur le portail officiel de La Maison amérindienne. Cela permettrait aux publics et potentiels partenaires de décoder et reconnaître tout le travail relationnel effectué par l’équipe derrière la programmation du musée. Participant aussi de l’idéal patrimonial collaboratif et d’une éthique relationnelle, ces mentions deviennent un témoin tangible de la mise en œuvre de la mission du musée.
La diffusion de la programmation du musée est de ce fait variée, de bonne envergure, et reçoit une réponse publique globalement positive :
Il y a une DIFFUSION, des cultures des peuples autochtones assez exceptionnelle faite par La Maison amérindienne, ça je pense qu’il y a pas de doute là-dessus, encore cette semaine […] quand, par exemple, j’annonce dans mon réseau [Facebook] qu’à La Maison amérindienne y a tel spectacle qui s’en vient, je vois la réaction des Autochtones qui partagent, qui disent « ouais ! ouais ! ouais ! », qui disent « bravo ! » […] alors je pense qu’il y a ce côté-là, du côté de la diffusion ça joue un rôle majeur (Michel N.).
La mise en valeur muséale va dépendre des expositions que nous recevons, elles sont souvent axées sur une nation en particulier. La Maison amérindienne a beaucoup de variété dans ces événements : concerts, conférences, animations (Louis-Xavier).
On a accueilli un groupe d’aînés […] des aînés québéCOIS, ein – « bonjour, vous avez apprécié votre visite ? » « Ah oui, j’te dis qu’on en a appris des choses ! » Bien là tu te dis, voilà c’est fait. Mission accomplie. Bien oui. J’ai répondu « il faut revenir […] il y a PLEIN d’autres choses que vous pouvez déguster […] (Chantal).
Il y a énormément de travail qui est fait au niveau animation dans les écoles, dans des groupes de personnes âgées, ou différentes associations, on couvre jusqu’à Sainte-Agathe, St-Jérome, Sherbrooke et Trois-Rivières (André).
Dans la MAJORITÉ des cas, c’est toujours une réaction très… « oh wow » (Chantal) Oui (Audrey) tu sais, c’est vraiment, « mmmh c’est intéressant » […] les gens quand ils mettent le pied ici ils ne viennent pas à reculons, ils viennent parce qu’ils en ont le goût […] il y a un intérêt […] Parfois une personne prend l’initiative de réserver pour d’autres [pour le Repas des sucres] qui possiblement ne nous connaissant pas ne seraient peut-être pas venus, ils apprennent à nous connaître, mais au final, ils ressortent, « hein, c’était bien, on a apprécié, on a appris […] ils aiment le concept, le côté santé aussi, le côté volontaire, le fait que, comme on dit tout le temps qu’on est une famille, le côté où tout le monde collabore, avec tous ces bénévoles aussi […] (Chantal).
Ces propos reflètent effectivement les valeurs directives du musée face à ses publics et partenaires, soit notamment le respect et l’engagement, qui sont respectivement détaillés dans le document des valeurs du musée : « une courtoisie, une communication efficace et un respect réciproque des ententes avec nos partenaires » et « La Maison amérindienne s’engage à fond dans ses projets à la satisfaction de notre clientèle et de nos collaborateurs. »
Au diapason de la mission sociale du musée pour mieux faire connaître les Premières Nations, les publics de La Maison amérindienne sont principalement, « les non-Autochtones qui veulent en apprendre plus » (Chantal), en très grande majorité de nationalité québécoise, ensuite européenne et ontarienne (Louis-Xavier), « du tout petit jusqu’à la personne âgée » (Audrey). Le musée jouit d’un public fidèle composé des visiteurs réguliers, des amis du musée, des membres, de nombreux bénévoles. Je rencontrais lors de mes journées au musée des visiteurs dont l’expérience était positive, sourires et bonne humeur visibles. Les visiteurs que j’ai croisés lors d’un Jeudi culturel étaient souriants, s’attardaient sur la terrasse en discutant avec l’une des animatrices.
Ensuite, la « gamme d’activités » offertes dans la programmation du musée est mise de l’avant dans la courte présentation de l’organisme dans le magazine de Tourisme autochtone Québec, Origin(e) (2018, p. 62). Par ailleurs, il a été fait mention de la pédagogie, de l’exposition et de la création comme moyens privilégiés de mise en valeur des cultures matérielles autochtones selon Kaine (2004). Or, il se trouve qu’un musée en général met de l’avant les facettes d’exposition et de pédagogie, et offre souvent des ateliers de création ; La Maison amérindienne utilise les trois dans sa programmation, comme en témoignent les commentaires de Louis-Xavier, Michel et André. Le projet pédagogique Design et culture matérielle de Kaine avec de jeunes élèves en communauté inuite au Nunavik donne un aperçu des résultats de ces moyens privilégiés. Kaine identifie l’étape d’exposition comme cruciale avec le regard de l’autre qui vient mesurer en partie la valeur de l’œuvre créée pour tous les acteurs impliqués ; l’exposition met également en valeur le « langage plastique de chaque exposant » (p. 149). La conception design est perçue comme très formatrice au niveau intellectuel et valorisante au niveau identitaire par l’expression de soi, par le fait de donner forme à un objet et de prendre forme par la création (autoconstruction) ; et le projet pédagogique en tant que tel opère une mise en relation entre sa propre création et les chefs-d’œuvres de sa culture, ce qui « démontre à chaque participant que sa création mérite de côtoyer celles des anciens, opérant ainsi un lien intergénérationnel signifiant » (p. 147). Ces expériences montrent un empowerment, une capacité incarnée chez les jeunes Inuits, que l’on peut logiquement attribuer à l’expérience adulte aussi.
Ce passage clé lors de la discussion avec Chantal et Audrey montre combien la mise en valeur du patrimoine et des cultures autochtones passe par chaque élément que diffuse le musée. À la question des façons de faire pour mettre en valeur le patrimoine, Chantal a répondu :
muséal, ethnographique en fait, dans toutes nos activités, que ce soit les contes et légendes, que ce soit la série de spectacles, que ce soit nos programmations de découverte gastronomique, que ce soit notre café, […] en fait TOUTE notre programmation est faite pour mettre en valeur le patrimoine autochtone, dans chaque geste, pourquoi il y a autant de citrouilles, c’est pas pour juste décorer pour l’Halloween, c’est parce que la citrouille faisait partie des Trois Sœurs, maïs, haricot, courge […].
La notion de campagne de peur ou de désir dans la théorie d’in/capacité incorporée de Valérie de Courville Nicol (2011) permet de penser la diffusion et la mise en valeur muséales, ainsi que leur réception sociale. Il s’agit de stratégies délibérées concernant la réponse émotionnelle des gens face à des objets suscitant la peur ou le désir, par exemple les livres illustrés pour enfants faisant la promotion de comportements souhaitables à adopter (p. 169-179). En ce qui concerne le mandat et la diffusion du musée, cela semble être une campagne de désir qui enligne la mémoire collective vers une image positive des Autochtones à travers le temps et vers un rapprochement entre peuples, et à travers cette campagne de valorisation, l’acquisition d’une meilleure connaissance des Premières Nations. L’image identitaire positive des Autochtones pour tous publics est d’ailleurs véhiculée par l’ensemble des musées tribaux. Pour reprendre la vision de Bousquet (1996) et Vernier (2016) sur le musée tribal, nous avons un musée d’identité qui revalorise cette dernière. Cette stratégie permet donc de répondre de façon capacitante à l’autre côté de la médaille, l’objet de peur si l’on veut, c’est-à-dire le fossé interculturel entre les sociétés québécoise et autochtones. Cette notion de campagne permet d’appréhender les stratégies qui affectent la capacité des gens à exercer leur « autonomie incorporée » (De Courville Nicol, 2011, p. 170), c’est-à-dire à orienter leur action à travers des émotions capacitantes, ce qui semble être le cas ici pour l’équipe et les publics.
André abonde dans le même sens d’une mise en valeur multiple en évoquant qu’elle passe par les « discours », conférences, dégustations, les « expositions le plus variées possible » et conclut qu’il s’agit « d’un tout ». Richard met l’accent sur l’art et la gastronomie comme moyens de valorisation. Pour Louis-Xavier, la mise en valeur est liée au côté relationnel en plus des expositions car les façons de faire sont d’« organiser des événements pour créer des échanges entre Autochtones et non-Autochtones » et de « faire rayonner leurs différentes cultures [des Premières Nations] ». Ici aussi, il semble qu’en plus du synopsis de l’exposition en cours qui apparaît dans la section du site Internet « Expositions temporaires », un historique concis des expositions temporaires identifiant le travail de nombreux artistes autochtones puisse contribuer au travail de mise en valeur des cultures et artistes des Premières Nations par La Maison, ainsi qu’exemplifier et susciter l’échange et le partage. Un œil externe, novice en matière de muséologie collaborative entre Autochtones et non-Autochtones, ou même un œil critique pourrait décoder ces éléments comme témoins des projets collaboratifs concrets et réussis à La Maison. En outre, ce procédé participe de la continuité et la préservation culturelle et muséale par une trace tangible d’expositions qui, comme l’indique leur nom, sont temporaires. Cela peut démontrer le savoir-faire de l’organisation à créer des liens et à mettre en valeur les artistes à travers le temps.
À certaines reprises, la diffusion suscite des questionnements chez les visiteurs. Le salon Riopelle comme espace d’exposition permanent fait l’objet de curiosité : « que fait donc un Québécois dans un musée autochtone ? » est une question fréquemment posée par les visiteurs tel que rapporté par Audrey, qui va contextualiser cette présence auprès du public. Le salon présente notamment sa sérigraphie inspirée du jeu de ficelles autochtone, un animal étant représenté dans chacune des oeuvres qui peuvent être vendues pour participer au financement du musée – Riopelle a appuyé et aidé à la mise en place de La Maison de façon significative. Cette question de la part du public, tout comme la mention d’André sur la confusion des gens quant à l’entité qui gère le musée, m’apparaissent comme l’un des résultats directs du contexte sociohistorique québécois et canadien entourant la politique identitaire. Le positionnement et la contextualisation sont devenus des normes sociales dans les rapports entre Autochtones et non-Autochtones en tant que préconditions pour assurer une certaine modalité de confiance dans les échanges. Exposer Riopelle aux côtés d’un-e artiste autochtone désigné-e en permanence, ou le nommer par exemple le Salon Riopelle-Newashish inspiré du canot brillamment exposé au Salon et façonné par l’artisan renommé César Newashish (Attikamekw), qui en a fait don à son ami, sont des stratégies qui pourraient potentiellement dissiper les questionnements et incarner encore plus fortement l’art de créer des liens et la mission d’échange, de partage et de rapprochement.
Encore, le contexte entourant la mise en œuvre de l’exposition Nomades ou itinérants détaille l’intention de sensibilisation quant à l’itinérance urbaine autochtone à l’origine du projet, d’une part dans la diffusion opérée par l’Écomusée du Fier monde (2018) et d’autre part, dans le catalogue de l’exposition rédigé par Guy Sioui Durand (Wendat), préfacé par le chef de l’APNQL, Ghislain Picard (Innu). D’autre part, dans une telle conjoncture sociale délicate, impliquant des personnes particulièrement vulnérables dans le projet en question, contextualiser également le type de démarche et d’entente avec les participant-e-s du projet, et expliciter le partage des bénéfices portés par le projet entre les parties impliquées dans les textes d’exposition, et dans chaque action de diffusion de l’exposition, participerait aussi à l’affirmation de soi en tant qu’institution. Cela participerait du souci d’autorité partagée (shared authority) et de collaboration cher aux projets d’exposition avec des Autochtones. En contraste avec le communiqué et le dossier de presse de L’Écomusée qui relèvent davantage du milieu muséal, un article de La Presse+ (Clément, 2018) et l’entrevue d’André par Labrosse (2018) à Radio-Canada abordent la démarche selon laquelle l’artiste dormait aux côtés des Autochtones dans les rues en faisant du bénévolat au Centre d’amitié autochtone, qui appuyait le projet, et de ce que les toiles ne sont pas originellement dédiées à la vente ; si cela est le cas, la moitié des gains est versée à une épicerie « qui ouvrira un compte pour que les sans-abri puissent venir y chercher de la nourriture » (Clément, 2018, dernière section). Cette contextualisation pourrait donc atteindre les publics non impliqués dans le projet ou n’ayant pas été en contact avec cette diffusion, mais visitant l’exposition ou en entendant parler de bouche à oreille.
Les partenariats hors les murs et une diffusion variée pouvant rejoindre un vaste public semblent donc développés pour faire passer le message du musée et assurer sa continuité et ce, même dans un contexte d’effectifs restreints dédiés aux communications. En outre, la diffusion de la programmation à travers des articles de presse a pour effet une affluence marquée dans les jours suivants, par exemple l’article du 18 octobre 2018 de La Presse ayant attiré environ soixante visiteurs par jour pendant la semaine suivant sa parution (Audrey). Des expositions itinérantes en passant par les « animations thématiques nomades » dans les écoles, fêtes, conférences ou autres événements (MA, 2012, page Éducation), on voit aussi des associations originales telles les kiosques de sensibilisation en partenariat avec le corps autochtone de la garnison de Saint-Jean-sur-Richelieu. La diversité des publics visés et des organismes ou associations avec lesquels s’affilie le musée est donc présente.
3.6 Adaptation et résilience des organisateurs
L’un des débats en muséologie tourne autour de la notion du musée condamné à plaire afin de répondre aux besoins, maintenir et développer ses publics – Jacobi parlait même de « tyrannie de l’exposition » temporaire qui rythme la vie muséale notamment depuis le tournant communicationnel des musées envers les publics dans les années 1990 (cité dans Paquin et al., 2015, p. 36). L’équipe du musée fait indéniablement preuve de flexibilité envers ses publics, réalisant l’approche relationnelle muséale :
Je trouve que [l’institution muséale] donne une crédibilité. APRÈS ça, c’est à nous de la démocratiser et de la faire sortir hors des murs, et c’est souvent ça la difficulté. Oui, il faut se diversifier, parce que oui on a un bassin qui nous entoure, qui aime consommer la culture, mais si tu veux que les visiteurs reviennent il faut créer aussi de nouvelles choses, même si on reste toujours bien exotique pour certains voyageurs […] nous nous devons tout le temps, CONSTAMMENT, être à l’écoute des différents besoins des gens […] (Chantal).
[…] au début pendant deux ans les Autochtones servaient de la « viande de bois », du caribou et de l’orignal. Les Québécois en mangeaient pas vraiment parce qu’elle était vieillie, un peu forte, ils la gaspillaient, alors qu’elle coûtait très cher à La Maison amérindienne. C’est là que j’ai dit « il va falloir que vous révisez votre manière de fonctionner et changer, il vous faut essayer de trouver une viande que vous travaillerez à l’amérindienne et que tout le monde va aimer », et c’est pour ça qu’ils se sont tournés vers le poulet […] (André).
[…] on est beaucoup à l’écoute des visiteurs – on prépare des activités et des animations tant pour le public non autochtone que pour le public autochtone ce n’est pas du tout les mêmes clientèles […] Des fois ça peut être de vivre une cérémonie de mariage CRIE, spécifique aux Cris, donc à ce moment-là on va plus AXER le propos sur cette Première Nation (Chantal).
Avec les groupes d’adultes l’animation peut être la même dans son LIBELLÉ, mais son contenu va être [en chœur avec Chantal] ACTUALISÉ comme celle qui s’appelle « Les Amérindiens d’hier à aujourd’hui » […] (Audrey).
[…] ici on est une petite équipe qui doit être multitâches, […] Des fois tu as beau vouloir t’adresser, personnaliser l’expérience, mais des fois tu n’as pas nécessairement les habiletés ou les capacités, mais on les trouve PAREIL [rires] on y travaille et on le développe en collaboration avec le reste de l’équipe (Chantal).
Il semble également que l’organisme doive fournir des efforts supplémentaires devant la résistance des instances régionales et provinciales à le supporter financièrement et moralement :
Tu sais, à Mont-Saint-Hilaire on a un maire qui pour moi fait de la discrimination, c’est pas facile de travailler avec un maire que les Autochtones dérangent quasiment, c’est plate […] lui il veut pas réaliser qu’il y a des Autochtones qui vivent dans sa ville […] (Richard).
[…] puis [le musée] c’est une CHARRUE, ça laboure, on laboure dans un terrain qui est souvent très très difficile […] ça résiste mais ça avance. (Michel N.)
Comment pourrais-je dire, comme je gère les deux musées de la ville, le musée des Beaux-Arts et La Maison amérindienne, je vois le « deux poids deux mesures » dans la réalité de mon quotidien. Tu sais, le musée des Beaux-Arts est supporté à hauteur de 150 000 $ par année […] mais à La Maison amérindienne la ville donne des miettes, 25 000 $ depuis seulement 3 ans, avant durant 15 ans pas un dollar. Sur ce petit montant le maire fait déduire toutes les interventions qu’ils viennent faire sur leur propre bâtiment […] Je suis toujours dans le feu de l’action dans mon quotidien, j’appelle ça « je tiens le boyau pour arroser les feux de partout » (Chantal).
Ainsi, la résilience dont fait preuve l’équipe peut être définie comme la capacité émotionnelle de confronter les demandes du quotidien de façon saine, son pendant d’incapacité étant le stress émotionnel, selon l’un des concepts de norme émotionnelle dialectique de De Courville Nicol (2011, p. 36). Ce sentiment de résilience est positivement véhiculé dans le travail du musée à faire rayonner les cultures des Premières Nations. Le potentiel du musée fait effectivement l’unanimité dans l’équipe. La question du soutien financier problématique demeure.
Cette capacité d’adaptation et de résilience semble également un atout face au défi d’assurer l’affirmation de l’organisme en tant que modèle muséal unique, tout en révélant les contraintes occasionnées par une inéquité dans les rapports de pouvoir institutionnels. L’analyse de Cobb (2005) des critiques envers le National Museum of the American Indian montre, d’une part, la réponse autochtone favorable et sa principale critique tournant autour de la limite à laquelle une communauté peut retrouver sa propre représentation au musée – ce qui demande de l’adaptation et une écoute constante pour l’institution. D’autre part, les critiques non-autochtones présentaient toutes l’idée selon laquelle beaucoup de visiteurs sont confus par le nouveau paradigme muséal que propose le NMAI. Cobb évoque la métaphore d’une toile d’araignée pour illustrer l’épistémologie autochtone sous-jacente aux expositions, le sens se construisant au fil de la visite. Ainsi, elle suggère non pas que le musée doive plaire en suivant des normes muséales traditionnelles mais qu’il s’adapte de façon affirmative en préparant les visiteurs à l’expérience qui les attend, par exemple avec des dispositifs audio ou vidéo. Cela est non seulement bon pour la fréquentation, argumente-t-elle, c’est aussi une occasion de réconciliation culturelle (p. 503-505). La contextualisation et l’affirmation répétées du paradigme distinct de La Maison m’apparaissent de ce fait très pertinentes dans le contexte social actuel des rapports entre Autochtones et Québécois, et à la lumière de cet exemple du NMAI, qui est une institution similaire faisant face au défi de définir et affirmer son modèle distinct à l’échelle internationale.
3.7 Souci de pérennité
À la question « comment voyez-vous La Maison dans une génération ou deux ? », le souci généralisé quant à l’avenir de La Maison parmi le discours de l’équipe se décline ainsi :
Actuellement La Maison amérindienne est entourée de passionnés […] cette énergie-là repose sur les épaules d’un petit noyau dur. Ok, parce que les aspects financiers de La Maison amérindienne ne sont pas attachés […] donc je me dis que dans l’avenir, j’espÈRE qu’en faisant rayonner cette énergie-là il y aura un jour des gens qui financièrement vont nous supporter pour que ça perdure dans le temps […] dans une perspective… future, bien moi je souhaite pérenniser La Maison amérindienne, continuer à la faire rayonner et, pourquoi pas, travailler à faire naître d’autres Maisons amérindiennes ? (Chantal)
Oui l’équilibre est très fragile il faut réussir à attacher les ficelles, tout ficeler […] parce que oui, on a beaucoup de discours politiques qui parlent de réconciliation, […] mais peu ou pas d’actions concrètes (Audrey).
Si je veux être honnête c’est mon souci (André).
Les actions de La Maison amérindienne sont en lien direct avec la préservation du patrimoine pour les générations à venir. […] J’aimerais la voir toujours vivante et qu’elle soit subventionnée pour ses expositions et activités destinées à découvrir les cultures autochtones (Louis-Xavier).
Je pose souvent la question dans les conseils d’administration : est-ce qu’on a de la relève ? Est-ce qu’on prépare la relève ? Parce que… on peut pas se fier sur la VILLE, les relations avec la ville sont juste juste juste ce qu’il faut, sans plus, le support de la ville n’est pas exceptionnel, tout le temps, tout le temps au compte-gouttes, à la limite là, il y a de la résistance, peut-être parce que c’est autochtone […] (Michel N.).
Ainsi, le fonctionnement organisationnel, le savoir-faire, la diffusion et les relations publiques développées, et la résilience de La Maison amérindienne sont autant d’éléments qui, considérés globalement, contribuent à mettre en valeur le riche patrimoine autochtone auprès de tous les publics. Cela se déploie malgré les blocages tantôt d’une mairie, tantôt d’un gouvernement, tantôt des relations sociales ou du milieu culturel. La pérennité de l’organisme repose sur un soutien financier et sur la continuité de l’approche relationnelle développée avec les partenaires, de la « toile d’araignée tissée » au fil des années.
Au même moment, deux réflexions ressortent : se pourrait-il que la diffusion à bonne échelle détaillée plus haut, demandant d’être « dans les opérations », porte le risque de réduire le temps pouvant être dédié à la recherche et la demande de subventions, ainsi qu’aux relations de partenariat qui assurent la pérennité financière de l’organisme ? Et se pourrait-il que le défi d’affirmation en tant qu’organisme distinct pour dissiper les questionnements et potentielles critiques participe à assurer la pérennité de l’organisme ? Le positionnement identitaire du musée, notamment par la mise en valeur de l’équipe et de ses collaborateurs-trices dans sa diffusion officielle correspond à ce que je nommerai, dans le contexte social de réconciliation balbutiante, la norme effacement/affirmation de soi, soit le sentiment de capacité à statuer ses dispositions envers autrui. De ce point de vue, particulièrement lorsqu’explicitement contextualisée et encodée, la dynamique collaborative opérée avec engagement par l’équipe du musée incarne les assises d’une solidarité interculturelle, que je détaille dans la prochaine section.
4. Aspect interculturel : la rencontre au musée multi-nations
À ce stade, il semble que le musée propose, à travers sa mission et l’action culturelle qu’elle propulse, un encodage spécifique de valorisation des Premières Nations auprès de tous ses publics. Cette mise en valeur invite à un décodage de compréhension culturelle alternatif aux préjugés et représentations erronées qui demeurent en Amérique du Nord. Il s’agit donc d’un décodage oppositionnel – ou négocié si l’on pense aux discours de réconciliation et de résurgence de plus en plus partagés sur la scène nationale et internationale, et à plusieurs de ses applications réussies telles la Commission de vérité et réconciliation. Il est en même temps à se demander comment il pourrait en être autrement qu’un discours oppositionnel et un ensemble de blocages structurels que rencontre l’équipe. En effet, on constate d’un point de vue sociologique la nature même de l’identité autochtone, qu’Alfred et Corntassel (2005) qualifient d’“oppositional, place-based existence” (p. 597) contraire à celle du settler (colon, immigrant) qui forme, en quelque sorte, l’unité de base des États-nations. Selon eux, l’indigénéité n’est autre qu’être indigène aux terres que l’on habite, à l’opposé des États et sociétés coloniales ayant émergé de divers empires.
Néanmoins, l’identité autochtone implique mais ne se limite pas à la remise en question de la légitimité coloniale que les États-nations s’efforcent constamment de nourrir à travers, par exemple, leurs discours et politiques de citoyenneté ou de propriété privée. Avant l’adoption de la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones en 2007, Battiste et Henderson (2000) évoquaient d’ailleurs la résistance des États-nations (le Canada notamment) lors de l’élaboration de la Déclaration en 1994 : “The governments of the day […] reject the idea of hybridized states that include Indigenous peoples in the political and adjudicative realms” (p. 7). Quant au Québec, qui reconnaît en principe le fait d’un État plurinational (Bouchard, 2014, p. 17), il y a de la résistance comme en témoignent les commentaires de l’équipe sur les blocages envers les Autochtones, tout comme des avancées. On pense aux résolutions de l’Assemblée nationale du Québec de 1985 et 1989 en relation avec les Premières Nations, entre autres, que Bouchard lie, parmi d’autres facteurs, à la genèse du modèle interculturaliste québécois par la reconnaissance conjointe de droits et de spécificité culturelle qui sous-tend ces résolutions, « tout en balisant la voie d’un dialogue et d’un rapprochement » (p. 47). Comme le confirment Battiste et Henderson avec leur souhait de reconnaissance politique d’“hybridized states” et l’analyse de Côté et Benessaieh (2012) ou Piquemal et Labrèche (2018), un modèle de transculturalisme à tout le moins éthique et dépourvu d’impérialisme européen ou étatsunien n’est pas encore institutionnalisé à ce jour aux Amériques.
Il y a une rencontre interculturelle (et non de l’interculturalisme tel qu’abordé dans la section de question de recherche) facilitée par le modèle du musée, certes en-dehors de la scène politique officielle, mais non moins politique pour autant. Cette rencontre implique les notions d’identité, du rapport à autrui et de la structure sociopolitique affectant les relations Québécois-Premières Nations, et suppose même un certain patrimoine commun. Les propos de l’équipe reflètent la perspective multi-nations au cœur de la mission de l’organisme et abordent significativement la sempiternelle dialectique de résistance/ouverture présente dans les relations sociales entre Québécois-es et Premières Nations, dont la clé réside dans l’éducation et la connaissance selon l’équipe. La perspective éducative multi-nations s’avère globalement avantageuse pour les parties concernées – on comprendra le sens de la mention « Entreprise culturelle d’économie sociale ».
4.1 Le créneau multi-nations
Le musée se dit multi-nations, c’est-à-dire qu’il représente et est chapeauté par des membres de différents Premiers Peuples. L’accent est mis sur les partenariats avec les communautés présentes au Québec, tout en reconnaissant l’enjeu des frontières modernes qui superposent les territoires ancestraux, ainsi qu’avec des artistes autochtones d’autres pays. La mise en valeur du patrimoine de plusieurs nations par rapport à une nation spécifique dans des musées tribaux tels le Shaputuan ou le Musée des Abénakis, présente les caractéristiques d’être diversifiée, inclusive, avantageuse et versatile. Voici la façon dont se décline ce créneau :
Moi je pense que c’est une bonne chose [cette approche]… le Québécois ou même le Canadien s’imagine que les Autochtones on est tous pareils mais en réalité nous sommes tous vraiment très différents dans la façon de voir, la façon de travailler, la façon de penser […] il y a des nations qui sont des pêcheurs, il y a des nations qui sont des chasseurs, il y a des nations […] c’est le bois. Moi je viens d’une nation qui est beaucoup axée sur la chasse et beaucoup la pêche, la pêche en haute mer entre autres (Richard).
Lorsqu’on parle du canot dans une animation spécifique sur le canot attikamekw on va creuser plus versus quand on parle en général des Iroquoiens et Algonquiens avec certains groupes (Audrey).
C’est sûr que parler de plusieurs nations dans une présentation c’est souvent plus des généralités tandis que, si on ne parle que d’une nation on va creuser plus en profondeur. Par contre on utilise cette approche pour dégager les similitudes (Chantal).
[Dans ce cas-ci] on parle des Premières Nations du Québec, mais on traite aussi des Autochtones de l’Amérique centrale, des Autochtones des pays d’Amérique du Sud. Lorsqu’on présente des expositions liées à ces peuples on PLONGE dans le mode de vie des Indiens Borunka (Chantal) des Quechua du Pérou (Audrey). On va chercher toute l’information, et ça sert aussi à créer des liens entre les Autochtones des trois Amériques, et les Autochtones d’ici. On crée des ponts avec les Premières Nations qui nous entourent (Chantal).
Ainsi on peut monter une variété d’expositions beaucoup plus grande. L’installation de La Maison amérindienne à Mont-Saint-Hilaire, donc hors communauté, est une sorte de geste politique dont le but est de parler de toutes les nations et pas que d’une nation […] les expositions sont souvent montées comme des éditoriaux, avec des messages forts. Le fait que ce soit un musée multi-nations ça permet de mettre en valeur toutes les autres nations (André).
On se trouve dans un créneau multi-nations unique qui n’est pas, on n’est pas Abénakis, on n’est pas Mohawks, on n’est pas Wendat, on n’est pas Borunka (rires) (Chantal).
En plus de sa localisation hors communauté, cette approche est avantageuse. Elle devient capacitante autant pour les collaborateurs du musée qui ont la possibilité de mettre en valeur leur art ou leur savoir et le patrimoine de leur nation à travers ce « carrefour » tel que défini par Richard ; pour le musée qui développe des connaissances propres à chaque collaborateur (« on va se plonger dans le mode de vie »), qui déploie sa mission en pouvant traiter d’une variété de sujets et rejoindre divers publics ; et pour les visiteurs qui ont accès à une diversité de connaissances sur les Premiers Peuples mis en valeur au musée, et à un « mode de rencontre et d’interprétation » de ce qui est inconnu, facilité par le musée et les expositions au sens de Davallon (1986, p. 260).
En effet, le lieu change avantageusement de couleur, tel le caméléon, selon la nation mise en valeur lors d’un événement donné. Ce phénomène était palpable lors du Festin de crabes : l’espace d’une soirée, le lieu de rassemblement qu’était la salle d’accueil de La Maison pour la communauté Wolastoqiyik Wahsipekuk, historiquement délocalisée de ce côté de la frontière Québec-Nouveau-Brunswick-Maine pour vivre en majorité hors communauté, devenait un lieu familier qui les mettait à l’honneur. Il y a eu le partage d’histoires, de chants et de gastronomie traditionnelle – dont deux membres de l’équipe appartenant à la Première Nation, Richard et Louis-Xavier, y ayant grandement contribué – non seulement auprès des Wolastoqiyik, mais aussi d’autres Autochtones et de gens d’autres nationalités présents. Le lendemain, ce même espace redevenait « neutre » dans le sens « multi-nations ». Inclure et « faire ce pont » avec des nations d’autres régions géographiques implique naturellement une dynamique de rencontre interculturelle. Un exemple intéressant est la résidence d’artiste se tenant parfois au musée, tels le fils et le petit-fils de César Newashish y ayant construit un canot pendant un mois.
Par ailleurs, l’espace du musée est défini comme autochtone, reflétant des valeurs et actions propres aux Premières Nations et l’équipe étant composée de membres des Premières Nations et métis. L’observation concernant le potentiel de valoriser davantage l’identité de l’équipe et sa variété d’appartenances culturelles sur les plateformes de diffusion du musée fait écho ici aussi, pour affirmer le musée dans son modèle multi-nations du point de vue de l’identité et dans sa façon de représenter ces diverses identités. À la question d’un parallèle possible entre La Maison amérindienne et le National Museum of the American Indian aux États-Unis qui couvre le patrimoine des Premiers Peuples des Amériques, André Michel et Richard Ruest acquiescent, du fait de cette occasion pour tous de faire connaître leur héritage et leur art dans un lieu rassembleur. Toutefois, Chantal soutient que la pratique du musée est unique en son genre en raison de « sa mission sociale » ; et Michel Noël ne voit une comparaison possible que si le NMAI était plus modeste en tant qu’institution, qu’il qualifie de « très très politisé ». et de « très grosse affaire ». André et Michel avaient établi des contacts avec l’institution par le passé.
D’autre part, nommer les « généralités » en contexte autochtone pose son lot de défis pour tout organisme, étant donné les aléas de la politique identitaire complexe et changeante, couplées à l’héritage colonial ayant masqué les nombreuses particularités des cultures des nations autochtones. La terminologie utilisée au musée pour articuler le créneau multi-nations, inclusif et diversifié en soi, parle génériquement des Autochtones, Premières Nations, Métis, et Inuits, Premiers Peuples, couramment acceptés, puis ensuite des Amérindiens (littéralement « Indiens d’Amérique », terme retiré des manuels scolaires au Québec en 2018 suivant les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada)[5], des Iroquoïens et des Algonquiens pour rejoindre des publics novices. Ces derniers termes provenant de disciplines occidentales portent en eux-mêmes la possibilité de réitérer une dynamique incapacitante d’effacement des noms qu’elles se donnent en tant que nations et confédérations : Kanien’kehà :ka plutôt que Mohawks ; Haudenosaunee plutôt qu’Iroquois, Wolastoqiyik plutôt que Malécites, Wendat plutôt que Hurons, et ainsi de suite (variant aussi d’un individu à l’autre, d’une génération à l’autre…). Pourtant, la mission du musée qui se décline à travers son organisation et son importante programmation, va précisément à l’encontre de la dynamique populaire de s’imaginer « qu’un Autochtone c’est tout pareil » évoquée par Richard. Se référer davantage aux Premiers Peuples et leurs appellations traditionnelles, ainsi que les regrouper selon des particularités linguistiques (algic, par exemple) ou « nomades/sédentaires » pourrait participer à s’enligner avec l’autoreprésentation dans le contexte sociohistorique actuel dont traite Smith (2012), malgré le temps que cela peut demander de consacrer lors d’animations, entre autres. Cette terminologie participe en même temps de l’apprentissage et de la connaissance que déploie le musée à l’endroit de ses publics majoritairement allochtones et souvent néophytes. S’il rencontre effectivement le défi par rapport à d’autres organismes culturels de rejoindre et s’adapter à divers publics, le musée a un mandat éducatif avantageux qui vient complémenter – et même remplacer – les programmes éducatifs réguliers qui abordent les Autochtones.
Néanmoins, le créneau multi-nations s’enligne directement avec l’approche de la plurivocalité qui est fréquente en muséologie autochtone et propre à la muséologie collaborative, remédiant aux complexités de représentation et d’autoreprésentation. La plurivocalité, soit plusieurs voix, permet à tous les groupes et personnes représentées de faire entendre leur voix sur un pied d’égalité (Dubuc & Turgeon, 2004 ; Soulier, 2015). Soulier analyse l’interprétation du point de vue autochtone qui est mis en valeur dans l’exposition polyphonique collaborative Edward Curtis : un projet démesuré du Musée McCord auprès de jeunes étudiants autochtones et allochtones québécois en visite. Leur affiliation culturelle semblait jouer un rôle dans l’autorité qu’ils donnaient à un discours donné (celui de commissaires allochtone et autochtone ou du photographe Curtis). Les jeunes visiteurs québécois reconnaissaient de façon critique les représentations idéalisées des Autochtones de Curtis, mais moins les jeunes Autochtones, et l’inverse s’appliquait à l’endroit du discours du commissaire Guy Sioui Durand (Wendat). Tous préféraient le point de vue autochtone et arrivaient à distinguer la situation contemporaine de celle de l’époque de la salvage anthropology de Curtis. Il en ressort que la plurivocalité et la polyphonie, la combinaison des voix, encodent une narration faite de différentes perspectives qui peuvent offrir un message particulièrement enrichi et complexe. Dans ce cas, c’était un engagement du musée et des collaborateurs à expliquer, démystifier le travail de Curtis et redéfinir plus adéquatement qui est autochtone. On en voit toute la pertinence avec la mission sociale et engagée du musée.
En effet, cette intertextualité, ce mélange textuel qu’implique le créneau multi-nations du musée « carrefour » met de l’avant les faits de l’échange interculturel et de la transculturalité dans l’histoire. Par exemple, l’exposition J’épie… le maïs fait explicitement référence à l’échange de la culture du maïs à travers les Amériques depuis un point central au Mexique vers 5500 avant notre ère, célébrant ainsi les échanges interculturels du savoir-faire entourant le maïs. Plusieurs évocations d’adoption de techniques ou de matériaux entre Premières Nations et Canadiens français sont aussi présentes entre autres dans l’exposition permanente du musée : la cabane à sucre dérivant des grandes réunions printanières autochtones invitant des colons français alliés, l’adoption du chaudron en métal par les Premières Nations, l’arrivée du cheval aidant à la récolte de l’eau d’érable, etc. Au final, des manteaux inuits côtoient et communiquent avec des légendes algonquine et mohawk ainsi que des sérigraphies québécoises et un canot attikamekw dans un même lieu. Le message encodé par ces pratiques est qu’il est bénéfique que différentes réalités et cultures soient en contact et en échange. Cela fait donc écho au trait transculturel inhérent au continent américain, trait qui dévoile inévitablement les bénéfices de cultures naturellement interreliées et non évoluant en silos, et qui expose également les marques profondes de l’impérialisme culturel.
Tel que mentionné plus haut, le volet artistique du musée met de l’avant des œuvres d’artistes autochtones – dont un-e d’un autre pays à chaque année – et de non-Autochtones dont un-e s’intéressant aux cultures autochtones chaque année, « parce que c’est le rôle de La Maison […] il faut aussi qu’on incite au rapprochement alors oui on expose l’artiste blanc qui s’intéresse aux cultures autochtones mais à condition que son travail ne touche pas à la spiritualité ou aux choses sacrées » (André). Cette stratégie encode la vocation d’échange et de rapprochement de l’institution. Dans le même contexte où l’autoreprésentation et la politique identitaire sont des enjeux complexes et sujets à tension, et que certains questionnements de la part de visiteurs (« que fait Riopelle dans un musée autochtone ? ») ont une récurrence, un supplément de contextualisation est peut-être souhaitable dans les expositions présentant des artistes non-autochtones, préparant les visiteurs à ce qu’ils vont trouver. Cette contextualisation est également prometteuse considérant les tensions entourant le rapport de pouvoir qui engendre un accès restreint à une vitrine artistique au Québec pour les Autochtones (CAM, 2018).
Ainsi, à travers ses nombreuses représentations possibles axées sur les Premières Nations dont les territoires couvrent la province du Québec, l’organisme reflète l’inclusivité et la diversité comme valeurs, comme objets de désir. Ces deux valeurs sont encodées d’abord dans la nature de l’organisation, puis dans ses représentations, si on perçoit leur matérialisation par les événements, expositions et animations en tant que productions culturelles du musée au sens de Stuart Hall. Au même moment, le créneau multi-nations a pour défi de représenter fidèlement chaque nation et la diversité, considérant l’évolution continue des revendications autochtones en la matière.
4.2 Dialectique de « résistance/ouverture » sociale
Sans donner plus de voix qu’il n’en faut à la situation de méconnaissance à l’endroit des Premières Nations au sein de la société québécoise explicitée dans la revue de littérature, le danger moral que le musée confronte est clair. Michel Noël mentionne une « barrière mentale » entre Québécois et Premières Nations, une compétition, une autarcie et le fait que les Premières Nations ne sont pas vues à « leur juste valeur ». Dans le documentaire Rencontre (Carrier & Higgins, 2011), deux jeunes Wendat s’expriment sur l’incompréhension de la part des Québécois en général : « Le monde y connaissent pas […] y parlent contre les Innus, contre les Wendats […] Kawish ça veut dire sale blanc fait qu’ils se traitent eux-mêmes de… ». D’une part, ces attitudes de résistance menant à un appauvrissement collectif existent dans le passé et le présent. D’autre part, il y a la présence d’ouverture à autrui au sein de la société québécoise contemporaine. L’équipe de La Maison amérindienne fait une lecture oppositionnelle et négociée des discours politiques, populaires et médiatiques à l’endroit des Premières Nations :
Dans les médias [les visiteurs] en apprennent mais la compréhension qu’ils en font n’est pas toujours la bonne (Audrey).
Un Autochtone au Québec est pas chez lui […] quand tu te fais poser la question bien « ah tu viens pas de cette réserve-ci », bien non, un Autochtone devrait être reconnu partout au Canada CHEZ LUI [pour l’exemption de taxes hors réserve notamment] même s’il est pas de Saint-Hilaire, C’EST un Autochtone il devrait être reconnu partout et présentement c’est pas ça […] je suis natif du Bas Saint-Laurent, et je demeure à Saint-Hilaire depuis 57 ans et quand je suis à Saint-Hilaire et qu’on me dit que je suis pas d’ici quand je présente ma carte d’Autochtone, […] quand tu es au Québec puis que tu… tu te fais poser la question, je trouve ça assez bas de gamme (Richard).
Donc il y a beaucoup de travail [à faire], et quand tu regardes les médias, on entend parler des « Indiens » que quand ça va mal. Pourtant il y en a plein qui font des bons coups tu sais un des présidents de La Maison amérindienne, Pierre Sioui, qui a occupé un poste important chez Bell, il a réussi […] (André).
On parle de réconciliation, on parle de tout ça, mais ça reste beaucoup dans les discours politiques […] Il faut que des actions concrètes soient posées dans les milieux (Audrey).
Il y a tellement de résistance à l’égard des Autochtones qui est une résistance LARVAIRE, tu la vois pas […] tu peux pas dire que c’est du racisme, tu peux pas… comment veux-tu, excepté que… (Michel N.). Le geste parle (Gabrielle) ! Oui ! Tu reviendras plus tard [imite le fonctionnaire qui met un dossier sous sa pile], tu sais, c’est pas une priorité, alors les Amérindiens ils souffrent de ça depuis tout le temps, tout le temps (Michel).
Cette lecture oppositionnelle se trouve aussi dans des gestes officiels de prise de position politique du musée, avec par exemple la lettre ouverte des membres du C.A. Pierre Sioui (Wendat), Michel Noël, Richard Ruest et Alain O’Bomsawin (Abénaki) en soutien à Theresa Spence faisant une grève de la faim à Ottawa en 2012-2013, déplorant l’attitude indifférente de Harper quant aux relations entre nations, et intitulée « Le gouvernement Harper, un pas en avant, deux pas en arrière… » (MA, 2013). Ensuite, l’histoire des relations Québec-Premières Nations présente une période transitionnelle dans la perception et les représentations des peuples autochtones au tournant des années 1930, comme l’exposait Gélinas (2007), et encore lors de la Révolution tranquille des années 1960 selon Vincent (1995) et Bibaud (2015) avec son concept de décolonisation tranquille. D’un point de vue sociologique, il est fascinant de constater l’affirmation identitaire conjointe des Autochtones et des Québécois lors de cette période ; il semble qu’une n’exclut pas l’autre, malgré le chemin qu’il reste à parcourir pour dissiper les préjugés à l’endroit des Autochtones. Le récit intergénérationnel valorisant de Richard illustre le changement des mentalités dans la société québécoise :
On va dire, comme on dit, un gai sort du placard, un Autochtone sort du placard aussi parce que là, moi ma mère se cachait, fallait pas que le monde sache qu’elle était Autochtone parce que c’était une « sauvage » […] fait que, MOI, je suis sorti du placard ça fait peut-être vingt ans, et aujourd’hui j’ai trois filles puis je les pousse, je les pousse, « gênez-vous pas mes filles dites-le que vous êtes Autochtones, c’est important ».
En même temps que les préjugés des adultes persistent selon Michel, il y a une conscientisation et un intérêt croissant à l’endroit des Premières Nations au sein du Québec, tantôt dérivant d’un mouvement de décolonisation global, d’Idle No More, d’une Commission de vérité et réconciliation, ou de l’accès à l’information véridique grandissant. Selon l’équipe,
[…] et on sent de l’intérêt aussi, l’intérêt dans le passé venait plus des Européens, tandis que maintenant on voit un intérêt de connaître l’autre au sein du Québec et c’est pour ça qu’une Maison amérindienne a sa raison d’être, elle a été pensée pour ça (Chantal).
[…] il y a de plus en plus de monde qui commence à réaliser que les Autochtones ont une importance. […] Ils restent surpris de voir que chez les Autochtones, y a beaucoup d’artistes, des bons artistes. Autant musical, autant chant, autant peinture. On se rend compte qu’un Autochtone c’est un être humain à part entière (Richard).
Quand tu fais [une visite à un] groupe de petits puis que là ils lèvent tous la main en même temps parce qu’ils ont des questions sur le mode de vie, sur qu’est-ce qu’il se passe, sur, est-ce qu’il y en a encore aujourd’hui des Amérindiens, […] ils VEULENT en apprendre. On le voit, quand on anime les groupes, ne serait-ce que dans le temps des sucres même, toute l’interaction qu’on a, les questions que les gens nous posent quand on accueille les visiteurs (Audrey).
L’aspect positif de [la protection environnementale unanime chez les Premiers Peuples] c’est que… prends David Suzuki, il s’inspire des peuples autochtones, prends Hubert Reeves, Hubert Reeves il s’inspire des peuples autochtones, il y en a combien comme ça […] ce sont les Amérindiens qui ont pris le leadership pour le sauvetage je dirais de l’Île d’Anticosti, mais ils étaient pas TOUS SEULS là-dedans, les gens ne se sont pas tous manifestés ouvertement mais par contre nos cœurs partout, partout à travers le Québec, tous les gens étaient D’ACCORD avec les Amérindiens […] Donc ces gens-là [Suzuki, Reeves…] qui sont de grands visionnaires reconnaissent [ton bas] l’importance des peuples autochtones (Michel N.).
Les réalisateurs du même documentaire Rencontre, Mélanie Carrier et Olivier Higgins (2011), montrent que la notion prometteuse de rencontre implique de pouvoir mieux vivre ensemble : ils retracent le parcours de 310 kilomètres allant de Pekuakami / Lac Saint-Jean à Québec, rassemblant un groupe d’Innus, de Wendats et de Québécois empruntant un sentier autochtone datant de 4 000 ans et marchant dans les pas des ancêtres. Ils sont invités à devenir des outardes, ces oiseaux migrateurs qui travaillent en équipe, demandant tolérance et ouverture d’esprit et faisant tomber beaucoup de barrières. Le potentiel du rapprochement entre peuples est présent à travers la cause environnementale, comme le récit de Michel en témoigne, et à travers la rencontre éducative qu’opère le musée multi-nations.
4.3 Apprentissage, connaissance
La dynamique des préjugés repose essentiellement sur le fait de connaître ou non l’autre, comme le diagnostiquait Lepage (2009). Un exemple puissant puisque relié à la langue, sujet sensible au Québec, témoigne des avancées constatées par Lepage (cité dans Tourisme autochtone Québec, 2018) étant donné que le dialogue est à présent ouvert : la musicienne Kathia Rock a réussi à contourner l’impératif linguistique français de la loi 101 en diffusion musicale afin de compiler des œuvres en langue originale de différents artistes autochtones et d’autres origines vivant au Québec. Rock a pour objectif de faire entendre les langues autochtones au Québec, mais elle met surtout l’accent sur l’apprentissage (GRIAAC-UQÀM, 2018). En entrevue, André souligne que « le meilleur moyen de protéger une culture, c’est de la faire connaître le plus possible » (Labrosse, 2018). C’est peut-être pour cette raison que Michel et Richard mettent l’accent dans leur discussion sur l’espoir qu’il y a avec les jeunes, qui sont en grande période d’apprentissage et d’ouverture sur le monde. Mieux faire connaître les Premières Nations est inhérent à la mission première de l’organisation et se fait au quotidien, comme l’explique Audrey :
Souvent on a des gens qui ne savent absolument pas grand-chose sur les Autochtones, et qui arrivent en nous disant, est-ce qu’ils vivent encore dans les tipis ? [L’Européen] va s’attendre à voir des plumes, et là pour nous notre travail c’est justement de DÉMYSTIFIER l’image folklorique de l’Autochtone, de la Première Nation, d’expliquer que c’est pas parce que t’es blonde aux yeux bleus que t’es pas autant une membre des Premières Nations que quelqu’un qui a les cheveux noirs. […] On est beaucoup aussi dans le « braver les préjugés », comme les « avantages » de résider dans des réserves, […] bien souvent certains Québécois vont arriver en se disant, « moi je connais », et ils se rendent compte que [plat de la main sur la table] NON, et d’autres que finalement ils disent bien […] « ok, j’avais entendu les bonnes choses, j’étais allé(e) lire aux bons endroits ». Souvent les personnes âgées vont arriver et nous dire, « moi à la petite école c’étaient les méchants Iroquois puis c’était… », bien on va leur expliquer […] c’est parce qu’ils étaient alliés aux AnglAIS à l’époque de la Nouvelle-France […] nous devons tout remettre en perspective ce qu’ils ont apPRIS […] C’est du remettage de pendule à l’heure qu’on fait avec tous les groupes, mais oui c’est ça c’est beaucoup d’actualiser les connaissances.
En moyenne les gens en apprennent beaucoup sur les différentes nations autochtones (Louis-Xavier).
Je pense que tout réside dans… l’éducation. Former, former les gens, les éduquer, puis cette éducation-là, c’est pas rien que le musée qui doit faire ça, le Ministère de l’éducation […] l’éducation là cest pas un one shot deal là, l’éducation ça se fait tout le temps tout le temps tout le temps, le petit grain de sable que tu mets puis un autre petit grain de sable, puis tu finis par construire ta pyramide (Michel N.).
J’ai fait référence au travail patrimonial de La Maison qui relevait de l’expérience émotionnelle d’ignorance/connaissance (ignorance/knowledge) (De Courville Nicol, 2011). La connaissance est la capacité de confronter notre manque de compréhension par le biais de l’apprentissage, en relation dialectique avec l’incapacité incorporée qu’est l’ignorance (p. 32). Conjointement, la familiarité est la capacité de confronter des forces qui nous sont inconnues, et la non-familiarité la peur déclenchée par la perception de ne pas avoir cette capacité (p. 35). Ce sont ces sentiments découlant d’une forme de confrontation qui sont dirigés au quotidien par le musée à travers son mandat éducatif. Évidemment, les émotions impliquées peuvent se mélanger et se superposer pour découler de l’évitement ou de la prévention, par exemple (De Courville Nicol, 2011) ; on pourrait chercher à en savoir le plus possible à propos des Premières Nations pour éviter le choc culturel ou pour éviter de perpétuer une dynamique coloniale en milieu de travail, par exemple.
Questionner les connaissances et, par extension, le manque de connaissances des Premières Nations des visiteurs semble être assez fréquent lors des animations au musée. Ils se voient demander quelles sont les onze différentes nations présentes au Québec ; comment savoir, en observant les indices dans la nature, lorsque le temps des sucres débute et se termine officiellement ; ou ce que représentent plusieurs animaux dans la cosmologie autochtone. C’est encore l’inclusion qui est véhiculée, les visiteurs étant appelés à s’approprier ou se souvenir de connaissances sur les Premières Nations. La connaissance est aussi comprise par l’équipe comme quelque chose qui vient enrichir son propre parcours de vie et celui d’autrui, mais qui a des conséquences aux niveaux personnel et social lorsque manquante ou défaillante :
Il faut connaître le patrimoine amérindien. Toute personne dans la vie doit connaître l’histoire de son peuple et sa propre histoire. Si tu connais pas l’histoire de ton peuple, tu sais pas QUI tu es, puis tu sais pas quelles sont les GRANDES valeurs que tu devrais transporter ou avoir en toi, et puis, je remarque que le patrimoine, on a tendance à dire « c’est le passé », mais le patrimoine c’est le futur, le patrimoine qu’on a puis qu’on transporte, cette fierté, puis nos valeurs de justice, et puis tout ça, ça nous projette dans le futur (Michel N.).
L’autre fois il y avait une jeune parmi un groupe d’école aux adultes, retour à l’école, ils ont choisi une animation sur les Amérindiens d’aujourd’hui. Je voyais qu’il se passait quelque chose, il y a eu un DÉCLIC […] elle a dit « est-ce que c’est permis aux non-Autochtones d’aider les Autochtones ? » j’ai dit « bien oui ! » elle m’a dit « moi j’aimerais ça », « je viens d’allumer », « je veux faire reconnaître leurs droits, je veux militer je veux travailler pour ça », fait que je l’ai vu, la mission du musée se concrétiser, je peux pratiquement dire le moment dans ses yeux que le déclic s’est fait, qu’elle a comme compris quelque chose […] (Audrey).
Dieu sait qu’au Canada puis au Québec nos systèmes d’enseignement ont été défaillants, ont été pauvres […] on n’avait RIEN rien nous quand on était jeunes pour apprendre NOTRE culture, et les jeunes Québécois non plus n’avaient rien pour apprendre notre culture. Il y a du matériel. Mais il faut aussi former les profs (Michel N.).
Le Québécois ne se souvient même PAS de son histoire […] parle à beaucoup de jeunes Québécois de ton âge là, puis demande-leur c’est qui leurs arrière grands-parents : ils le savent pas. Ils savent pas l’histoire de leur famille, ils connaissent l’histoire de leur famille immédiate mais PAS l’histoire de leurs grands-parents ou de leurs arrière grands-parents (Richard).
Les fonctionnaires qui les étudient, s’ils connaissent pas les valeurs que véhiculent les Autochtones, ils mettent le projet de côté. Alors il faudrait que dans les ministères les gens soient formés et sensibilisés (André).
Comme conséquence du phénomène incapacitant identifié par Richard selon lequel les Québécois ne se souviennent pas de leur histoire intergénérationnelle, on peut penser à ce que Bourdieu (1992) définit comme la fragilité de la transmission intergénérationnelle, transmission qui est pourtant une source de pouvoir : « La tendance du patrimoine (et, par là, de toute la structure sociale) à persévérer dans son être ne peut se réaliser que si l’héritage hérite l’héritier » (p. 30). Selon Bourdieu, la relation d’appropriation réciproque entre individus et patrimoine matériel, social, culturel et symbolique est en danger si la ou les personnes ne sont pas disposées ou aptes à en hériter. On pourrait en faire l’hypothèse quant au patrimoine et l’histoire autochtones avec lesquels la société québécoise a été et est en contact. Cette société, influencée par son élite intellectuelle et dirigeante, s’est distanciée notamment de ses réalités de métissage pour mettre de l’avant ses différences culturelles par rapport aux Autochtones auprès du Canada anglais, et même de la France, qui adoptait un paradigme évolutionniste déformé (Gélinas, 2007). Depuis ce moment, il y a eu une fragilité de la transmission intergénérationnelle. Comme l’histoire en fait état, ce contexte a eu des conséquences désastreuses sur la viabilité et la continuité des peuples autochtones, qui « persévèrent dans leur être » admirablement.
Ensuite, de façon générale, on doit nuancer la question de l’accès au plus grand nombre, l’accès universel au savoir cher au milieu muséal, quant au patrimoine autochtone : mettre en valeur signifie-t-il nécessairement tout mettre en valeur ? Un musée devrait-il tout démocratiser ? Le musée laisse de côté les thèmes entourant la spiritualité, laissée à chacun-e, mais ouvre son site à des cérémonies tenues par des groupes et fait certains rituels traditionnels tels la purification en début de visite lors des Jeudis culturels. Nous avons vu que l’accent est sur la célébration des cultures autochtones davantage que sur les problématiques sociales, sans pour autant ignorer leur existence. L’anthropologie muséale stipule qu’il y a parfois nécessité d’accueillir l’inconfort et les conséquences de ne pas tout exposer, notamment les dépouilles inhumées (CMA, 2017) et le patrimoine sacré, par simple respect envers les communautés concernées (CCI, 2015). Plusieurs aînés et membres de diverses nations s’opposent même à la discipline archéologique, stipulant que l’on n’a pas forcément besoin d’ouvrir les tombes pour apprendre d’où l’on vient (Clifford, 2004). Il n’en demeure pas moins que le potentiel que représente la connaissance est matérialisé par le modèle de La Maison amérindienne en respect de ces considérations. Voyons comment le phénomène d’apprentissage se déroule dans les musées en général.
4.4 Psychologie de l’apprentissage au musée
Puiser dans les études sur les visiteurs, une branche de la muséologie, permet de mieux comprendre les publics en visite au musée. Pour Screven (1992), il y a une forme de perfection si l’expérience de visite correspond conjointement aux besoins des visiteurs et ceux des réalisateurs (d’exposition, mais on peut aussi penser aux conférences, animations, spectacles et repas dans cette analyse). Cette idée montre la dynamique d’encodage et de décodage idéal dans la théorie de Hall, qui s’applique aux musées dans ce cas-ci. Cela montre aussi le souci de réaliser des expositions complémentaires aux tendances naturelles des visiteurs pour faciliter une expérience optimale et la rétention des messages envoyés par le musée. Pour Kaine (2004), le succès d’une mise en exposition repose sur la possibilité pour les exposants de s’identifier aux éléments muséographiques de l’exposition, et la possibilité pour les visiteurs de s’identifier à son contenu.
Je présente quelques éléments de la psychologie des visiteurs principalement adultes dans un contexte d’apprentissage au musée tels que développés par Colette Dufresne-Tassé (et al., 1991 ; 2010), et ce en quoi consiste l’expérience de visite d’expositions selon Davallon (1986). Pourquoi se concentrer sur les adultes plutôt que les jeunes ? Ils sont le groupe qui influence le plus directement l’orientation de la société de par leur occupation, et je prends pour point de départ le résumé de Michel Noël dans sa discussion sur l’éducation et la relève :
Les adultes ont des préjugés puis c’est inDÉcrottable [rires], […] pourquoi, c’est parce que l’adulte qui a le préjugé il a ça depuis son enfance ça lui a été transmis par son père, par sa mère, par ci pis ça, c’est ANCRÉ un préjugé. Bon. Alors que les jeunes, c’est pour ça que j’ai écrit pour les jeunes, les jeunes là, tu leur parles de ça puis ils sont tout ÉMERVeillés, ils sont ouverts […]
Je présente des éléments d’apprentissage par une narration à la première personne pour se mettre dans la peau du visiteur au musée, que l’on comprend ici comme un processus de visite dynamique et incorporé : je vais bien au-delà d’être intéressé-e par le contenu et la structure de l’exposition que je visite (Dufresne-Tassé et al., 1991 ; Dufresne-Tassé, 2010). Lorsque j’y entre, je sors de mon monde connu et j’enchaîne des actes : je marche, fixe mon regard, lis, vois, m’éloigne, compare, me souviens, réfléchis, discute, et interagis avec les objets et autrui. Ce voyage est le fait de ma subjectivité et du travail de l’équipe de conception qui cherche à « alterner des salles dont [je perçois] d’un seul coup d’œil les frontières et des espaces étroits qui [me] contraignent à [me] plier aux proximités et aux contiguïtés, à regarder les objets l’un après l’autre. [Je] combine points de vue d’ensemble et juxtaposition de regards sur le particulier, sur le détail » en un va-et-vient entre divers éléments d’exposition (Davallon, 1986, p. 251). Lors de ma visite, j’effectue divers types d’opérations, qui ont une utilisation principalement rationnelle, imaginative ou affective, et qui sont généralement « manifester, constater, identifier, se rappeler, associer, distinguer-comparer, saisir, expliquer-justifier, résoudre-modifier-suggérer, s’orienter, vérifier, et évaluer » (Dufresne-Tassé et al., 1991, p. 284-285). Je concentre mon foyer d’attention sur les éléments d’exposition. J’ai une certaine manière d’aborder les réalités données dans le parcours, et j’ai un degré de certitude qui oriente le tout ; je suis non pas une observatrice passive de l’exposition mais bien en interaction constante avec ses éléments (Dufresne-Tassé, 2010). Je concentre généralement mon attention sur les dimensions sensorielle, active, émotionnelle et sociale des objets présentés (couleurs, formes, mouvement, contact, odeurs, matière) en partageant mes impressions (Screven, 1992). Je vais consacrer plus de temps à ce que je connais et à ce qui me divertis, à ce dont j’ai déjà eu affaire (Candito et al., 2013). En termes de satisfaction, je tirerais le plus grand plaisir de mon fonctionnement psychologique, intensément sollicité pendant l’expérience de visite (Dufresne-Tassé et al., 1991, p. 282). J’éprouve le plaisir sensoriel et perceptuel d’être dans le lieu de visite, de déambuler, d’écouter, de sentir et de regarder ; il s’agit d’une immersion.
L’idéal muséal selon lequel les visiteurs viennent au musée avant tout pour s’instruire a été bouleversé par les faits des études sur les visiteurs, révélant une réalité plus complexe et un apprentissage plus rare que ce qui était initialement assumé (Dufresne-Tassé et al., 1991, p. 282). Venir au musée peut être aussi pour se remémorer, surtout chez les personnes âgées ; pour se divertir ; ou même pour se ressourcer comme en témoignent les propos de Chantal sur l’homme se réénergisant autour des sculptures d’une exposition temporaire. Pour Dufresne-Tassé et al., une pédagogie muséale doit permettre le « développement culturel » (p. 281) des visiteurs adultes et repose sur la connaissance de leur dynamique d’apprentissage au musée ; en ce sens, la pédagogie de La Maison amérindienne permet une acquisition de connaissances liées au patrimoine culturel autochtone et québécois. Les autrices ont développé un outil intégrant l’autonomie du visiteur ainsi que le potentiel d’influence de l’exposition suivant la consultation de visiteurs provenant de divers milieux. Il ressort de leurs études de visiteurs que l’apprentissage, dans les faits plus rare qu’on le suppose, est une fonction du fonctionnement psychologique des visiteurs, parmi d’autres fonctions et en relation avec celles-ci. Les visiteurs donnent beaucoup d’importance à ce fonctionnement. Il est donc le contexte de l’apprentissage, mais il y a définitivement ouverture à l’apprentissage chez les visiteurs adultes.
En effet, dans leur revue de littérature sur l’apprentissage muséal, Dudzinska-Przesmitzki et Grenier (2008) notent que les adultes demandent activement à apprendre dans les programmes muséaux auxquels ils prennent part ; et qu’il y a un important apprentissage non formel initié par les visiteurs au musée – c’est-à-dire que les décisions d’apprentissage relèvent non du musée mais du visiteur. Ils influencent leur propre apprentissage principalement par leur bagage cognitif et émotionnel qui consiste en leurs motivations, intérêts, connaissances et dispositions initiales à la visite. L’apprentissage le plus efficace se produit lorsque les visiteurs recherchent apprentissage et divertissement en visitant le musée. D’autre part, le rôle éducatif des musées se manifeste surtout dans une mise en espace qui maintient une interaction et une motivation chez les visiteurs, par exemple par la manipulation et l’exploration plutôt que par la mémorisation intensive. Cette mise en espace inclura idéalement des vignettes affichant des propos explicites et clairs, à la manière d’« organisateurs conceptuels » (p. 17).
Il n’en demeure pas moins que « s’il est impossible de provoquer tout ce que vit un adulte au musée, il est probablement possible de l’aider à réaliser certaines opérations, comme identifier, comparer ou expliquer » (Dufresne-Tassé et al., 1991, p. 289), l’apprentissage étant une modalité possible de ces opérations. Connaître les séquences d’opérations effectuées par un ensemble de visiteurs ou des publics spécifiques, dont les douze opérations énumérées ci-haut, peut faire office de base sur laquelle orienter pédagogiquement une exposition – une animation ou une conférence dans l’espace muséal aussi sans doute – pour favoriser et maintenir certaines opérations psychologiques en particulier. Par exemple, la visiteuse de l’école aux adultes qui a eu un déclic sur sa vocation juridique ainsi que les Québécois-es qui actualisent, confirment ou infirment leurs idées à l’endroit des Autochtones, tous évoqués par Audrey, ont des réactions de l’ordre des opérations de saisir, se rappeler et constater (ce qui fait appel au fonctionnement rationnel, imaginatif et affectif), ainsi que vérifier (fonctionnement rationnel) (p. 285). Par ailleurs, le musée semble maintenir cet équilibre entre être à l’écoute des visiteurs – on pense à son adaptabilité dont le chapitre organisationnel traite – et les orienter dans une certaine direction, comme l’envisage Louis-Xavier sur ce que les visiteurs devraient apprendre en visite au musée : « Nos rencontres sont personnalisées avec ce qu’ils cherchent eux à savoir. Mais les expos ou événements ont un grand impact sur ce qu’ils vont vivre comme expérience. »
La complexité psychologique et émotionnelle inhérente à la visite d’expositions apparaît aussi dans la discussion de Clifford (2004) sur l’exposition Looking Both Ways en Alaska. Il souligne la variété d’émotions soulevées par l’interaction des visiteurs Alutiiq avec les objets culturels de leur héritage in situ, ayant été préservés ailleurs que dans leur lieu d’origine depuis une centaine d’années : ce sont la tristesse, la reconnaissance (au sens de se remémorer), la gratitude et le sens de la parenté, de l’affiliation. C’est dire qu’une expérience de visite unique peut susciter de nombreuses réponses émotionnelles, réflexions et associations ; une seule visite peut avoir une influence durable sur une personne quant aux relations qu’elle entretient. La mise en valeur du patrimoine à La Maison amérindienne offre un contexte capacitant pour les visiteurs, quelle que soit leur origine culturelle grâce à son approche multi-nations inclusive et sa vocation éducative. La prochaine section traite de ce qu’une visite peut solliciter auprès des publics, notamment ceux qui représentent la société majoritairement québécoise sur le territoire.
4.5 « Je me souviens » différemment : la rencontre
L’expérience entourant l’image identitaire positive représentée par le musée, et tout musée tribal en général, apparaît comme émotionnellement capacitante pour les publics et les employés affiliés aux Premières Nations, en ce qu’elle alimente une solidarité et une curiosité envers sa culture d’origine, et celle des autres Premiers Peuples qui partagent tous des traits communs à l’indigénéité. Cette expérience confirme les ressources, savoir-faire et forces inhérentes à ladite culture ; et elle permet une rencontre sur un pied d’égalité avec autrui étant donné la présence d’un discours valorisant dans un lieu officiellement autochtone. En outre, apprendre sur les diverses Nations cousines est capacitant également au sens de Dubuc et Turgeon (2004) qui observent que « l’idéal patrimonial est de renouer avec la culture ancestrale, perdue par des siècles de colonisation. L’Autre, pour les Cris de Chisasibi, ce n’est pas le Blanc, mais le Cri des Plaines, son cousin qui séduit par sa spiritualité et son costume haut en couleurs » (p. 15).
L’expérience muséale à La Maison semble également capacitante pour ses employés non-autochtones en ce que leur travail patrimonial constitue en soi en une participation concrète à des actes de réparation, de « réconciliation ». Avec les propos de l’équipe et mon expérience de sensation participante sur le site, les publics non-autochtones semblent généralement y trouver aussi une expérience émotionnellement (et ultimement) capacitante car elle remet en question de potentiels préjugés, confirme ou apporte des connaissances, voire une conscientisation ; elle permet une rencontre sur un pied d’égalité par ce que révèle le patrimoine autochtone au Québec. Je m’attarde sur le phénomène auprès de ce type de public, car La Maison amérindienne vient remettre « les pendules à l’heure » surtout auprès des non-autochtones québécois.
À la question de ce que les visiteurs québécois devraient connaître ou apprendre, les membres de l’équipe du musée évoquent surtout le souci de se remémorer l’exactitude des faits et la dynamique relationnelle qui en découle. Chantal répondait avec le sourire que ce qu’ils devraient savoir « à prime abord, c’est pas ce qu’on leur a appris dans les livres d’histoire » et cela fait écho avec le commentaire d’Audrey qui remet tout en perspective pour les personnes âgées ayant appris la version des « méchants Iroquois » à la petite école. André Michel répondait
[…] ceux qui se disent les premiers, en fait ils sont les seconds arrivants, les Québécois et les Canadiens, oublient que les Autochtones de ce pays n’ont jamais été conquis, et qu’à quelque part on leur a tout volé tous leurs territoires. Donc c’est une relation géopolitique qui n’est pas claire.
Cette relation géopolitique floue explique le maillon faible et l’impact sur la qualité des relations entre Autochtones et non-autochtones dans la province, car comme il était détaillé plus haut, la notion de territoire est vitale à l’identité autochtone. À moins qu’il y ait un investissement autodidacte à apprendre, la relation géopolitique n’est pas claire au niveau personnel pour le Québécois moyen qui oublie ou a appris son histoire familiale et collective de façon tronquée, ni au niveau social à travers une narration nationale erronée. Cette narration est passivement emcouragée par les gouvernements (Saul, 2014), construite autour de deux peuples fondateurs oblitérant la superposition euro-américaine de frontières sur les territoires ancestraux et les relations à ces territoires. Cette narration masque également la participation économique continue des Autochtones au développement du Québec et du Canada, légitimant de ce fait l’entreprise coloniale européenne en Amérique du Nord (Gélinas, 2007). Dans les faits, il y a eu un contexte ininterrompu de cohabitation et d’influence réciproque entre Autochtones et non-autochtones comme le démontre le travail de Claude Gélinas (2007). Dans son récit, André confirme cette situation en abordant les préjugés :
quand le gouvernement donne X millions, comme ils ont fait pour les Cris ça sert aussi à relancer l’économie de la région […] il commence à y en avoir un petit peu des professionnels autochtones pour en profiter, mais pendant très longtemps il y en avait pas, et encore moins des marchands de matériaux qui étaient des Autochtones, donc l’argent était dépensé dans la communauté blanche et ça servait à relancer l’économie mais les Québécois ne voyaient pas ça.
Pour Pierrot Ross-Tremblay (Innu) et Serge Bouchard (Carrier & Higgins, 2014), les mythes fondateurs des Amériques sont aberrants et doivent être corrigés : la Nouvelle-France part de l’idée du terra nullius, c’est-à-dire l’absence de gestion et d’occupation officielle du territoire avant l’arrivée des Français, idée qui assure la légitimité de la présence coloniale sur le territoire. Bouchard fait une généalogie du mythe de la francité des Québécois au détriment de la réalité du métissage, de la « créolisation », et de la descendance de mariages entre Français et femmes autochtones (par exemple, les alliances entre Mi’kmaq et Acadiens) :
On va euthanasier le métis […] partout en Amérique il y a eu ce métissage. La question à poser c’est pourquoi nous ne l’avons jamais su ? […] ou est-ce qu’on s’est séparés, ou est-ce qu’on a tué la mémoire ? […] c’est le clergé qui va interdire le récit métis. Dès le début du 20e siècle, le clergé va inventer le mythe de notre francité. Nous sommes des Français. […] C’est le résultat du racisme scientifique […] Les êtres humains ne sont pas égaux devant Dieu […] et le résultat net c’est que les Indiens vont disparaître totalement du radar de notre mémoire (cité dans Carrier & Higgins, 2014, 26:37).
Gélinas (2007) souligne que par idéologie, méconnaissance ou absence de reconnaissance, non-Autochtones et Autochtones au Québec ont marginalisé les gens issus du métissage direct, les plus à même de représenter la proximité entre ces deux groupes d’appartenance (p. 181).
Richard disait par ailleurs que le Québécois « ne se souvient plus de son histoire », que « le Québec réalise pas que les Français de l’époque ont brimé le droit de beaucoup d’Autochtones que ce soit sur la langue, que ce soit sur la façon de faire, la religion ». La conjoncture sociohistorique décrite ci-haut, malgré la toponymie rappelant constamment que « d’autres avant les Canadiens avaient sillonné les forêts de l’intérieur », voyait les Canadiens français se concentrer sur leur « destin national » (Gélinas, 2007, p. 104) et sur l’assurance de leur propre continuité culturelle en relation à un empire britannique ayant opéré une forme de colonialisme à leur endroit jusqu’à récemment dans l’histoire. Gélinas note que plusieurs nationalistes pouvaient même voir les obligations envers les Autochtones comme des concessions (sic) envers le Canada anglais, expliquant en partie la réserve et la résistance envers les Autochtones.
Ainsi, le contexte d’affirmation identitaire en période post-confédérale au sein d’un état fédéral, allié à un clergé contrôlant entre autres l’éducation et le discours historique jusqu’à la Révolution tranquille sont deux facteurs qui, selon Gélinas, ont laissé une place de choix à des fausses représentations dans l’imaginaire collectif, et peu de présence autochtone dans les représentations artistiques : poésie, théâtre et peinture. En outre, après la dépression économique des années 1930, les « affaires » avec les Premières Nations relevaient désormais du fédéral, de là une implication étatique provinciale et citoyenne plus restreinte en la matière, ce qui implique une connaissance restreinte de l’autre. Ainsi, Gélinas statue que
ces réflexes, humains [de se distancier en ce qui a trait à l’identité en temps de proximité et d’envier chez l’autre des vertus en temps d’éloignement] auront eu pour conséquence d’entretenir une vision des rapports entre Autochtones et non-autochtones ancrée dans l’imaginaire plus que dans le réel, et c’est précisément à cette représentation imaginaire qu’il faudrait essayer aujourd’hui d’échapper si l’on souhaite un réel rapprochement, ce qui ne pourra se faire sans efforts de part et d’autre (p. 228).
L’histoire québécoise et autochtone implique des alliances franco-autochtones tantôt maintenues, tantôt rompues, que le musée encode et incite à poursuivre. Wiseman (2001) brosse un portrait des relations entre Abénakis et Français avant le traité d’Utrecht (1713), lequel a été vécu par les Abénakis comme une trahison, mais l’alliance s’étant malgré tout poursuivie :
Unlike the Blacmonak [Français], who wanted our furs and help, the Bastaniak [Anglais de Boston] wanted our land. […] The woodsmen [Les coureurs des bois canadiens français] often married our women, lived with us through the winter, learned our language, and traded us goods for our furs. They regaled us with stories of our far relatives and the cities of Europe from whence they came (p. 87).
Les relations de collaboration franco-autochtones, notamment avec les Mi’kmaq, les Abénakis et les Wendat se présentent comme des éléments de remémoration des visiteurs québécois en visite dans un musée tribal. Pour un visiteur de La Maison amérindienne, se faire rappeler ou actualiser le fait que des symboles culturels forts tels la cabane à sucre ou les épluchettes de maïs sont en fait inspirés des pratiques autochtones participe d’une réorientation de la mémoire collective et reconnaît la présence, l’apport et les savoir-faire des Premières Nations. Un discours portant sur une partie du patrimoine québécois hérité des Premières Nations est en effet encodé au musée. Les Repas du temps des sucres en sont un exemple particulièrement significatif et agissent comme un pont, un espace commun entre nations : « La cabane à sucre au Québec vient des Algonquiens qui invitaient les Européens à leurs rassemblements du préprintemps », disait Audrey lors de ses animations de groupe. Ces grands rassemblements du préprintemps (cigon en attikamekw) avec chants, danses, nourriture et jeux, où des Français étaient invités, ont inspiré la tradition de la cabane à sucre québécoise avec rigodon et rencontres festives.
Encore, l’exposition itinérante J’épie… le maïs (été 2018) est un partenariat de La Maison amérindienne avec la Maison LePailleur à Châteauguay, qui met de l’avant l’histoire locale et le site de l’ancienne maison patriote bicentenaire avec son potager ancien utilisant les techniques agricoles autochtone, française et anglaise, et qui collabore avec la communauté de Kanhawake pour célébrer la fête du maïs. Cette exposition présente un discours clair de l’héritage autochtone du « blé d’Inde » au Québec : « Offrande dorée et savoureuse, don délectable et exquis transmis par les Amérindiens, notre petit ami aux grains dorés fait partie intégrante des plaisirs de l’été » ou encore « [La traditionnelle épluchette] est un héritage des Amérindiens qui, à l’époque, au son du tambour organisaient de grandes fêtes et cérémonies pour célébrer la récolte […] Les colons français ont conservé cette tradition en invitant, à la période des moissons, tout le monde pour éplucher et égrener les épis de maïs » (texte du panneau « La fête du maïs »).
Il y a une ligne souvent mince entre reconaissance et continuité du rapport colonial selon l’idée « nous venons tous du même endroit » véhiculée par des instances détenant un grand pouvoir décisionnel, comme le cas de l’Inde ou du Japon, un enjeu abordé dans les travaux critiques de Coulthard (Dene) (2014) et Alfred et Corntassel (2005). Dans le contexte du musée multi-nations autochtone toutefois, ce type de discours agit comme un rapatriement intellectuel, un rapatriement du patrimoine intangible des Premières Nations, leur reconnaissant publiquement l’origine culinaire ou de savoir-faire particuliers. Selon la théorie de Hall, le code véhiculé par le musée ferait associer divers aliments et symboles culturels québécois à une origine indigène. Le langage muséal passe notamment par des signes linguistiques (mots, chants et paroles), visuels (images et peintures), matériels (objets de collection) et même gustatifs (nourriture que l’on mange lors des dégustations). Le moment du décodage semble entraîner une lecture en accord avec la vision du musée, la véracité des propos sur cette origine étant difficile à démentir.
Cette reconnaissance des Premières Nations peut être une découverte, une actualisation ou également une confrontation de la perception de soi par le rappel que les Québécois et les Canadiens français ne sont donc pas de « purs » Français ayant tout inventé et développé, ni ne sont autochtones, mais portent un héritage complexe et colonial né du mélange de ces cultures (ou plus) de façon variable d’un individu à l’autre. Le dépliant promotionnel du musée propose par exemple une lecture négociée des récits sur les coureurs des bois, personnages emblématiques et ancêtres de nombreux Québécois et Métis de l’Ouest. Ils « ont délibérément adopté le mode de vie des Amérindiens et épousé les valeurs qui privilégiaient la liberté et le respect de la nature. Comme l’histoire officielle fait peu de cas de leurs exploits, malgré leur influence déterminante sur le continent, La Maison amérindienne vous propose de mieux comprendre […] ».
Puis, à l’heure de la tire sur la neige lors d’un Repas des sucres, une femme âgée discutait en petit groupe et a dit qu’en fait « on vient des Amérindiens ». J’ai renchéri « ça a longtemps été caché », et elle de me partager fièrement qu’elle avait de la descendance algonquine et wendate dans sa lignée paternelle, et moi de lui partager en retour des ancêtres Wendat du côté maternel. Ce moment représente le genre de réflexion identitaire que peut susciter une visite au musée, c’est-à-dire une prise de conscience ou alors l’actualisation des connaissances, qui peut afficher le rapport colonial et ses omissions, tout comme la réalité du métissage – surtout culturel davantage que généalogique au sein de la société québécoise. La visite implique la remémoration d’une partie de leurs racines et les relations qui les sous-tendent pour les Québécois de descendance française – et même ceux issus d’immigration plus récente, car ce patrimoine autochtone culturel, sinon généalogique, est fort présent sur l’ensemble du territoire. L’expérience de ce que je nomme « Je me souviens différemment » signifie reconnaître ultimement, au-delà de l’histoire distincte d’un peuple francophone minoritaire par rapport à la confédération canadienne et à l’Amérique du Nord, la racine étymologique du gentilé et de l’identité québécoise ancrée dans la notion du lieu et du territoire, en relation avec les nations occupant ce territoire et ayant aidé les Québécois-es à « persévérer dans leur être ». Cette racine étymologique est née de la famille linguistique algonquienne qui offre de nombreuses variantes orthographiques du toponyme, kebec signifiant « là où c’est bouché ». Tantôt Kephek, Kebhek de l’Abénaki, Kepek et gepeg en langue moderne Mi’kmaq pour « débarquer », désignent à la fois « là où c’est fermé, bloqué, obstrué » et le rétrécissement d’un cours d’eau, le locatif ek correspondant à « là où ». La forme impérative en innu-aimun kepek signifie « descendez » (Commission de toponymie Québec, 2019, 5). La version que j’ai apprise en grandissant est « là où le fleuve se rétrécit », qui vaut autant pour la réalité géographique de la ville de Québec que la grande région de la Vallée du Saint-Laurent.
La prise de conscience au musée peut également et idéalement en être une dans le sens de l’expression « remettre les pendules à l’heure » sur les réalités autochtones, comme l’expliquait Audrey avec la « démystification » de l’Autochtone auprès de presque chaque groupe. Détaillant la scène brodée sur un manteau inuk d’un ours mangeant un phoque avec des loups rôdant autour, scène qui avait choqué la jeune fille non-autochtone ayant reçu le manteau à l’origine, on me mentionnait qu’il s’agit de la réalité des Inuits ; ils représentent ce qu’ils vivent au quotidien. Pourquoi inventeraient-ils une réalité qui n’est pas la leur ? Toute la notion de représentation de soi détaillée par Smith (2012) actualise les réalités autochtones et montre aux non-autochtones un portrait plus réaliste de leur univers, qui n’a pas besoin de plaire à l’imaginaire occidental. Le travail patrimonial de déconstruction des idées préconçues et de performance ou d’exposition artistique autochtone correspond ni plus ni moins à ce que Adese (2015) voit comme une souveraineté visuelle artistique qui “represent back” et “write forward” (p. 134).
Au final, c’est peut-être et surtout le degré de certitude et la manière dont le visiteur aborde la réalité identifiés par Dufresne-Tassé (2010, p. 4) qui sont mis à l’épreuve chez les visiteurs non-autochtones à La Maison amérindienne. Là où on pensait tout savoir du sirop d’érable si fortement associé à la québécité, et bien non ! Son origine et son procédé de fabrication initial sont en fait hérités des peuples autochtones. Malgré cette possible source de remise en question identitaire, d’ambivalence et de malaise, l’appel aux références d’un public québécois est encodée au musée dans ses discours et semble faciliter la rencontre par l’accent sur des histoires communes aux peuples. Ces références se font par exemple dans les discours écrits des expositions tels le parallèle « La “Révolution tranquille” des Iroquoïens » dans l’exposition J’épie… le maïs, qui traite du grand changement de mode de vie apporté par l’adoption du maïs chez les peuples autochtones concernés.
Les références à un patrimoine commun se font aussi dans le temps de la Journée nationale des Autochtones et de la fête de la Saint-Jean Baptiste, entre le 22 et le 26 juin selon les années, avec le « Grand rassemblement » des coureurs des bois. Ici, la force du créneau multi-nations axé sur l’apprentissage s’exprime aussi à travers son contexte temporel en tenant le Grand rassemblement autour de la Saint-Jean Baptiste. Peut-être que tenir systématiquement cet événement le jour de la fête québécoise symboliserait encore davantage le signe temporel d’un discours sur l’apport autochtone indéniable sur les plans commercial, culturel, politique et généalogique du patrimoine québécois. Si cela se tenait en constraste le 21 juin, ce serait le signe temporel d’un discours imposant la présence européenne dans les célébrations de l’autochtonie, considérant que la Journée nationale des Autochtones est officialisée depuis peu dans l’histoire. Ainsi, la stratégie temporelle se trouve aussi dans l’organisation des Repas du temps des sucres : les Québécois sortent de leur maison après l’hiver pour aller à la cabane à sucre en famille et entre amis, et La Maison amérindienne est prête à cet effet à les accueillir pendant tout un mois pour leur apprendre l’origine autochtone du patrimoine de l’acériculture autour du partage d’un repas du temps des sucres à saveur autochtone.
Être en contact avec de nouveaux récits, vivre différemment la signification de la maxime « Je me souviens » par le biais de la rencontre facilitée au musée semble capacitant pour les parties concernées, même si ces récits ébranlent ce qui était pris pour acquis. Comme le dit Ross-Tremblay dans Québékoisie (Carrier & Higgins, 2014) en évoquant le rôle-clé des histoires auprès des jeunes notamment, « le récit de la vie des autres enrichit notre propre expérience. Il y a rien qui remplace la transmission entre les personnes, c’est fondamental à la construction de l’identité des jeunes » (1:17:40). Dans l’expérience de Louis-Xavier, la réussite de la mission se réalise lorsque le contexte des événements permet « des rencontres enrichissantes avec des membres des Premières Nations. » En outre, la présence minimale d’appareils multimédia au musée incite à une rencontre en personne pour obtenir réponse à ses questions et en apprendre davantage en tant que visiteur. De façon similaire, au Alaska Native Heritage Center, l’attention est non pas sur une collection d’objets mais plus sur l’interaction et la performance, favorisant la rencontre en face à face : “Everything is designed to facilitate conversations between different tribal Alaskans and between Natives and non-Natives. At the door, visitors are personally greeted” (Clifford, 2004, p. 15). Le modèle de Clifford du musée en tant que « zone de contact » (cité dans Dubuc & Turgeon, 2004, p. 25) prend tout son sens ici, souvent synonyme d’inclusivité et de projets collaboratifs entre Autochtones et non-autochtones.
En conclusion, la possibilité de rencontre interculturelle au musée multi-nations propose une approche majoritairement avantageuse pour les diverses audiences et organisateurs impliqués, confrontant directement la dynamique de résistance et d’ouverture dans les relations sociales par le biais de l’apprentissage et la connaissance. J’en viens souvent au constat qu’il faut d’abord connaître pour pouvoir reconnaître. Si la prémisse de connaissance manque parmi la société québécoise et même son élite ayant le pouvoir décisionnel, il est peu étonnant que la reconnaissance du patrimoine et de la présence autochtone dans l’espace public québécois soit encore balbutiante. Les propos de l’équipe touchant la dialectique résistance/ouverture dénotent une situation contemporaine générale de méconnaissance mais pourtant d’intérêt envers les Premiers Peuples ayant habité et habitant la province. Par la rencontre incitée par le musée qui déploie sa mission sous tous ses volets avec son approche multi-nations, c’est la connaissance qui semble émerger de cette rencontre, mais surtout si la contextualisation est explicite dans certains cas. D’où la place pour la reconnaissance. Je vais à présent développer comment cette connaissance se produit significativement par la corporalité et l’expérience sensorielle.
5. Aspect multisensoriel : l’expérience corporelle au musée
Particulièrement pertinent ici, l’accent théorique sur le sensorium permet de s’éloigner des catégories souvent réductionnistes appliquées aux sociétés dites « orales », comme si elles ne mettaient l’accent que sur le son pour appréhender le monde. Howes (2003) souligne la compatibilité de cette approche théorique avec les méthodologies et épistémologies autochtones, faisant référence à la thèse critique de Paul Stoller qui stipule que « indigenous sensory modalities and models of understanding can provide a critique of abstract, Western systematizing epistemologies through confronting us with how knowledge and memory are embodied – experienced through the senses and the emotions » (p. 42). La théorie sociale, dont notamment l’anthropologie des sens, s’est attardée surtout depuis les années 1980 et 1990 au sensorium dans son ensemble, en réaction à une littérature désincarnée se voulant rationnelle, neutre, ainsi qu’à « l’hégémonie visuelle », le sens de la vue étant prépondérant au sein des cultures occidentales qui imposent ce régime sensoriel en de nombreux endroits (p. xii).
Je veux explorer ici comment la rencontre et la compréhension culturelle d’autrui, vécue par le corps et les sens dans un lieu patrimonial tridimensionnel, fait remettre en question les idées préconçues du public québécois ou les rattache à un patrimoine historiquement lié au leur. Cette compréhension est un savoir incorporé (embodied knowledge) au sens de Kovach et al. (2014), pour qui l’incarnation fait que le corps expérimente à la fois la vie dans le monde et devient un contexte pour connaître le monde (p. 69). De ce fait, ce que l’on sait, et la façon dont on le sait, est redevable en majeure partie à l’expérience corporelle. Burkitt (2014) propose aussi que le corps est central à la façon dont on appréhende la signification (meaning). Autrement dit, les choses « font du sens » à travers le ressenti. Les points de vue holistiques autochtones appréhendent la sensation et la perception comme centrales à la réalité, même si elles sont vécues à travers l’onirisme ou l’imaginaire : « toute sensation, qu’elle provienne de l’espace physique ou des rêves, est perçue comme directe, réelle et concrète » (Blanchard & Howes, 2014, p. 259). En outre, dans un contexte autochtone, le savoir incorporé prend la dimension supplémentaire d’être un savoir de résistance au colonialisme (Kovach et al., 2014, p. 70).
À la lumière, au son, à l’odeur, à l’aliment et à la matière de mon approche méthodologique incluant la sensation participante[6], il apparaît que La Maison amérindienne met significativement de l’avant son volet gastronomique et tente d’apporter aux visiteurs une expérience sensorielle complète, harmonieuse. Cela allait de soi pour l’équipe que ce qui relève de la sensorialité (surtout le goût dans ce cas) ouvre la porte à une culture donnée. Le constat qui se dégage de l’exploration de cet aspect multisensoriel est qu’un ensemble patrimonial peut être mis en valeur de façon exponentielle et non pas seulement à travers quelques éléments visuels ou auditifs isolés reflétant les cultures des Premières Nations, comme c’est le cas dans plusieurs musées. Je détaille l’approche de La Maison en exposant d’abord le contexte entourant la considération sensorielle dans le milieu muséal.
5.1 L’importance du sensorium en muséologie
La muséologie traditionnelle occidentale semble avoir fluctué au fil des changements dans la perception sociale des sens, où la vue et l’ouïe étaient considérés comme les moins subjectifs des sens et donc, les plus valorisés dans un contexte néoclassique marqué par les paradigmes de la rationalité et l’évolutionnisme (Howes, 2003, p. 6-7). Les premiers musées publics aux XVIIe et XVIIIe siècles permettaient pourtant à leurs visiteurs de toucher, peser et sentir les objets des collections (Blanchard & Howes, 2014, p. 255) ; les restrictions subséquentes au domaine exclusif de la vue suivent la mentalité de l’élite d’alors qui associait l’esprit à la « civilisation » et le corps, au « barbarisme » (Howes, 2003, p. 5-8). Dans les années 1980, la considération pour la « lecture sensorielle » des visiteurs et le désir de susciter une réaction émotive et sensorielle chez ces derniers s’inscrit dans la foulée d’un souci de démocratisation et d’accessibilité au sein des musées (Miguet, 1998, p. 177). Les années 1990 apportent un accent sur le toucher, non plus pensé uniquement en fonction des personnes avec un handicap. Néamoins, la sensorialité dans les musées fait en sorte que, selon Miguet, « les autres sens [que la vue] sont comme gommés, voire prohibés » (p. 177) et le goût est le sens le plus absent dans le milieu des expositions.
La critique s’applique encore aujourd’hui, les expositions traditionnelles de la muséologie occidentale et euro-américaine mettant surtout de l’avant la vue et l’ouïe et présentant des objets selon leur qualité esthétique ou leur capacité d’impression visuelle. Cela se fait au détriment de la qualité sensorielle, du sens social et du contexte environnemental d’autres objets pertinents, moins frappants visuellement et dont l’apparence ne représente qu’une facette (Classen & Howes, 2006, 200-201). La Maison amérindienne ne suit pas ce modèle, car elle offre en abondance au goût et à l’odorat par ses dégustations, événements et évocations gustatives ; elle permet de toucher plusieurs fac-similés et objets réels, tels les peaux d’animaux ; et elle donne évidemment à voir et à entendre comme tout autre musée. Les musées gagnent à penser leurs productions culturelles selon l’approche multisensorielle, considérant que la communication d’un message à travers tous les sens augmente son potentiel de réception (Howes, 2003, p. 52). En outre, l’importance de considérer l’expérience sensorielle des visiteurs de musées fait également ses preuves avec son rôle dans l’apprentissage, et sa prépondérance dans le foyer d’attention des visiteurs selon Screven (1992).
Couplée au potentiel des technologies numériques, la vague interactive propre à la muséographie contemporaine abonde toutefois en ce sens, ce qui peut résulter en des projets muséaux collaboratifs intéressants tels que l’expo-science Génie autochtone : des inventions toujours actuelles présenté au Centre des Sciences de Montréal (du 18 octobre 2018 au 17 mars 2019). Cette exposition détaillait le principe de l’équilibre en faisant embarquer dans un kayak ; pêcher au harpon dans une étendue d’eau virtuelle ; ou construire un igloo avec de gros cubes coussinés (Centre des sciences de Montréal, 2018). Néanmoins, la mise en espace des expositions depuis la seconde moitié du XXe siècle est certes immersive, mais statique et esthétique ; les musées « imposent un régime sensoriel propre au musée », celui de la vue (Blanchard & Howes, 2014, p. 253) et même, les musées modernes deviennent des « empires de la vue » selon Susan Stewart (citée dans Classen et Howes, 2006, p. 200).
Ainsi, Constance Classen et David Howes (2006) proposent d’appréhender les musées en tant que paysages sensoriels (museum as sensescape) à travers leur portrait de l’histoire sociale des sens au musée occidental traditionnel. Ils reconnaissent notamment que chaque objet “embodies a particular sensory mix” à travers sa production porteuse de savoirs-faire sensoriels, sa circulation qui en fait un objet de désir ou d’aversion selon l’expérience sensorielle qu’elle suscite, et sa consommation, laquelle dépend de la perception sociale des sens selon une culture donnée (p. 200).
5.2 La sensorialité est culturelle
La dimension multisensorielle est primordiale du point de vue de son importance culturelle. Au fil de cette analyse, on entend que la perception sensorielle varie d’une culture à l’autre. Le contexte d’une société nord-américaine orientée sur le modèle consommateur met de l’avant la perception en tant que réception, en contraste avec les sociétés orientées sur le modèle de l’échange, où la perception est plutôt communication (Howes, 2003). De ce fait, l’expérience de visite dans un musée tribal peut être davantage vécue comme réception (de messages, d’artefacts, de savoirs…) par le visiteur non-autochtone, ainsi qu’être confrontée à la vision du monde autochtone axée sur la réciprocité véhiculée par le musée, de sorte que le visiteur sera encouragé à communiquer avec les objets, les messages, les différents savoirs des Premières Nations qui sont partagés, non à accumuler une quantité de savoir unique et finie. La visite de l’érablière et de l’exposition permanente était particulièrement significative en ce sens, me sentant en interaction avec les arbres, la montagne, les lieux environnants, le savoir-faire de l’acériculture transmis à travers les générations et les peuples, en relation au sens que je porte à ma propre identité.
Le « paysage sensoriel » de La Maison amérindienne met particulièrement l’accent sur le sens du goût par la gastronomie autochtone, laquelle incite à découvrir les traits culturels des différentes Premières Nations selon l’équipe :
Et puis je trouve que ç’a été bien conçu dès le départ […] avec la cuisine, parce que André sait depuis toujours (rires) que la gastronomie ça fait partie de la culture (Michel N.).
C’est complètement différent [chaque nation] et c’est un peu ça qu’on veut montrer avec le souper de crabes. Le crabe bien c’est la haute mer, c’est nos ancêtres, que ce soit le homard, le crabe, la morue, le flétan, c’est des pêches que les Malécites font depuis… toujours. […] Chaque nation a une façon de manger, de boire, de consommer (Richard).
Quand on fait le cassoulet à l’automne, c’est pour mettre en valeur le haricot. […] ça permet de montrer que les Français ont piqué l’idée de mélanger du canard avec des haricots, une saucisse, aux Premières Nations, […] ont récupéré la recette de base, ce plat-là […] permet à La Maison amérindienne de parler du haricot, de parler des Trois Sœurs, de parler des Iroquois […] ça permet d’expliquer qu’ils étaient des cultivateurs, des cueilleurs, et qu’ils étaient sédentaires, c’est tout ça (André).
[…] au mois d’avril c’est les Malécites qui viennent faire découvrir le crabe, mais [ce serait bien qu’] au mois de mai, ça soit une autre nation […] qui vienne faire découvrir ses coutumes ou ses gastronomies. […] Ça se fait à Québec [référence à l’événement À la rencontre des grands chefs] y a une semaine ou deux où plusieurs nations étaient jumelées à des restaurants différents […] pour faire découvrir les gastronomies autochtones (Richard).
Puisque La Maison amérindienne a une approche muséale non conventionnelle en ce qu’elle engage une sensorialité alternative, augmentée par rapport à la majorité des musées traditionnels qui dédient une section café ou cafétéria servant plutôt à des fins pratiques de sustentation, l’approche théorique de Howes (2003 ; Classen & Howes 2006 ; Blanchard & Howes, 2014) mettant l’accent sur le sensorium enrichit l’analyse si l’on considère aussi que l’expérience sensorielle est le domaine le plus fondamental de l’expression culturelle, le médium par lequel cette dernière prend forme (2003, p. xi). Par sensorium, on entend les sens considérés dans leur ensemble, leur interrelation et une certaine hiérarchie culturelle, non pas considérés séparément. Tout en étant une expérience vécue et multisensorielle (p. 40), la culture est à son tour un élément constitutif du ressenti sensoriel. Ce lien entre sens et socialité concerne aussi les relations sociales et la construction de soi (p. 160). En outre, dans le contexte muséal exploré dans ce travail, la suggestion de Classen et Howes de faire une lecture sensorielle de chaque artéfact plutôt qu’une lecture limitée aux « signes » et à la « textualité » chère aux études culturelles est tout à fait pertinente, car “things have sensory as well as social biographies“ (p. 200).
D’abord, les commentaires de Richard abordent la diversité culturelle des réalités et expériences sensorielles chez les Premières Nations, dont le musée a le potentiel de traiter avec son approche multi-nations. Howes (2003) note que la diversité géographique au sein d’un pays permet une diversité d’environnements sensoriels, prenant pour exemple la diversité au sein de la Papouasie Nouvelle-Guinée (p. xvi-xvii) ; il en est évidemment de même pour des territoires aussi vastes que le Québec et le Nunavik. Entrent aussi en jeu les divers espaces sensoriels au sein de cette diversité géographique : l’espace acoustique, l’espace thermal, et l’espace olfactif qui dépend des normes culturelles (p. 14-15). Ainsi, l’expérience et la réaction sensorielle des Eeyouch et Naskapis au nord de la Vallée du Saint-Laurent variera nécessairement de celle des peuples plus au sud, par exemple les Abénakis, les Kanien’kehà :ka et les Québécois.
Si, selon Stuart Hall, appartenir à une culture signifie appartenir à un même univers conceptuel et linguistique dont les conventions changent au fil du temps (1997, p. 86-88), on peut ajouter qu’il s’agit d’appartenir à un même univers sensoriel, celui-ci étant en effet une condition à toute interaction subséquente. La Maison amérindienne devient un lieu « carrefour » (Richard) où la rencontre permet d’être en contact avec l’univers conceptuel, linguistique et sensoriel des Premières Nations, Inuits et Métis. Ainsi, la mise en valeur du patrimoine de toutes les nations autochtones au Québec et de nations d’autres provenances à travers le musée multi-nations rend accessible d’une certaine manière cette richesse sensorielle et les relations sociales qui sont en interaction avec cette sensorialité. J’écris « d’une certaine manière », car comme le demandent avec justesse Classen et Howes (2006), “To what extent can one ever apprehend the sensory world of the other?” (p. 201). Malgré tout, la position des théoriciens « sensualistes » prônait une façon idéale d’avoir accès aux réalités sensorielles d’autres cultures, à savoir apprendre à raffiner et réorienter ses sens selon d’autres schémas comportementaux (Howes, 2003, p. 26). Ainsi, l’expérience corporelle de visite au musée donne accès à des portraits, plusieurs morceaux de casse-tête par exemple à travers l’exposition J’épie… le maïs qui détaille le rôle social, politique, spirituel et genré du maïs pour les Premières Nations le cultivant. En traitant de la souveraineté alimentaire, la nutritionniste Treena Delorimier (Kanien’kehà :ka) (2019) soulignait en effet que le “cornwashing is a cultural teaching” chez les Kanien’kehà :ka, pas seulement une étape de préparation du maïs faisant partie d’un travail traditionnellement féminin.
Selon André qui en a fait mention à plusieurs reprises, il s’agit d’une mise en valeur contextualisant des repas à saveur autochtone, qui permet d’aborder l’origine et la diversité des provenances culturelles de la gastronomie offerte au musée. Ainsi, parler ou faire goûter de la courge et du maïs lors des Repas des sucres, ou le haricot lors du « cassoulet » à l’automne, permettent d’aborder la culture des Trois Sœurs des Premiers Peuples cultivateurs ; le crabe permet d’aborder la culture Wolastoqey, et ainsi de suite. Le dépliant promotionnel a pour sous-titres « Venez goûter la différence » et « Un musée qui se déguste », invitant à connaître les cultures des Premières Nations par le biais du goût notamment. La nourriture ayant une forte connotation liée au partage et au plaisir, cette mise en valeur implique une double efficacité considérant la mission d’échange, de partage et de rapprochement du musée.
Dans le cas de la diffusion du « cassoulet amérindien », il semble que rendre explicite et contextualiser l’origine autochtone des aliments soit un prérequis pour s’adresser à une perspective critique ou extérieure ne prenant pas part au cassoulet. On pourrait voir en effet l’usage de l’expression « cassoulet », plutôt que « ragoût autochtone » par exemple, davantage comme la mise en valeur d’un patrimoine français au détriment de celui des Mohawks, des Wendat ou des Abénakis cultivant le haricot, étant donné que la recette de cassoulet avait déjà cours avant le contact en Amérique, étant à base de fèves avant l’introduction du haricot sud-américain en Europe (Grande confrérie du cassoulet, s.d.). Il n’en demeure pas moins que la gastronomie autochtone mise en valeur sur le site du musée par la dégustation et l’évocation suscite beaucoup d’attrait et de découvertes chez les visiteurs, commentaires positifs (« c’est super bon ! », « merci, c’est très bon ! ») et questions à l’appui. En effet, lors du bénévolat à l’un des Repas amérindiens, la curiosité d’une convive envers les ingrédients du potage a d’elle-même apporté l’occasion pour moi de lui parler des Trois Sœurs (courge, maïs et haricot) que cultivaient notamment la nation voisine Mohawk, et d’actualiser le fait que les Trois Soeurs se cultivent toujours entre autres sur le territoire où le repas prenait place. Le succès est tel que, selon André qui explicite l’intention derrière la gastronomie à saveur autochtone,
Y’a des végés qui viennent et ils ne veulent pas de viande mais quand ils voient l’assiette à côté, « on peut pas en avoir un morceau ? »[7] […] il y a eu des choses intéressantes comme le succès de la tarte au sucre sans croûte, c’est bien parce qu’en fait ça fait parler de la gastronomie autochtone, ça fait parler en bien des Autochtones. Les gens qui en achètent ce n’est pas la tarte d’IGA, ce n’est pas la tarte du Métro. C’est la tarte de La Maison amérindienne.
Un visiteur m’a même demandé lors d’un Repas si l’on vendait la recette de la tarte. Une certaine notion d’authenticité culturelle émerge de ces propos, comme si on venait à La Maison pour une expérience unique, rien de fait en série ; la boîte de la tarte d’inspiration attikamekw affiche d’ailleurs la mention « un goût authentique ». Si elle est systématiquement contextualisée, cette terminologie pourrait répondre aux potentiels questionnements d’un public plus critique dans le contexte sociohistorique contemporain d’autoreprésentation et de réappropriation des représentations détaillé par Linda Tuhiway Smith (2012) : comment l’appellation de la tarte faite « selon une recette attikamekw » s’articule-t-elle avec le mot « authentique » qui y est également inscrit ? Cela revient-il à dire aussi que cette tarte est un élément de la culture qui résonne avec la nation encore aujourd’hui, ou qu’elle était plutôt une recette anciennement pratiquée ?
La mise en exergue et en contexte de l’origine culinaire autochtone est quant à elle frappante dès le début des expositions saisonnière J’épie… le maïs et permanente De l’eau… à la bouche, et s’appréhende corporellement par la notion d’emplacement détaillée plus haut. Le panneau d’introduction de J’épie… le maïs cite la légende Eeyou de l’origine du maïs ainsi que les propos des premiers explorateurs français sur la culture du maïs aux Amériques. Le message est perceptible dès les premiers moments de proprioception, de présence corporelle à l’entrée de l’espace d’exposition, accompagné de petites poupées représentant des femmes autochtones ; il n’y a pas de progression lente vers ce message au cours de la visite de l’exposition. Le parcours d’exposition étant ouvert, si le visiteur décide de ne pas lire le panneau d’introduction, il lui sera toutefois rappelé l’origine autochtone du maïs à plusieurs reprises. D’autre part, dans l’exposition permanente, on passe nécessairement devant les panneaux encadrant l’entrée de l’exposition avec les légendes d’origine du sirop d’érable, qui ouvre sur un espace circulaire affichant les points cardinaux au sol, dont le centre invite à s’asseoir sur des fauteuils ornés de peaux d’animaux. Ces panneaux établissent clairement l’origine autochtone du sirop d’érable : d’abord par les légendes algonquine, mohawk, micmaque, et celle abénakise de Nokomis et son petit-fils Manabush, partagée aussi par plusieurs Premières Nations, légitimant du coup l’histoire orale. Voici une version de la légende de Nokomis :
[…] Nokomis (la terre) aurait été la première à percer des trous dans le tronc des érables et à recueillir directement le sirop d’érable. Manabush, constatant que cette sève était un sirop prêt à manger, alla trouver Nokomis et lui dit : « Grand-mère, il n’est pas bon que les arbres produisent du sucre aussi facilement. Si les hommes peuvent ainsi sans effort recueillir du sucre, ils ne tarderont pas à devenir paresseux. Il faut tâcher de les faire travailler. Avant qu’ils puissent déguster ce sirop exquis, il serait bon que les hommes soient obligés de fendre du bois et de passer des nuits à surveiller la cuisson du sirop. » Il n’en dit pas plus long, mais craignant que Nokomis reste indifférente à ses paroles et qu’elle néglige de prendre des mesures pour empêcher les hommes de devenir paresseux, Manabush grimpa au haut d’un érable avec un vaisseau rempli d’eau et en versa le contenu à l’intérieur de l’arbre, dissolvant ainsi le sucre qui se trouvait dans l’érable. Depuis ce temps, veut la légende, au lieu d’un sirop épais, la sève contient 1 % à 2 % de sucre, et, pour obtenir du sucre, il faut dorénavant travailler (Alliance autochtone Québec, 2007).
Ensuite, il y a recours à l’expression populaire, répandue chez les peuples autochtones, de l’érable en tant qu’« arbre confiseur » ; et la mention de l’adoption du savoir-faire de l’acériculture par les Canadiens au début du XVIIIe siècle. Il y a nuance du mythe originel de Nokomis (la terre) et Manabush par l’interprétation de ce que les Autochtones ont observé des chiens et écureuils lécher les branches cassées des érables au printemps. Cette formulation résonne avec le défi auquel faisaient et font face les musées tribaux à s’éloigner d’un modèle muséal ethnographique reposant sur l’évidence scientifique qui doit soutenir (backup) les histoires de conteurs traditionnels, la façon dont est formulée cette évidence remettant en question la légitimité et le rôle social des récits de création selon Boxer (2016, p. 85). Malgré tout, une signature visuelle constante dans l’exposition reproduit la position de l’origine culturelle du sirop d’érable résolument autochtone, en ce que le corps de texte de chaque panneau parle du savoir-faire des Premières Nations, puis montre un encadré de plus petite taille apportant une précision sur l’adoption canadienne-française de ce savoir-faire. Par exemple, un encadré orange annonce qu’on troque le mokuk, récipient en écorce de cèdre pour collecter l’eau d’érable, pour le sceau en fer-blanc à partir de 1923.
La reconnaissance identitaire de l’origine autochtone des aliments que valorise le musée se fait par le biais d’une certaine constatation positive : le panneau de fin de l’exposition permanente explique que « […] le printemps venu, un petit goût sucré ravive la nostalgie des temps anciens, poussant les Québécois vers les cabanes à sucre à la recherche de l’ambiance et des traditions d’autrefois, celles que leurs ancêtres ont apprises des Amérindiens mêmes ». Si, pour Howes (2003), “sensory experiences bring people together and make life memorable within unique cultural contexts” (p. 44), l’espace de rencontre physique que représente le musée suggère une expérience sensorielle de rencontre internculturelle, dans le passé et le présent.
5.3 Une expérience sensorielle complète
Le « paysage sensoriel » du musée propose également une expérience multisensorielle à ses visiteurs qui se veut harmonieuse :
[Les visiteurs] se sentent bien, c’est bon, ça sent bon, on essaie de travailler sur tous les éléments, que ce soit agréable à l’odeur, agréable au voir, agréable à entendre, et puis après ça, agréable dans l’échange (Chantal).
Faire appel à tous les sens du public permet à celui-ci d’expérimenter corporellement et de façon plus complexe le patrimoine, plutôt que de l’appréhender par des dispositifs favorisant une expérience sensorielle (visuelle) précise. Cette approche se distingue d’autres médias ou supports, voire d’expositions complètes dans le milieu muséal qui sollicitent exclusivement la vision et en moindre mesure l’audition. On cherche à procurer une expérience globale positive passant par la sensorialité à La Maison amérindienne, détaillée explicitement dans la section « Le site, un lieu magique » du dépliant promotionnel :
Au son du tambour et des chants traditionnels, vous y apprécierez le savoir-faire des Amérindiens, participerez, en saison, à la cueillette et à la transformation de l’eau d’érable selon les traditions millénaires, goûterez une cuisine amérindienne renouvelée, humerez les parfums du sous-bois d’une forêt ancestrale…
Les mondes sensoriels des Premières Nations et des Inuits sont qualifiés d’holistiques (Blanchard & Howes, 2014). Par exemple, les Dene de l’Arctique canadien valorisent l’attention portée à tous les sens ou au plus de sens possible pour avoir une conscience et une connaissance accrues (Howes, 2003, p. 48). L’expérience à La Maison, qui met l’accent sur l’aspect multisensoriel, abonde en ce sens. Chantal mentionnait que l’équipe veut « donner une expérience complète » aux visiteurs du musée. De façon similaire, au sein de l’initiative autochtone de rassemblement citoyen du Cercle Kisis, l’acte concret et tangible de l’expérience de rencontre, vécu par le corps, est ce qui importe le plus selon le cofondateur Alexandre Bacon, derrière la compréhension limitée d’assister à des spectacles culturels que peuvent avoir certaines personnes.
Derrière tout ça, ce qui importe pour moi, c’est de faire une cérémonie d’ouverture, de fermeture, de transmettre des récits ancestraux, par exemple. Le fait de manger un seul caribou tous ensemble, le fait que nous le remercions de s’être sacrifié pour nous […] avant tout c’est une expérience (Vaudry, 2016, p. 103).
Ainsi, l’expérience de la cérémonie et du rassemblement par une expérience gustative, par exemple, devient la priorité pour laisser place à une rencontre citoyenne réussie, les sens étant requis pour toute expérience personnelle et sociale subséquente.
Si Howes (2003) définit l’expérience sensorielle en lien avec le vécu, “as physical sensation shaped by personal history” (p. xi) et argumente que les relations sensorielles sont significativement des relations sociales, ce que les visiteurs perçoivent en participant à la programmation du musée est en quelque sorte le type d’interaction et de compréhension de l’autre, avec l’autre, que le musée souhaite leur faire vivre en faisant appel à tous leurs sens. Tout comme l’exposition collaborative C’est notre histoire du Musée des Civilisations à Québec, qui propose des « stratégies sensorielles relevant de la connaissance par le corps » (Blanchard & Howes, 2014, p. 254) et fait écho au savoir incorporé (embodied knowledge) de Kovach et al. (2014), le musée encode une expérience corporelle multisensorielle visant le rapprochement entre peuples et une meilleure connaissance des Premières Nations, conformément à sa mission. Des exemples de ces stratégies sensorielles dans C’est notre histoire sont de faciliter un mode de pensée circulaire par un parcours d’exposition ouvert plutôt que dirigé ou linéaire, par des écrans et des murs de forme circulaire, et par la possibilité de toucher et sentir plusieurs fourrures d’animaux, procurant une compréhension « grandement amplifiée » (Blanchard & Howes, 2014, p. 262). Malgré tout, l’espace muséal régi par les politiques de sécurité et d’accès universel aux divers publics impose des compromis aux collaborateurs selon les auteurs, comme le déplorait Ames (2000) à propos de la primauté de l’institution et le rapport de pouvoir inégal entre musées et communautés en découlant. Cette exposition aurait donc pu développer davantage son « potentiel sensoriel » (Blanchard et Howes, 2014, p. 264) en laissant place par exemple aux idées originales de l’équipe de conception de faire enlever leurs souliers aux visiteurs pour se déplacer sur un sol mou ; ou leur faire recoudre des canevas déchirés pour mieux vivre l’expérience proposée par le thème de la guérison.
Pour comprendre les stratégies sensorielles de mise en valeur du patrimoine autochtone dans les musées, s’attarder aussi à l’expérience multisensorielle proposée aux visiteurs devient intéressant. Ce que propose La Maison revient à une mise en valeur et une connaissance des Premières Nations tel qu’analysé plus haut, mais aussi à une éducation sensorielle/sociale à travers un environnement multisensoriel agréable, « et puis après ça agréable dans l’échange » pour favoriser le rapprochement entre peuples. La notion de conscience corporelle abordée par Howes (2003) est pertinente ici, par son exemple des rites d’initiation Kuranko au Sierra Leone – écouter les aînés, modérer l’envie et l’évocation de nourriture, contrôler son regard par rapport à ce qui relève de l’autre sexe : “It is through the cultivation of bodily awareness – the education of the senses – that ethical awareness is evolved. The ethical concepts do not come before the ways of sensing, however, they are the ways of sensing” (p. 33). Ainsi, l’expérience sensorielle implique l’expérience éthique. Si elle est multisensorielle, est-elle encore plus éthique, tel que le suggère la compréhension augmentée du patrimoine par des stratégies faisant appel à plusieurs sens ?
Outre les stratégies qui font appel au goût et tournent autour du plaisir et du partage de nourriture, l’équipe de La Maison offre des occasions d’entrer en contact avec l’univers acoustique autochtone, par les chants de bienvenue au début des activités, la série de concerts musicaux « Découverte autochtone » (cinq par année) ou différents mots et expressions de langues autochtones. À la fin de ses animations lors des Repas à saveur autochtone, par exemple, Audrey remerciait son auditoire par la formule Eeyou et Anishinabe « Meegwetch », (en atikamekw « Micwetc »), plusieurs visiteurs répétant ensuite le mot. L’humour des Premières Nations se vit auditivement et somatiquement aussi lorsque les visiteurs sont invités à faire la « danse des crocodiles » pour digérer le Repas des sucres, avançant et reculant au son du tambour et du chant d’Audrey, devant répéter les mots qu’elle chante : « Ga-wa-na-é ! Hé-ah-hé ! ». Il s’agit en même temps, pour elle, d’une occasion de partager aux visiteurs Makusham, le pas de danse innu et séminole (Nation de Floride où se trouve en abondance le crocodile) pour leur montrer le « mélange des cultures amérindiennes ». Chaque fois qu’il y a des chants, des contes, des mots ou toponymes autochtones, et des animations, cela permet à l’espace muséal de devenir sonore et d’assurer la continuité d’un mode de transmission orale de savoirs, conformément à une vision du monde autochtone. Dans un musée de type plus traditionnel, aucun chant directement partagé en personne n’accompagne le visiteur à son entrée dans l’exposition, au début d’une animation ou d’un événement ; un enregistrement ou une trame sonore sur un support multimédia seront présents, au plus. Le musée offre cet aspect surtout lors d’animations, en plus d’un fond sonore de chants d’oiseaux dans la salle d’accueil.
En effet, Chantal a fait référence à l’oralité comme façon de mettre en valeur le patrimoine au musée lors de nos premiers échanges. Cela se ressent conjointement au volet gastronomique mis de l’avant. L’analogie dite de la nécessité de Linda Hogan (Chickasaw) (citée dans Battiste & Henderson, 2000, p. 9) établit que les histoires sont aux peuples autochtones ce que l’eau est aux plantes. Les récits originels du sirop d’érable en début d’exposition permanente transmettent les variantes d’histoire orale Kanien’kehá:ka, Anishinabe, Mi’gmaq, et abénakise montrant à la fois leur diversité et leurs ressemblances. Le récit Wolastoqey partagé par la gardienne du savoir en devenir et conteuse invitée, Édith Bélanger, lors de la période d’allocutions du Festin de crabes, s’inscrit précisément dans cette idée de partage des histoires propres à sa nation, un savoir transmis de génération en génération. Le guide méthodologique d’histoire orale auprès de communautés American Indian de Trimble, Sommer et Quinlan, Making Many Voices Heard (2008), établit clairement que l’histoire orale, soit un savoir traditionnel, dit et fait des choses qui vont bien au-delà de l’aspect chronologique propre à la discipline de l’histoire : le mythe contribue à la continuité culturelle et transmet des valeurs, l’histoire orale permet la rétention linguistique, multiplie les significations en étant contée et recontée au fil du temps et à travers divers contextes, sert d’évidence aux revendications territoriales en cour et de source bibliographique, pour ne nommer que quelques usages utiles aux individus et communautés (p. 102-108). À La Maison et conformément aux pratiques culturelles traditionnelles, ce sont les individus désignés et reconnus pour partager certains récits qui en ont la charge, comme l’élaborait Chantal en discutant des partenariats avec les communautés et de l’aide financière « pour être capables d’inviter un conteur de la Première Nation ».
En ce qui a trait au toucher et au ressenti épidermique, j’ai constaté une flexibilité quant à laisser les visiteurs toucher certains objets « au cas par cas » (Audrey), lors d’une animation faisant suite au Repas des sucres : si le visiteur ou la visiteuse fait attention, c’est bien. Sinon, c’est non. Dans le contexte de conservation des collections de musée, adopter un comportement respectueux envers les objets du patrimoine autochtone, encouragé et encodé par le musée, permet donc à certains visiteurs d’avoir un accès tactile à des témoins de la culture des Premières Nations. Lors du Jeudi culturel, mon fils encore bébé et n’ayant pas complètement intégré la notion de « faire attention » se voyait tout de même offrir l’alternative de toucher dans les expositions à la poterie solide et aux fourrures d’animaux, mais évidemment pas aux délicates barquettes d’écorce. Le toucher est entre autres encouragé avec les fourrures dans le salon Riopelle ou l’exposition permanente, la visite de l’érablière et les divers ateliers familiaux (création de capteurs de rêves, chasse aux cocos plumés, atelier de dessin avec Joyce Panadis…). Par ailleurs, des objets tels le tambour trônant au centre de la salle de l’exposition Joyce Panadis : l’essence d’un peuple, affichent explicitement la requête « Ne pas toucher / Merci » ou sont exposés dans des vitrines.
L’odorat est sollicité à plusieurs reprises, d’abord par l’emplacement du site dans l’érablière tel qu’abordé dans le dépliant promotionnel. Lors des Jeudis culturels, on peut boire et humer une tisane de frêne, de sauge ou de bouleau, autrement peu en circulation dans les supermarchés et épiceries sur le territoire. Pendant cette même activité, l’expérience olfactive couplée à celle de proprioception et de la notion de pureté se trouvait dans le rituel de purification se déroulant à l’extérieur du musée. On y brûle généralement la sauge blanche, plante médicinale très symbolique dans l’univers autochtone (ou le cèdre ou le foin d’odeur), dans un coquillage d’ormeau et la fumée est dispersée avec une plume d’oiseau, elle aussi symbolique, d’abord vers l’est, le sud, puis les deux autres directions, et les visiteurs peuvent porter la fumée vers eux avec les mains pour se nettoyer. L’odeur des aliments préparés et dégustés dans le cadre du volet gastronomique du musée, ainsi que celle des peaux d’animaux dans les expositions permettent un savoir corporel par le biais de l’olfaction. En outre, la boutique offre un condensé olfactif du cuir, des matériaux qui composent les œuvres et objets en vente – de ce fait, la boutique n’est pas qu’un véhicule de vente et d’achat d’œuvres d’artistes et artisans, mais aussi une composante de l’expérience sensorielle et de mise en valeur au musée. Vincent Paquin (Québécois, responsable de l’accueil et animateur) la qualifiait de « galerie » et d’exposition en soi, qui « boucle la boucle » en fin de visite et permet de s’imprégner des cultures autochtones très concrètement dans le présent, suite à une visite de type davantage historique.
En tant qu’institution muséale mettant de l’avant des expositions et de l’art visuel orientés vers des représentations autochtones, La Maison sollicite évidemment la perception visuelle. L’exposition de Joyce Panadis, par exemple, permettait de constater autant le message de l’artiste sur l’identité abénakise que son incroyable capacité à dessiner de façon réaliste au graphite, de sorte qu’avec peu de distance, les œuvres paraissaient photographiques. Ensuite, l’architecture toute en rondeur de La Maison avec un toit conique évoque la pensée circulaire et l’habitation du wigwam ou du shaputuan, tout en influençant le déplacement physique dans cet espace incurvé. La lumière naturelle se déverse par les fenêtres de la salle d’accueil et de l’exposition permanente, se mariant aux éclairages artificiels de l’espace permanent jusqu’au salon Riopelle attenant. On peut non seulement avoir un temps d’arrêt, d’accès et de repos visuel sur l’érablière environnante et la montagne, cette disposition spatiale se distingue de la pratique généralisée en muséologie qui consiste à éviter presque maladivement la lumière naturelle, reposant sur les principes non moins légitimes de conservation des objets pour éviter toute détérioration précoce, même si plusieurs objets, matériaux ou éléments du mobilier d’exposition la supportent très bien tels le métal et la pierre (Péquignot, 2015). Effectivement, en contraste avec les méthodes de conservation occidentales, le soin de certains objets du patrimoine autochtone, sacrés ou non, signifie aussi de leur donner lumière ou nourriture, étant considérés comme vivants et non inertes comme le suppose la muséologie traditionnelle (Clavir, 2002 ; CCI, 2015). Cette perspective animiste et relationnelle des objets suggère donc une dynamique de conservation et d’exposition muséale alternative ; son application m’est inconnue en ce qui a trait à La Maison.
Puis, l’échelle humaine fait considérer l’espace comme unité de mesure privilégiée. Il y a la tendance naturelle vers la sécurité de se diriger vers les endroits les plus aérés et les mieux éclairés en pénétrant un lieu inconnu (entry response). Or, un espace plus petit et faiblement éclairé porte à la curiosité et l’observation des détails d’objets (petits, de préférence) (Dean, 1994). La grande salle d’accueil lumineuse ainsi que l’espace d’exposition temporaire plus tamisé et plus contigu suivent ces tendances. L’expérience « agréable au voir » à laquelle réfère Chantal peut se vivre avec cette vue imprenable sur la montagne et l’érablière via les murs vitrés incurvés qui ouvrent à la nature mise en valeur sur l’ensemble du site du musée ; dans l’installation du café Mishtan sur la terrasse en saison estivale ; et au soin porté à l’architecture, l’érablière et les décorations – qui ne se limitent d’ailleurs pas qu’à des décorations – qui sont souvent naturelles ou évoquent la nature (branchages, plantes, sculptures d’animaux, jardins, etc).
Tout comme de nombreux musées, La Maison fait stratégiquement appel à la proprioception des visiteurs, leur sens de l’emplacement dans l’espace immédiat, avec des formules semblables à « il y a X ans, sous vos pieds, se tenait… » pour mettre en valeur le patrimoine. Cela se déploie en adéquation à l’importance culturelle du territoire détaillée dans la section portant sur l’aspect géographique. Ont été mentionnés l’ancienne érablière et lieu de campement/manoir Rouville, le sentier abénaki/rue de la Montée des Trente, et même le Wigwomadensis/mont Saint-Hilaire, qui permettent non seulement aux visiteurs de se situer à diverses époques mais aussi d’apprendre à travers la localisation de leur corps, dans le moment présent et dans un espace défini comme autochtone (territoire abénaki et musée multi-nations). Cette expérience corporelle d’apprentissage et de compréhension culturelle demande une présence physique dans l’espace en contraste avec une expérience virtuelle se limitant à l’évocation d’espaces et qui a sa propre dynamique d’apprentissage. Cet « apprentissage par emplacement » est aussi apparemment présent dans Nomades ou itinérants : peuples en danger, car l’exposition se tient dans un écomusée, dans un quartier historiquement et contemporainement ouvrier à Tiohtià :ke/Montréal concernée par l’itinérance grandissante, et requiert au visiteur non-autochtone d’incarner physiquement l’expression « aller au-delà des apparences » par son déplacement dans l’espace. En effet, on passe d’abord devant les portraits des « nomades » urbains que l’itinérance rend autrement anonymes, puis on entre ensuite dans une petite galerie mettant en valeur la richesse culturelle des savoir-faire et du mode de vie traditionnel innu avec paniers tressés, mocassins ornés de perles, teueikan (tambour), grand canot de frêne ouvragé, raquettes de babiche, porte-bébé et peintures illustrant des scènes de la vie quotidienne dans le Nitassinan, le territoire innu.
Une autre stratégie sensorielle de mise en valeur passe logiquement par l’évocation multisensorielle. Dans J’épie… le maïs, le goût est sollicité entre autres par le panneau décrivant l’héritage autochtone du maïs qui qualifie généreusement la graminée « riche et blonde » et, dans la salle d’accueil, les nombreuses affiches représentent des variétés colorées et réalistes de maïs, de chili (piment), de courges, de baies, et un ancien guide alimentaire innu. En d’autres mots, on s’imagine manger un bon maïs ou se « bourrer la fraise » de mûres, en sachant d’où viennent ces aliments. Les sens gustatif, auditif et visuel sont évoqués dans l’exposition permanente aussi avec par exemple la vidéo montrant adultes et enfants Attikamekw se délectant ensemble du sirop et du sucre d’érable enfin prêts à la consommation, et avec les propos de l’exposition (« [ils] apprécièrent à leur tour la suavité de la chose ! »).
L’évocation tactile de la dextérité et de l’endurance physique passe notamment par la mise en valeur des savoir-faire autochtones dans les discours du musée. L’ingéniosité du procédé de préparation du sirop d’érable, très long, montre la patience de ses fabriquants qui faisaient rougir des pierres dans le feu pour faire chauffer l’eau d’érable à répétition, et montre la pratique ancestrale de « courir les érables » en raquettes à l’aube et à l’aurore pendant la saison pour récolter l’eau rapidement, une longue tige de bois reliée à deux seaux sur les épaules. Cela montre l’endurance à son meilleur. Les panneaux de texte font mention de l’ingéniosité d’utiliser tout ce qui pouvait l’être avec l’eau et le sirop d’érable, tout comme avec le maïs dans J’épie… le maïs : sécher les surplus d’épis, faire de la sagamité, du pain, des galettes, du gruau, s’en servir en médecine, sans compter le fait de garder les cinq derniers épis d’une récolte pour les vénérer en tant que porte-bonheur d’abondance. Le panneau « L’affaire des femmes » montre aussi le travail ardu et exigeant de l’agriculture opéré par les femmes pendant six mois de l’année. Encore, lors de plusieurs animations, il est fait mention du jeu de ficelles reproduit inspirant les sérigraphies de Riopelle : pratiqué par presque tous les peuples autochtones, ce jeu permet de développer sa dextérité, d’illustrer des histoires, et d’occuper ses mains l’hiver pour éviter qu’elles ne gèlent. L’expertise manuelle autochtone se voit et est évoquée à travers les objets artisanaux et artistiques exposés au musée et vendus en boutique.
Une réflexion tournant autour du potentiel sensoriel évoqué par Blanchard et Howes (2014) permet d’identifier les moments et lieux où ce potentiel immersif est optimal, partiel, etc. Il semble que les activités d’animation sur le site sont celles qui offrent l’expérience sensorielle la plus complète (chants, contes, description des œuvres, accès à des objets fac-similés), tandis que pour les visiteurs indépendants des expositions qui apprennent par eux-mêmes, la vue et l’ouïe ont préséance. Vincent évoque le potentiel d’embaumer les lieux d’encens, de sauge, ou encore d’installer un tapis en herbe que fouleraient les visiteurs à leur entrée dans La Maison pour faire un lien supplémentaire avec la nature.
Un tour d’horizon des stratégies sensorielles orientant une expérience de visite complète et harmonieuse a été dressé ici. Il en ressort un ensemble sensoriel/relationnel aux cultures des Premières Nations qui est considéré explicitement par le musée dans sa mise en valeur du patrimoine autochtone, avec un accent sur le goût, ce qui s’avère plus efficace qu’en sollicitant la vue et l’ouïe seulement. L’expérience au musée se déploie également en relation aux émotions ressenties par la corporalité et participant de la connaissance par le corps, ce qui fait l’objet de la prochaine partie de l’analyse.
5.4 Émotions incarnées
J’entends ici aussi que les émotions passent nécessairement par la corporalité suivant la position de Kovach et al. (2014) et la sociologie des émotions qui a à présent largement intégré entre autres le travail de Freund (1990) à cet effet. Burkitt (2014) détaille l’importance du corps dans l’expérience émotionnelle en évoquant les métaphores ayant une connection corporelle à la réalité, par exemple “bursting with pride” (p. 74). Il construit autour du travail de William James et John Dewey pour confirmer que les sentiments sont influencés par la situation présente, et plus avant, par le temps (incluant l’expérience passée) et les valeurs. En ce sens, les émotions sont aussi comprises en tant que « dispositions » ou tendances (p. 60).
Il a été fait mention des constantes émotionnelles d’inclusion, de diversité, de partage et de rapprochement se dégageant de la mise en valeur du patrimoine autochtone à La Maison amérindienne, des nombreuses réponses et réflexions possibles pouvant émerger d’une seule visite dans un musée, et de l’expérience de savoir corporel multisensoriel au musée. Suivant Burkitt, ces valeurs et ces éléments sensoriels influenceraient donc, dans le moment présent, l’expérience émotionnelle des visiteurs. En d’autres mots, la mise en valeur du patrimoine autochtone au musée suggère, par la présence physique qu’elle demande aux visiteurs et par l’émotion qui passe nécessairement par la corporalité, une expérience émotionnelle tournant autour de l’échange, du partage et du rapprochement social tel qu’encodé par la mission du musée. Suivant la théorie de l’in/capacité incorporée de Valérie de Courville Nicol (2011), j’ai relié ces trois axes de la mission à des capacités incorporées qui s’éloignent de façon dialectique de leur pendant représentant un certain danger moral, soit respectivement le renfermement, l’égoïsme et l’éloignement dans les relations interpersonnelles. Ainsi, lorsque l’équipe mentionne un lieu de bien-être ou rassembleur, une approche multi-nations qui apporte des connaissances sur les Premières Nations, ou encore des partenariats essentiels au maintien de l’organisme, c’est une perspective relationnelle, explicite dans la mission du musée, qui assure une sécurité émotionnelle autant dans les actions de l’organisme que pour ses publics.
Ainsi, pour les Autochtones et les non-Autochtones participant et côtoyant la mise en valeur du patrimoine autochtone à La Maison, il semble y avoir globalement une expérience émotionnelle dite de capacité agentielle à participer ou appuyer la mise en valeur. Un exemple de cette capacité vécue par le corps est le partage musical et traditionnel auquel j’ai assisté lors du rassemblement du Festin de crabes : le coordonnateur aux événements spéciaux Louis-Xavier (Luis Sapiye) a chanté à la terre et au créateur (premier couplet) et à toutes ses relations (second couplet). Edith Bélanger a également partagé un récit d’histoire orale Wolastoqey portant sur la valeur du soin porté envers autrui à travers la nourriture. Non seulement l’espace devenait dédié au rayonnement de la culture et la tradition malécites à travers des personnes désignées, les publics de différentes nationalités avaient également accès à cette réalité, à cette mise en valeur par leur présence. Celles et ceux qui se produisaient dans cet espace suggéraient vivre un sentiment capacitant incorporé de partage et d’échange de leur savoir et leur art.
À travers son travail en territoire Eeyou, Ioana Radu (2018) définissait le respect comme un sentiment que l’on vit. Passant par l’expérience vécue corporellement dans les lieux immédiats du site du musée, ce sentiment fait en quelque sorte partie de l’expérience de visite, tout comme le partage ou le rapprochement, figurant en outre au haut de la liste du document Engagements et Valeurs du musée. Le sentiment de respect – envers le patrimoine, les collections, les visiteurs, les collaborateurs, les Premières Nations à l’origine du sirop, du maïs, du canot, et bien d’autres – est un savoir corporel. Cela fait écho à la position de Battiste et Henderson (2000) qui, à travers leur interprétation des musées dans le contexte de la protection du savoir traditionnel autochtone, établissent que, puisque “museums are a major factor in forming public perceptions of the nature, value, and contemporary vitality of Indigenous cultures,” leurs collections et expositions ont de ce fait le devoir de renforcer le respect envers ces cultures (p. 156). En d’autres mots, ces collections et expositions devraient inciter leurs publics à un décodage respectueux de ce qu’elles montrent. De là une relation respectueuse qui se transpose dans l’espace public, dans d’autres lieux que celui du musée. Il s’agit d’une rencontre sur un pied d’égalité et une connaissance d’autrui facilitée par l’expérience corporelle au musée, ce qui m’amène à la solidarité sociale.
6. Discussion : la rencontre sociale
6.1 Interprétation du sommaire des résultats
J’entends par cette analyse générale une étape au sein d’une démarche qui ne prétend pas, et ne pourrait pas, englober la totalité et la complexité de l’expérience entourant la mise en valeur du patrimoine autochtone. Ce portrait arrive toutefois à répondre à la question de recherche initiale : « Comment la mise en valeur muséale du patrimoine autochtone auprès du public québécois par La Maison amérindienne s’articule-t-elle pour créer un changement dans les relations sociales des peuples ? » Il en ressort principalement un contexte géographique, organisationnel, interculturel et multisensoriel qui capacite les actrices et acteurs impliqués par les actions du musée (voir Tableau I) à s’orienter vers la solidarité interculturelle, voire la guérison collective.
Plus spécifiquement, le modèle multi-nations situé hors communauté mettant l’accent sur une expérience positive qui tourne autour de l’échange et du rapprochement, est porteur d’un potentiel qui fait l’unanimité. La mise en valeur du patrimoine autochtone se fait à plusieurs niveaux, selon trois volets principaux, sur différents supports, à travers la multisensorialité et à travers divers objets et espaces : c’est un tout. La valorisation passe aussi par les relations entre personnes et organismes, entre époques, entre savoirs.
Ensuite, dans des cas spécifiques liés davantage aux aspects organisationnel et interculturel du musée, il appert qu’un supplément de positionnement identitaire et de contextualisation de la part de l’équipe et ses collaborateurs auprès de leurs publics actuels et futurs serait utile pour contribuer à une réalisation optimale de ce potentiel. En outre, cela établirait davantage ce modèle muséal singulier parmi le paysage muséal tribal et euro-canadien. Un exemple de stratégie efficace et accessible, qui se planifie au moment de la rédaction, est de dédier une section « Qui sommes-nous ? » au site Internet, présentant l’équipe mixte et son C.A. autochtone qui incarnent l’approche multi-nations collaborative, ce qui pourrait dissiper de possibles questionnements et doutes à l’endroit de l’identité ou des intentions du musée, qui se dédie au quotidien à la solidarité sociale.
| Aspect contextuel | Géographique | Organisationnel | Interculturel | Multisensoriel |
| Résultats d’analyse | Lieu de bien-être
Lieu rassembleur Lieu unique hors communauté Érablière comme patrimoine |
Collaboration
Savoir-faire (avant-garde, autonomie, expertise de l’équipe) Adaptation/résilience Diffusion et relations publiques nombreuses, essentielles Souci de pérennité |
Créneau multi-nations distinct
Connaissance/apprentissage comme solution à : Dynamique sociale résistance/ouverture |
Sensorium = culture
Particularité muséale gastronomique Visée d’une expérience sensorielle/émotionnelle complète, harmonieuse |
| Constat | Espace physique essentiel et stratégique à la mise en valeur | Succès organisationnel malgré barrières structurelles
Mise en valeur particulièrement prometteuse avec positionnement identitaire explicite |
Modèle majoritairement avantageux pour tous
Contextualisation parfois requise davantage pour l’efficacité de la rencontre |
Notion d’ensemble, de relationalité considérée et mise en valeur |
Tableau I. Synthèse des aspects contextuels à la mise en valeur du patrimoine du musée
Cette observation d’affirmation et de prévention est indissociable du contexte social dans lequel elle s’inscrit, contexte où, entre Autochtones et settlers de diverses origines, le positionnement identitaire est délicat, requis, et où il y a réappropriation des représentations avec une pleine conscience – comme en témoigne le travail de Smith (2012) – que l’héritage colonial qui se poursuit est caractérisé par l’oppresseur masquant sa propre subjectivité. Cette constatation se manifeste à travers une norme émotionnelle dialectique inspirée de la théorie d’in/capacité incorporée de Valérie de Courville Nicol (2011), que j’identifie « effacement/affirmation de soi », où l’effacement peut devenir incapacitant dans l’orientation organisationnelle de La Maison amérindienne, et où l’affirmation de soi peut être envisagée comme une capacité à faire état de ses dispositions envers autrui en tant qu’organisme, de ce fait augmentant le potentiel d’échange, de partage et de rapprochement dans ce contexte précis. Cette norme sociale d’affirmation de soi tournant autour de la confiance envers autrui, si l’on veut, m’apparaît en effet comme un symptôme des relations tantôt tendues, tantôt harmonieuses entre Autochtones et Québécois-e-s, et où il y a désir de dialogue de part et d’autre. Comme si, à condition de savoir quelle position ou quel bagage culturel porte et émet notre interlocuteur, le dialogue peut ensuite avoir lieu.
En somme, le cas de La Maison amérindienne illustre une forme particulière de mise en valeur muséale du patrimoine autochtone qui se définit autrement, d’une part, de l’approche traditionnelle euro-canadienne limitée en matière de sensorialité et de discours ancré aussi dans le présent pour mettre en valeur le patrimoine autochtone. D’autre part, cette forme se distingue de l’approche muséale spécifique à une nation, souvent située au sein d’une communauté. Avec les stratégies de mise en valeur encodées dans ce musée hybride – peut-on parler d’un musée métis ? – que j’ai analysées à travers ses aspects géographique, organisationnel, interculturel et multisensoriel, je constate une capacité de l’équipe de La Maison amérindienne à sublimer des forces et discours coloniaux et néocoloniaux. Cela se fait notamment par l’image positive et les connaissances à propos des diverses Premières Nations au Québec, et plusieurs nations d’ailleurs.
Cette capacité est une réponse directe aux « expériences de souffrance collectives » dérivant systématiquement d’injustices sociales (De Courville Nicol, 2011, p. 208-209) pour les Autochtones en relation à ces forces et discours néocoloniaux. La prémisse est que tout le monde est concerné par la souffrance et les conséquences d’une structure coloniale et impériale. Le sociologue Pierrot Ross-Tremblay expose que
c’est pas juste la souffrance des peuples autochtones, c’est la souffrance de tout le monde, c’est ça le problème, on prend les questions autochtones on les met comme si elles étaient à part […] on vit tous ensemble, un moment donné ça déborde. C’est au cœur même de la Constitution canadienne […] c’est au cœur du Québec, c’est le fondement de son histoire [de vivre ensemble] (cité dans Carrier & Higgins, 2014, 57:55).
Selon Ross-Tremblay, un appauvrissement généralisé naît des frontières que créent les identités collectives, les dichotomies de type « eux/nous ». Le concept de mosaïque verticale de Porter (1965) illustre bien la genèse de la classification hiérarchique ethnique au pays, et la souffrance collective qui en découle : les Britanniques, les Canadiens français, et les Premiers Peuples. La structure asymétrique aux fondements de la Constitution canadienne a participé de cette discrimination selon l’appartenance à une identité collective, et continue de le faire surtout auprès des Premières Nations, Métis et Inuits. Guindon (1988 [1978]) observait : l’accord des « deux solitudes » en 1837 entre marchands anglais et le clergé catholique assurant une hégémonie politicoéconomique britannique au détriment du développement socioéconomique du peuple canadien français qui assurait sa survie culturelle par le clergé ; puis la chute de ce pouvoir clérical, donc la modernisation du Québec, coïncidant avec la remise en question radicale de la légitimité et de la structure de l’État canadien.
Dans le cadre de cette analyse, cette mise en valeur s’inscrit dans l’allègement des expériences de souffrance collective des Autochtones et des Québécois, souffrances liées à l’une des formes les plus perturbatrices que puissent vivre des peuples, soit le colonialisme dont je reconnais les conséquences comme significativement plus profondes chez les Autochtones. Ce colonialisme se retrace historiquement à la France et à l’Empire britannique envers eux, et à l’Empire britannique envers les Canadiens français à partir de la Conquête. Pour leur part, les Québécois ont pour double tâche de se décoloniser pour éviter de perpétuer les erreurs héritées de leurs ancêtres, et de poursuivre la guérison de l’héritage colonial britannique à leur endroit.
Je soupçonne que cette position ambiguë des Québécois-es, dont les ancêtres ont à la fois colonisé puis ont été colonisés, contribue au lot de souffrance collective, à l’état d’ambivalence identitaire propre à la société québécoise moderne qui affecte la qualité des rapports sociaux avec les Premiers Peuples – ainsi que les peuples issus de l’immigration, sans doute. Pour l’artiste atikamekw Eruoma Awashish qui met de l’avant le métissage aux Amériques dans ses oeuvres, être bien ancré-e dans son identité et se connaître facilite l’échange interculturel : « c’est plus facile pour lui [ou elle] de s’ouvrir aux autres cultures sans qu’il y ait de malaise ou “qui est plus fort” ; tu es capable d’aller chercher ce qui est bon ailleurs puis tu n’as pas peur de partager [avec les] autres ta culture mais aussi de recevoir » (citée dans Carrier & Higgins, 2014, 48:15). Michel et Richard insistaient sur l’importance de connaître son histoire intergénérationnelle à la question de ce que les visiteurs devraient savoir. Serait-ce que l’oubli ou la méconnaissance identitaire nourrit la division entre peuples ? Les revendications des Premières Nations et des Québécois se rejoignent pourtant autour de la reconnaissance culturelle et linguistique, et du respect mutuel avec l’apparatus fédéral, à titre d’exemple.
En discutant de la nécessité d’obtenir du soutien financier au fonctionnement de l’entreprise culturelle d’économie sociale qu’est le musée, Chantal nuance : « On comprend bien qu’on n’est pas une priorité mais on est une priorité pour le vivre-ensemble… » L’analyse montre que les Premières Nations y semblent doublement valorisées, d’abord entre nations et puis parmi les non-Autochtones ; et que les Québécois actualisent leur propre histoire faite d’alliances maintenues et rompues, retour aux racines pour certains, prise de conscience ou davantage de connaissances pour d’autres. Par déduction, la réduction des préjugés à l’égard des Autochtones, voire une forme d’alliance nouvelle ou en continuité avec celles du passé, peut se réaliser. Par ce que je nommerais une certaine transmission muséale de la décolonisation patrimoniale (de la cabane à sucre, du maïs…) auprès des Québécois, un réenlignement de la mémoire collective ou une application concrète et différente de « Je me souviens », le travail patrimonial de La Maison amérindienne contribuerait à la guérison collective. Et l’agentivité des visiteurs qui viennent au musée avec un but et un bagage initial contribue bien sûr à cette transmission. Je propose donc que la dynamique de mise en valeur du patrimoine analysée dans ce travail agit dans la société globale d’une part par l’organisme à travers sa programmation et son fonctionnement, et d’autre part par les individus ayant vécu sur place l’expérience de savoir corporel et de rencontre. En expliquant les représentations autochtones de La Maison au fil des ans, Chantal explique :
[…] nous, depuis 18 ANS c’est un travail qu’on fait d’une certaine façon qui a pour but de mieux connaître l’autre, on n’est pas en train de faire un travail de réconciliation selon les normes des politiciens, mais les gens apprennent à se connaître, et après c’est à eux de se réconcilier. On est très ancrés dans ça et depuis TOUjours […] comme André Michel souvent va le dire, lui qui est un émigrant, il explique souvent que les gens au Québec ne sont pas faits pour vivre comme ça [geste des mains en parallèle] mais comme ça [geste des doigts entrecroisés] [rires] ensemble je veux dire.
Il y a une forme de réciprocité citoyenne qui est encouragée et souhaitée par cette initiative. Apprendre à se connaître nécessite aussi une interaction sociale, laquelle est physiquement facilitée par le musée autochtone dans un contexte où les Québécois connaissent peu et vont peu rencontrer leurs voisins tantôt à Odanak, tantôt à Mashteuiatsh, ou à Kitigan Zibi, et même au cœur de Tiohtià :ke/Montréal avec sa communauté urbaine autochtone diversifiée, à la fois locale et internationale. L’empathie est le sentiment prérequis à l’interaction sociale selon De Courville Nicol (2011), ainsi que le sentiment qui conditionne l’expérience émotionnelle sociale, en tant que capacité de comprendre ce que ressent autrui.
As a means of exercising embodied autonomy, empathy affects the quality of relations between self and other. Agents’ capacity to understand what other agents feel affects what they feel and how they act in response to what they feel. […] As such, collective feelings may be said to develop through a process of situation assimilation in which selves adopt others’ emotional orientations toward specific objects of fear and desire (p. 81).
On pourrait prendre l’exemple d’un visiteur qui pourrait comprendre davantage les défis auxquels font face les Premières Nations, Métis et Inuits, et leur ressentiment et revendications qui en découlent à l’endroit du Québec, cette compréhension suscitant la recherche de façons d’abonder dans le sens des revendications. Ce pourrait aussi être une compréhension freinée par peur de tout ce que la vérité de l’histoire remue, suscitant des façons de résister aux revendications.
Ce niveau d’empathie peut même aller jusqu’à l’émotion sociale (social emotion), qui implique la capacité d’empathie combinée à la capacité de se soucier de ce qu’autrui ressent, i.e. la sympathie, l’incapacité qui y est reliée étant l’indifférence (De Courville Nicol, 2011, p. 82). Il y a toutefois une distinction à faire entre sympathie et ce que Coulthard (2014) a nommé la politique coloniale de la reconnaissance (colonial politics of recognition), une forme de sympathie néoraciste qui ne fait que perpétrer l’attitude coloniale, du fait qu’elle conforte les gens qui assument la reconnaissance comme finalité en soi en oubliant les réelles injustices civiles continues à l’égard des peuples autochtones. C’est l’émotion sociale, soit l’empathie avec la sympathie, qui semble être visée à travers la mission d’un musée tel que La Maison amérindienne, qui initie une rencontre physique entre nations et mise sur l’agentivité des gens à faire ensuite des actes de réparation, à respecter le principe de réciprocité.
De façon similaire, en détaillant les activités du Cercle Kisis, espace de rencontre apolitique de discussion entre Premiers Peuples et Québécois, Alexandre Bacon souligne la nécessité fondamentale d’une rencontre d’une part comme de l’autre (Vaudry, 2016, p. 100). Semblable à la mission et à l’action de La Maison amérindienne, la mission du Cercle Kisis vise « un plus grand ralliement des cultures autochtones et le rapprochement entre l’ensemble des peuples » (p. 99), et mise sur l’importance d’une rencontre physique à Québec pour voir et comprendre l’autre. Est mise en valeur l’intelligence collective du groupe. Bacon donne l’exemple de Québécois qui peuvent se rendre compte à travers cette expérience de la distance à parcourir pour nombre de membres des Premières Nations avant de se sentir chez eux dans des lieux tels une université ou un centre-ville, le réflexe étant d’abord d’observer et d’attendre pour comprendre la dynamique de ces entités (Vaudry, 2016, p. 104).
En somme, cette forme muséale – possiblement représentée aussi mais de différente envergure par le National Museum of the American Indian aux États-Unis – est distincte du modèle des musées standard et tribaux, formes qui opèrent toutes en relation avec leur paysage social. À travers mon expérience à La Maison amérindienne, j’apparente ce modèle hybride à la métaphore d’une traverse. Celle-ci se reconstruit et se solidifie souvent au fil des interactions entre les gens qui vont et viennent sur les deux rives. Cette traverse est plus précisément piétonnière et cyclable, incluant nécessairement plusieurs points d’observation pour s’arrêter, car en voiture et en camion, le rythme est beaucoup trop rapide pour s’arrêter et échanger, et on n’a qu’une vue furtive à travers une fenêtre sale. Ces propos de Bacon pourraient aussi bien résumer le travail de La Maison :
On a tous un rôle à jouer. Il y a des Québécois [ou d’autres allochtones] dont justement, leur rôle est d’aller ou d’être dans cette zone d’incertitude, à la rencontre de l’autre. D’autre part, il va y avoir des Autochtones audacieux, qui vont venir à ta rencontre. Dans le fond, vous êtes les artisans de la construction d’un pont. […] c’est le devoir de tous ces artisans du changement de construire de nouveaux liens sociaux entre les gens, entre les peuples (cité dans Vaudry, 2016, p. 104).
J’ouvre à présent la discussion sur le rôle que peuvent jouer les musées dans le dialogue, la rencontre sociale, voire la guérison collective, pour les Autochtones et les non-Autochtones.
6.2 Le rôle des musées dans l’espace social
Les musées reflètent les situations politiques qui les entourent (CMA, 2017), tout comme la théorie sociologique des champs de Bourdieu (1992) positionne le champ de production culturelle nécessairement lié au champ du pouvoir et au champ social. Plus précisément encore, pour Ohtsuka (1996) qui commentait le débat sur les représentations des Ainu au Musée National d’Ethnologie du Japon, étudier la pratique muséale revient à ouvrir une porte sur l’étude du débat culturel interne d’une nation donnée. En réponse aux critiques d’Ohtsuka, Niessen (1996) acquiesçait aussi à quel point le musée joue un rôle important, prenant pour exemple le boycott du Glenbow Museum par les Cris de Lubicon Lake ayant pris une ampleur internationale et une refonte des pratiques muséales occidentales via la participation de ce même musée : “Museums can and sometimes do have tremendous social impact” (p. 139).
Tel que survolé à travers la revue de littérature, il y a un certain potentiel des musées en tant qu’institutions à contribuer à la revitalisation et la résistance autochtones de par leur nature. Tout en reconnaissant la solide contradiction que suppose l’héritage colonial perpétré par ces institutions, leur nature est relationnelle entre visiteurs, objets, conservateurs et collaborateurs (CMA, 2017). En tant que véhicule majeur de valorisation patrimoniale et que production culturelle caractérisant les musées, l’exposition a une nature sociale par les interactions et les validations qu’elle demande parmi ses organisateurs, entre autres (Soulier, 2015). La tendance muséale est précisément à ce que les musées deviennent plus relationnels (CMA, 2017), notamment depuis l’accent mis sur les collectivités et les publics plutôt que les collections comme l’ont relevé Miguet (1998) ou Clavir (2002). Le changement de paradigme a fait passer l’authentique objet de musée à l’authentique expérience de visite. En outre, l’indigénisation de ces institutions originellement occidentales en tant que musées tribaux à travers le monde et utilisées comme outils de souveraineté culturelle, contrevient à la définition entrevoyant les musées uniquement en tant qu’institutions coloniales.
James Clifford (2004), professeur d’histoire de la conscience à l’Université de Californie, apporte une nuance : le travail patrimonial est non pas un substitut aux revendications autochtones mais y est étroitement relié. Il présente le Alutiiq Museum and Archaeological Repository comme ayant aidé à détourner les préjugés locaux en ce qui a trait au fait d’être autochtone (p. 18). De façon similaire, La Maison amérindienne opère dans le but de briser les préjugés comme le rapportait Audrey, et rappelle aux Québécois une grande part de leur développement socioéconomique grâce aux Autochtones, suggérant la responsabilité d’honorer les relations avec leurs hôtes historiques. Le travail patrimonial à La Maison rappelle la légitimité et la présence autochtone au Québec, tout en favorisant une dynamique d’échange entre les sociétés concernées. Pour Clifford, le travail patrimonial joue sans conteste un rôle social notable en ce qui concerne la reconnaissance de l’identité autochtone dans l’espace public, malgré les critiques de nostalgie à consommer (commodified nostalgia) qu’on lui prête (p. 8) : “Heritage projects participate in a range of public spheres, acting within and between Native communities as sites of mobilization and pride, sources of intergenerational inspiration and education, ways to reconnect with the past and to say to others: ‘We exist,’ ‘We have deep roots here,’ ‘We are different’…” (p. 8). Surtout, à travers la continuité des traditions et des lieux qu’il opère de façon sélective, le travail patrimonial peut s’inscrire dans un “social process that strengthens indigenous claims to deep roots – to a status beyond that of another minority or local interest group” (p. 9).
Clifford souligne le potentiel d’alliance entre Autochtones et non-Autochtones à condition qu’elle soit fondée sur le partage des ressources, le respect, et un positionnement révisé de l’autorité (surtout académique) pour laisser de l’espace à l’autorité autochtone (2004). Il brosse également un portrait des limites de la collaboration dans les projets patrimoniaux, à savoir la partialité et la contingence de ces projets ; ainsi que la situation problématique que vivent de nombreuses personnes autochtones dans le monde contemporain, qui n’est pas résolue pour autant par le musée, lequel est souvent plus utile aux puissants qu’aux désœuvrés. Le musée n’apporte pas des changements structurels socioéconomiques de fond en ce sens, mais a pour direction ces changements à travers son action culturelle. Ruth Philipps (citée dans Clifford, 2004) questionne le rôle du musée par rapport aux changements sociaux en demandant s’il n’effectuerait pas une restitution symbolique des torts causés par le colonialisme plutôt que des redressements économiques et politiques plus concrets, et si la pratique plus fréquente de projets patrimoniaux collaboratifs ne serait que le témoin d’une certaine agentivité sociale de ces institutions. Elle ne nie toutefois pas la valeur des projets patrimoniaux collaboratifs et ceux provenant de musées tribaux (p. 22). Enfin, la vision de collaboration à long terme doit être toujours réitérée au gré des différents changements d’affectation du personnel, surtout à la direction et la conservation des musées non-autochtones, ce qui pose son lot de défis (CMA, 2017).
En même temps, lorsqu’on considère les projets patrimoniaux comme s’inscrivant dans le tout que constituent les politiques d’autodétermination, leur signification devient emplie de possibles : “They act within and against new national and transnational structures of empowerment and control” (Clifford, 2004, p. 23). En outre, Cobb (2005), Lonetree et Cobb (2008) et Boxer (2016) voient dans les musées et les centres culturels des sites de résistance des communautés tribales, les qualifiant de “vehicles to which Indigenous voices, knowledge and ways of being can be broadcast to the dominant society” (Boxer, p. 89). Pour reprendre la terminologie de Stuart Hall dans le cas des Autochtones au Québec, il y a l’encodage d’un langage muséal et d’un langage culturel d’une nation autochtone donnée, qui sert à diffuser à une audience euro-canadienne et québécoise une lecture oppositionnelle ou négociée de la narration officielle, invitant un décodage correspondant chez cette audience. Pour Nicole Obomsawin, la transmission de la culture, le transfert des connaissances auprès des jeunes et moins jeunes, sont très importants. Au moment du tournage du documentaire d’Alanis O’Bomsawin (2006), la directrice disait avoir hâte d’établir un programme éducatif spécifique pour la communauté par le biais du musée.
De plus, Wiseman (2001) voit dans les projets de rapatriement de restes archéologiques des musées aux peuples autochtones un fondement clé des relations (entre Américains et Autochtones dans son analyse), une guérison selon le principe circulaire : “repatriation, closing the circle between consumer and subject, is possible” (p. 3). De même, Clavir (2002) traite de la revitalisation culturelle que représente le rapatriement. Kahente Horn-Miller (Kanien’kehà :ka) (2018) qualifie cette entreprise de « ramatriement » (rematriation), redonnant de ce fait leur titre aux traditions issues des sociétés matriarcales. Pour Nika Collison (Haida), du Haida Gwaii Museum, énormément de guérison et de rapatriement se produit dans le monde autochtone et occidental ; les objets ne sont pas que des objets, ils participent d’une transformation en étant manipulés par les descendants de leur peuple d’origine, par exemple le coffret (transformation-chest) rapatrié et manipulé par des Haida de Skedans (village au nord-ouest de la Colombie-Britannique) en plein cœur de New York (CMA, 2017).
Pour Nadine Saint-Louis (CAM, 2018), “every piece [and] artifact […] is the embodiment of our stories,” de sorte que l’objet est porteur, transmetteur de l’histoire. Encore, des objets du peuple Wendat sont répartis dans des musées partout sur le globe ; ils renseignent sur toute l’histoire, toutes les époques de ce peuple (Siouï Labelle, 1998). Les résultats du Rapport du Groupe de Travail (1992) mettaient de l’avant l’importance et le rôle de sensibilisation des objets culturels dans les collections de musées, qui doivent être des « forums » pour adresser les « problèmes contemporains » (p. 6). Ces interprétations compatibles avec celles des professionnels autochtones du patirmoine interviewés par Clavir (2002) sur ce qui doit être préservé et valorisé au musée contraste beaucoup avec l’exemple d’appauvrissement que donnait Peers (2000) sur les objets décontextualisés, non identifiés de la Chase Manhattan Gallery, sélectionnés pour leur seul intérêt esthétique. Ces professionnels affirment en effet que les objets sont pour ce que nous faisons, “for what we do” (Clavir, 2002, p. 245-249), de sorte que prendre soin d’artefacts peut en fait signifier aussi recevoir des visiteurs qui leur donnent air et aliments et leur dédient des cérémonies, de les orienter dans certaines directions, ou de les utiliser, et non pas de les laisser systématiquement inertes et « suffoquer » dans des caissons scellés au nom de la conservation à tout prix (Cobb, 2005, p. 494). En effet, “Native traditional care is concerned with an object’s spiritual integrity and meaning and function within its community” (p. 494). Au final, Kenneth Burke (1998) faisait reconnaître sociologiquement la littérature (proverbes, œuvres littéraires, langues), et par extension toute œuvre comme représentation d’une situation sociale récurrente, comme étant dotée d’une nature active, utile à la vie et à orienter nos attitudes. L’objet culturel, l’œuvre, l’exposition en entier sont tellement plus vivantes et actives qu’à première vue.
Les projets collaboratifs entre musées non-autochtones et communautés sont hautement recommandés lorsque les ressources font défaut pour le rapatriement, la création d’un musée tribal ou d’un centre culturel ou d’archives selon Vernier (2016) ; nous sommes effectivement dans un contexte où ce ne sont pas toutes les communautés qui peuvent préserver et revendiquer leur héritage. Chavez Lamar (Pueblo/Hopi-Tewa/Navajo), Vallo (Acoma) et Smith (CMA, 2017) ont aussi apporté la nuance selon laquelle la consultation n’est pas la collaboration, laquelle suggère du temps, du travail pour se familiariser entre collaborateurs, une autorité et une prise de décision partagées, ce qui est unique à chaque collaboration entre institution et communauté. De même, l’accommodement est encore moins la collaboration, tel qu’explicité par Morgan (1999). Sous cet angle, le projet collaboratif muséal comme solution de rechange au scénario idéal de rapatriement, de musée tribal ou de centre culturel, suggère que l’institution muséale joue un rôle social non négligeable – reposant sur une bonne volonté de part et d’autre dans le contexte actuel, influencée par exemple par la loi NAGPRA ou le Rapport de Travail. Ultimement, le scénario idéal serait, dans l’idée d’assurer d’un point de vue juridique des relations plus harmonieuses entre Premières Nations et Québécois ou Canadiens, l’obligation de l’ensemble de ses institutions de la mémoire à présenter « l’héritage […] de la nation » comme en Nouvelle-Zélande, conformément au Traité de Waitangi établissant une nation biculturelle maorie et britannique (Vernier, 2016, p. 6).
Intrinsèque aux débats sur les limites et le potentiel des musées en tant qu’institutions, la culture en soi est porteuse d’un pouvoir indépendant selon le point de vue inspiré de la sociologie culturelle et de la sociologie des émotions d’Ann Swidler (2002), quoi qu’en croient ou en doutent les acteurs sociaux. De façon dialectique, “institutions structure culture by systematically patterning channels for social action” (p. 320), et la culture influence les choix des individus qui puisent dans ce que Swidler (2001) nomme un répertoire culturel (repertoire), un coffre à outils utile pour orienter la prise de décision. Il est clair, de ce point de vue, que les institutions muséales autochtones ainsi que les musées non-autochtones qui se dédient à des projets collaboratifs de qualité influencent la culture de la société québécoise par l’action de décolonisation et de continuité culturelle autochtone qu’elles déploient. Le Groupe de travail des années 1990 reconnaissait déjà le travail significatif des musées quant à la sensibilisation des publics et à la préservation des patrimoines autochtones (Task Force et al., 1992 ; Vernier, 2016).
Cette analyse concerne le dialogue social entre Autochtones et non-Autochtones qu’initient et que doivent initier les musées au Québec, à travers le cas de La Maison amérindienne et grâce à la collaboration de son équipe. S’ils sont fidèles à leur mandat patrimonial et de valorisation identitaire, les êtres humains qui organisent l’action de ces musées sur le territoire s’engagent à contribuer activement d’abord à se décoloniser en tant que personnes et qu’institutions, puis collaborent selon une vision relationnelle à la mise en valeur du patrimoine autochtone, alors il y a de quoi se réjouir.
VI. Directions futures
Peu d’universitaires se sont penché-e-s sur la muséologie autochtone au Québec, hormis certaines pionnières telles Élisabeth Kaine et Élise Dubuc. Ce projet espère combler certaines lacunes en ce sens à travers l’exploration des pratiques muséales de mise en valeur du patrimoine d’un organisme multi-nations implanté au tournant des années 2000. Autant la littérature en muséologie et en anthropologie muséale abonde sur les pratiques collaboratives concernant le patrimoine autochtone et sur les idéaux corollaires à ces pratiques, en réaction à un héritage de représentations erronées, autant il y a peu de perspective sociologique du phénomène au Québec. J’ai tenté de répondre à ce défi en m’appuyant sur les études décoloniales, sur la sociologie des émotions et les études sensorielles, à l’intersection entre la sociologie culturelle et de la culture. Les défis ne manquent pas pour atteindre une muséologie autochtone davantage dotée de ressources (Dubuc, 2006) et il reste beaucoup de chemin à faire en matière de sensibilisation et d’expertise en muséologie québécoise et canadienne quant au patrimoine autochtone et aux procédures qui l’entourent (Dubuc, communication personnelle), participant à des relations plus harmonieuses entre Autochtones et Québécois-es.
Soulier (2015) a souligné le travail d’analyse qui reste à faire sur l’impact des expositions plurivocales ainsi que de la collaboration et des dispositifs d’exposition générés par cette approche. J’espère contribuer humblement en ce domaine par l’exploration du modèle multi-nations de La Maison amérindienne. L’analyse qui en découle peut potentiellement contribuer à une muséologie plus informée des réalités patrimoniales et sociales autochtones, et plus globalement à la réflexion sur le rapprochement entre Autochtones et Québécois. Cela enrichit le concept muséologique de mise en valeur en contraste avec la représentation (erronée, contrôlée, à se réapproprier, etc.) dont la littérature traite déjà abondamment.
Cette recherche s’inscrit plus largement dans le travail amorcé par plusieurs chercheuses et chercheurs autochtones visant une plus grande place dédiée au point de vue autochtone dans le milieu académique, tel qu’encouragé par Kovach (2010 ; 2016) et Smith (2012). Pour une compréhension encore plus intégrative de la mise en valeur du patrimoine autochtone au Québec, il serait pertinent de réaliser des études de publics extensives et d’inclure les voix de différents partenaires et collaborateurs artistes autochtones. Des études comparatives entre la mise en valeur muséale et celle d’autres institutions tels les centres culturels et les écoles, par exemple le collège Kiuna à Odanak ayant pour mission la mise en valeur de la culture et des traditions des Premières Nations, enrichirait aussi la compréhension du phénomène. Il serait peut-être même plus pertinent de faire des analyses relationnelles de l’action conjointe de ces institutions, comme l’analyse de Soulier (2015) sur la reconnaissance du point de vue autochtone de jeunes étudiants du collège Kiuna et de jeunes étudiants québécois en visite au Musée McCord dans le cadre d’un programme éducatif.
Eyah : de l’abénaki, qui signifie : « C’est fait. »
VII. Bibliographie
Adese, J. (2015). “Behaving unexpectedly in expected places. First Nations artists and the embodiment of visual sovereignty.” Dans E. Coburn, dir., More Will Sing Their Way to Freedom : Indigenous Resistance and Resurgence (pp. 129-147), Winnipeg, MB: Fernwood Publishing.
Albrecht, G., Sartore, G.M., Connor, L., Higginbotham, N., Freeman, S., Kelly, B., … & Pollard, G. (2007). “Solastalgia : the distress caused by environmental change.” Australasian psychiatry, 15 (1), S95-S98.
Alfred, T., & Corntassel, J. (2005). “Being indigenous: Resurgences against contemporary colonialism.” Government and Opposition, 40 (4), 597-614.
Alliance autochtone du Québec (2007). « Sirop d’érable, une coutume héritée des Amérindiens. » Alliance autochtone du Québec, Repéré à https://www.autochtones.ca/portal/fr/ArticleView.php ?article_id=417
Ames, M.M. (1992). Cannibal Tours and Glass Boxes: The Anthropology of Museums. Vancouver, BC: UBC Press.
Ames, M. M. (2000). “Are changing Representations of First Peoples in Canadian Museums and Galleries challenging the Curatorial Prerogative?” Dans W.West (dir.), The Changing Presentation of the American Indian (pp. 73-88), Seattle, WA: University of Washington Press.
Angus Reid Institute (2015). Truth and Reconciliation Commission, 2015. User Guide. Vancouver, BC: Angus Reid Institute/Data Services, Queen’s University.
Anthony, T. (2013). Indigenous People, Crime and Punishment. London: Routledge.
Assemblée des Premières Nations (2007). PCAP : Propriété, contrôle, accès et possession. Données sur le droit inhérent des Premières Nations à régir leurs données. Ottawa, ON : Assemblée des Premières Nations.
Assemblée des Premières Nations (2017). L’Assemblée des Premières Nations. Repéré à www.afn.ca/fr/accueil
Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (2014). Protocole de recherche des Premières Nations au Québec et au Labrador. Wendake, QC : Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.
Association des musées canadiens (s.d.). « Réconciliation », Association des musées canadiens, repéré à https://museums.ca/site/aboutthecma/reconciliationprogram
Barbalet, J. (2001). “Emotion and rationality.” Dans Emotion, Social Theory and Social Structure: A Macrosociological Approach (p. 29-61), Cambridge: Cambridge University Press.
Battiste, M.A., & Henderson, J.Y. (2000). Protecting Indigenous Knowledge and Heritage: A Global Challenge. Saskatoon, SK: Purich.
Bell, C.E., & Napoleon, V. (2008). First Nations Cultural Heritage and Law: Case Studies, Voices, and Perspectives. Vancouver, BC: UBC Press.
Bell, C.E., Lai, J.C., & Skorodenski, L.K. (2014). « Lois autochtones, loi sur la propriété intellectuelle et politiques muséales. Des diverses méthodes de protection du patrimoine immatériel autochtone. » Anthropologie et Sociétés, 38 (3), 25-59.
Bardou, M. (21 janvier 2019). « Robert Lepage Kanata ». Artpress 463, 25-29.
Bergeron, Y. (2010). « L’invisible objet de l’exposition. Dans les musées de société en Amérique du Nord. » Ethnologie française, 40 (3), 401-411.
Bibaud, J. (2015), « Muséologie et Autochtones du Québec et du Canada. De la crise à la décolonisation tranquille. » Mémoire(s), identité(s), marginalité(s) dans le monde occidental contemporain, 15. doi : 10.4000/mimmoc.2169
Bird, S.E., dir. (1996). Dressing in Feathers: The Construction of the Indian in American Popular Culture. Boulder, CO: Westview Press.
Blanchard, M., & Howes, D. (2014). « Se sentir chez soi au musée : tentatives de fusion des sensoria dans les musées de société. » Anthropologie et Sociétés, 38 (3), 253-270.
Bolton, S. (2004). An Analysis of the Task Force on Museums and First Peoples: The changing Representation of Aboriginal Histories in Museums. [mémoire] Montréal, QC: Université Concordia.
Bouchard, G. (2014). L’Interculturalisme : un point de vue québécois. Montréal, QC : Boréal.
Bourdieu, P. (1992). Les Règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire. Paris : Seuil.
Bousquet, M. (1996). « Visions croisées : les Amérindiens du Québec entre le Musée de la Civilisation et les musées autochtones. » Ethnologie française, 26 (3), 520-539.
Boxer, M. (2016). “‘2,229’: John Joseph Mathews, the Osage Tribal Museum, and the Emergence of an Indigenous Museum Model.” Wicazo Sa Review, 31 (2), 69-93.
Brown, H.J. (2012) “Book Review. Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations and Contexts.” Canadian Journal of Nursing Research, 44 (2), 163-166.
Burke, K. (1998). “Literature as Equipment for Living.” Dans D.H. Richter, dir., The Critical Tradition. Classic Texts and Contemporary Trends (p. 593-598), Boston, MA: Bedford Books.
Burkitt, I. (2014) “Emotions and the Body: Emotions and the Body in Neuroscience.” Dans Emotions and Social Relations (p. 51-99), London: Sage Publications.
Canadian Conservation Institute (2008). Preserving Aboriginal Heritage: Technical and Traditional Approaches. Proceedings of a Conference Symposium 2007. Ottawa, ON: Canadian Conservation Institute.
Canadian Conservation Institute (2015). “Caring for Sacred and Culturally Sensitive Objects.” Government of Canada, Repéré à http ://canada.pch.gc.ca/eng/1448995219999
Candito, N., Boury, M., Hooge, E. & Zaragori, Q. (2013) Étude de réception auprès des visiteurs du musée Lyon Fourvière. Rapport d’analyse. Lyon : Museomix 2012.
Carrier, M. & Higgins, O., réalisateurs (2014). Québékoisie [Documentaire]. Montréal, QC : Mö Fims.
Carrier, M. & Higgins, O., réalisateurs (2011). Rencontre [Documentaire]. Montréal, QC : Mö Fims.
Centre des sciences (2018). « Génie autochtone. » Centre des sciences, Repéré le 20 mars 2019 à https ://www.centredessciencesdemontreal.com/exposition-temporaire/genie-autochtone
Classen C. & Howes, D. (2006). “The Museum as Sensescape: Western Sensibilities and Indigenous Artifacts.” Dans R.B. Phillips, C. Gosden & E. Edwards, dir., Sensible Objects: Colonialism, Museums and Material Culture (p. 199-222), Oxford, NY: Berg Publishers.
Clavir, M. (2002). Preserving what is valued: Museums, Conservation, and First Nsaùations. Vancouver, BC: UBC Press.
Clément, É. (9 août 2018). « André Michel. Mettre un visage sur l’itinérance urbaine autochtone » [article]. La Presse+, repéré le 25 avril 2019 à http://mi.lapresse.ca/screens/e4e20a76-8c2e-46a5-9601-2ea98955547c__7C___0.html
Clifford, J. (1988). The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, MS: Harvard University Press.
Clifford, J. (1997). “Four Northwest Coast Museums: Travel Reflections.” Dans Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century (p. 107-146), Cambridge, MA: Harvard Univertiy Press.
Clifford, J. (2004). “Looking Several Ways: Anthropology and Native Heritage in Alaska.” Current Anthropology, 45 (1), 5-30.
Cobb, A.J. (2005). “The National Museum of the American Indian as Cultural Sovereignty.” American Quarterly, 57 (2), 485-502.
Commission de toponymie du Québec (avril 2019). « Québec. » Gouvernement du Québec. Repéré à http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx ?no_seq=51718
Conseil des Arts de Montréal (2018). Journée de réflexion et dévoilement de l’étude « Pratiques professionnelles en arts visuels issues de l’autochtonie et de la diversité à Montréal », présenté à Montréal, QC : Conseil des Arts de Montréal.
Côté, J.-F. & Benessaieh, A. (2012). « La reconnaissance des formes d’un cosmopolitisme pratique au sein des Amériques : transnationalité et transculturalité. » Sociologie et Sociétés, 44 (1), 35-60.
Council for Museum Anthropology (2017). Museum Anthropology Futures, présenté à Montréal, QC: Council for Museum Anthropology et Université Concordia.
Coulthard, G.S. (2014). Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
Davallon, J., dir. (1986). « Gestes mise en exposition. » Dans Claquemurer pour ainsi dire tout l’univers. La mise en exposition (p. 241-266), Paris : Centre Georges-Pompidou et Centre de création industrielle.
Dean, D. (1994). “The Exhibition Development Process, Human Factors in Exhibition Design et Behavioral Tendencies.” Dans Museum Exhibition: Theory and Practice (p. 8-18),. Londres, New York: Routledge.
De Courville Nicol, V. (2011). Social Economies of Fear and Desire: Emotional Regulation, Emotion Management, and Embodied Autonomy. New York: Palgrave Macmillan.
De Courville Nicol, V. (2021). Anxiety in Middle-Class America: Sociology of Emotional Insecurity in Late Modernity. Londres, New York: Routledge.
De Julio Paquin, J. (2007). L’Art des premières nations : La Maison Amérindienne. Vie Des Arts, 51(207), 60.
Delorimier, T. (2019). Food Sovereignty & Social Impact of Indigenous Cuisine, présenté à Concordia’s First Voices Week, Montréal QC: First Peoples Studies Program and Member Association.
DesChâtelets, L., intervieweuse (automne 2013). « Quand l’artiste se raconte… » [émission de télévision]. Dans P. Maltais, réalisateur, Le Confident. Montréal, QC : MAtv.
Desmarais-Tremblay, L. (2016). L’histoire de qui ? Une analyse critique des rapports entre les autochtones et le Musée de la Civilisation à Québec dans le cadre de l’élaboration de l’exposition C’est notre histoire : Premières Nations et Inuits du XXIe siècle. [mémoire] Montréal, QC : Université du Québec à Montréal.
Dubuc, É., & Turgeon, L. (2004). « Musées et Premières Nations : la trace du passé, l’empreinte du futur. » Anthropologie et Sociétés, 28 (2), 7-18.
Dubuc, É. (2006). « La nouvelle muséologie autochtone. » Muse, novembre 2006, 28-33.
Dudzinska-Przesmitzki, D., & Grenier, R.S. (2008). “Nonformal and Informal Adult Learning in Museums: A Literature Review. Journal of Museum Education, 33 (1), 9-22.
Dufresne-Tassé, C., Lapointe, T., Morelli, C., & Chamberland, E. (1991). « L’apprentissage de l’adulte au musée et l’instrument pour l’étudier. » Revue canadienne de l’éducation, 16 (3), 281-291.
Dufresne-Tassé, C. (2010). « Comportement, fonctionnement psychologique du visiteur et structure de la mise en exposition des phénomènes scientifiques. » Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, 1-21. Repéré à http://www.cirst.uqam.ca/PCST3/PDF/Communications/DUFRESNE-TASSE.pdf
Écomusée du fier monde (19 avril 2018). « Nomades ou itinérants – peuples en danger. » [dossier de presse] Écomusée du fier monde. Repéré à http://ecomusee.qc.ca/2018/04/19/nomades-ou-itinerants-peuples-en-danger/
Edles, L.D. (2002). Cultural Sociology in Practice. Malden, MA: Blackwell Publishers.
Espace pour la vie (s.d.). « Jardin des Premières-Nations. » Espace pour la vie Montréal. Repéré le 25 avril 2019 à http://m.espacepourlavie.ca/jardins-et-serres/jardin-des-premieres-nations
Forte, M. C., dir. (2013). Who is an Indian? Race, Place, and the Politics of Indigeneity in the Americas. Toronto, ON: University of Toronto Press.
Foster, J.B. (1999). “Marx’s Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology.” American Journal of Sociology, 105 (2), 366-405.
Franco, M.-C. (2012). Le musée : un outil de développement identitaire et communautaire en contexte autochtone ? Le cas du musée des Abénakis à Odanak. [mémoire] Montréal, QC : Université du Québec à Montréal.
Freund, P. (1990). “The Expressive Body: A Common Ground for the Sociology of Emotions and Health and Illness.” Sociology of Health and Illness, 12 (4), 452-77.
Geddes, C. (s.d.). « Visions autochtones : cinéma et représentation. » Office national du film. Repéré en mars 2018 à http://floraInternet.onf.ca/enclasse/doclens/visau/index.php ?mode=theme&language=french&theme=30661&film=&excerpt=&submode=about&expmode=2
Gee, J.P. (2011). An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method (3rd ed.). Abingdon/New York: Routledge
Gélinas, C. (2007). Les Autochtones dans le Québec post-confédéral : 1867-1960. Sillery, QC : Septentrion.
Gervais, S., Papillon, M., & Beaulieu, A. (2013). Les Autochtones et le Québec : des premiers contacts au Plan Nord. Montréal, QC : Les Presses de l’Université de Montréal.
Grande confrérie du Cassoulet (s.d.) « L’histoire du cassoulet de Castelnaudary. » Grande confrérie du Cassoulet, Repéré à http://www.confrerieducassoulet.com/l-histoire.html
Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines et Université du Québec à Montréal (2018). Colloque L’appropriation culturelle et les peuples autochtones, présenté à Montréal, QC : Université du Québec à Montréal.
Guindon, H. (1988). Quebec Society: Tradition, Modernity, and Nationhood. Toronto, ON: University of Toronto Press.
Hall, S., dir. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications.
Hall, S. (1999). “Encoding, Decoding.” Dans S. During, dir., The Cultural Studies Reader (2nd ed.) (p. 507-517), UK: Routledge.
Havard, G. & Laugrand, F., dir. (2014). Éros et Tabou. Sexualité, genre et culture dans les sociétés autochtones d’Amérique du Nord. Sillery, QC : Septentrion.
Horn-Miller, K. (2018) Savage Scholar: A Kanien’kehà :ka Journey through Academy, présenté à Renouncing the Ivory Tower: The Decolonization of Anthropology and Sociology. Montreal, QC: Sociology and Anthropology Graduate Students Association, Concordia University.
Howes, D. (2003). Sensual Relations: Engaging the Senses in Culture and Social Theory. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
Janin, A. (2005). Le Musée des Abénakis d’Odanak, lieu d’identité, de conservation et de transmission d’un patrimoine original : la vannerie. [mémoire] Montréal, QC : Université du Québec à Montréal.
Jasper, J.M. (2013). “Feeling-thinking: Emotions as Central to Culture.” Dans B. Baumgarten, P. Daphi et P. Ullrich, dir., Conceptualizing Culture in Social Movement Research (p. 23-44), New York: Palgrave Macmillan.
Kaine, E. (2004). « Des expériences communautaires de mises en exposition en territoire inuit : note de recherche. » Anthropologie et Sociétés, 28 (2), 141-154.
Kaine, E. & Dubuc, É. (2010). Passages migratoires : valoriser et transmettre les cultures autochtones. Québec, QC : Presses de l’Université Laval.
Kovach, M. (2010). “Conversational Method in Indigenous Research.” First Peoples Child and Family Review, 5 (1), 40-48.
Kovach, M., Ritenburg, H., Young Leon, A.E., Linds, W., Nadeau, D.M., Goulet, L.M., & Marshall, M. (2014). “Embodying Decolonization. Methodologies and Indigenization.” Alternative, 10 (1), 67-78.
Kovach, M. (2016). Indigenous Research and Methodology, présenté à Montréal, QC : Concordia University et University of Saskatchewan.
Kreps, C. F. (2003). Liberating Culture: Cross-Cultural Perspectives on Museums, Curation, and Heritage Preservation. London: Routledge.
Labrosse, M., reporter (30 juillet 2018). « L’exposition Nomades ou itinérants, peuples en danger : entrevue avec André Michel » [émission de radio]. Dans M.-O. Marcoux-Fortier, réalisatrice, Le 15-18. Montréal, QC : Radio-Canada Première.
LaDuke, W. (1999). All Our Relations: Native Struggles for Land and Life. Boston, MA: South End Press.
La Maison amérindienne (2012). La Maison amérindienne. Repéré à https://www.maisonamerindienne.com/index.php
La Maison amérindienne (2013). Lettre ouverte. Le gouvernement Harper, un pas en avant, deux pas en arrière… Mont-Saint-Hilaire, QC : Conseil d’administration de La Maison amérindienne.
Lepage, P. (2009). Mythes et Réalités sur les peuples autochtones (2e éd.). Québec, QC : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Leroux, D. (2018). “Self-made Metis.” Maisonneuve. A Quarterly of arts, opinion & ideas, 69. Repéré à https://maisonneuve.org/article/2018/11/1/self-made-metis/ ?fbclid=IwAR0ytT6PNZPsDWv9m1Sue3YaiAJt-T0M54X9MgjZz846nvcIxnruAEzTH4E
Lonetree, A., et Cobb, A.J., dir. (2008). The National Museum of the American Indian: Critical Conversations. Lincoln: University of Nebraska Press.
Lonetree, A. (2012). Decolonizing Museums: Representing Native America in National and Tribal Museums. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press.
Mathieu, J. (1987). « L’objet et ses contextes. » Bulletin d’histoire de la culture matérielle, 26, 7-17.
.Michaud-Ouellet, J. A. (2014). « Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan Nord, sous la dir. d’Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin Papillon. » Politique et Sociétés, 33 (2), 116-118.
Miguet, D. (1998). « Autour de la sensorialité dans les musées. » Publics et Musées, 13(1), 177-182.
Moreton-Robinson, A. (2004). “Whiteness, Epistemology and Indigenous Representation.” Whitening Race: Essays in Social and Cultural Criticism, 1, 75-88.
Morgan, G. (1999). Images de l’organisation (2e éd.). Québec, QC : Les Presses de l’Université Laval.
Musée McCord (2013). Porter son identité. La collection Premiers Peuples [exposition permanente]. Montréal, QC : Musée McCord.
Musée de la Civilisation (2013). C’est notre histoire. Premières Nations et Inuits du XXIe siècle [exposition permanente]. Québec, QC : Musée de la Civilisation, la Boîte Rouge Vif.
Nagel, J. (2012). “Sociology of American Indians.” Blackwell Encyclopedia of Sociology Online. doi : 10.1111/b.9781405124331.2007.x
Niessen, S.A. (1994). “The Ainu in Mimpaku: A Representation of Japan’s Indigenous People at the National Museum of Ethnology.” Museum Anthropology, 18 (3), 18-25.
Niessen, S.A. (1996). “Representing the Ainu Reconsidered.” Museum Anthropology, 20 (3), 132-144.
Obomsawin, A., réalisatrice (2006). Waban-aki [Documentaire]. Montréal, QC: Office National du Film.
O’Bomsawin, N. (20 novembre 2015). Tewat’kennisa’ane – Nous nous rencontrons [conférence vidéo]. Les Rencontres Interculturelles Autochtone-Kébékoise. Repérée à https://Internettv.coop/video/Nicole-O039Bomsawin-Tewat039kennisa039ane-Nous-nous-rencontrons-/01bf1281c779d046587d6ef936184df3
Ohtsuka, K. (1996). “Exhibiting Ainu culture at Minpaku: A Reply to Sandra A. Niessen.” Museum Anthropology, 20 (3), 108-119.
Organisation des Nations unies (2007). “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” Organisation des Nations unies. Repéré à http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
Paquin, M., Lemay-Perreault, R., Luckerhoff, J., Velez, M.J., Gauvin, J.-F., Émond, A.-M… Allard, M. (2015). « Vingt ans de recherche en éducation muséale. » Éducation et Francophonie, 43 (1), 1-196.
Peers, L. (2000). “Native Americans in Museums: A Review of the Chase Manhattan Gallery of North America.” Anthropology Today, 16 (6), 8-13.
Péquignot, P. (2015). Formation Éclairage muséal, présenté au Musée des Beaux-arts de Montréal, Montréal QC : Société des Musées Québécois.
Piquemal, N. & Labrèche, Y. (2018). « Transculturalité et enjeux éthiques liés à la diversité culturelle en contexte canadien. » Cahiers franco-canadiens de l’Ouest, 30 (1), 169-191.
Poliquin, C. et Dubuc, Y., réalisateurs (2015). L’empreinte [Documentaire]. Montréal, QC : Isca Productions
Porter, J. (1965). The Vertical Mosaic: An Analysis of Social Class and Power in Canada. Toronto, ON: University of Toronto Press.
Procter, J. (2007). “Encoding/Decoding.” The Blackwell Encyclopedia of Sociology. https://0-doi-org.mercury.concordia.ca/10.1002/9781405165518.wbeose045
Radu, I. (2018). Blurred Boundaries, Feminisms, and Indigenisms: Co-Creating an Indigenous Oral History for Decolonization, présenté à Oral History in Our Challenging Times, Montreal QC: Oral History Association et Centre for Oral History and Digital Storytelling.
Saul, J.R. (2014). The Comeback. Toronto, ON: Viking Press.
Savoie, S. (2003). « Les Abénaquis au Québec : des grands espaces aux luttes actuelles. » Recherches amérindiennes au Québec, 33 (2), p. 3-5.
Screven, C.G. (1992). « Comment motiver les visiteurs à la lecture des étiquettes. » Publics et Musées, 1, 33-55.
Secrétariat aux affaires autochtones (17 janvier 2008). « Ententes conclues. » Secrétariat aux affaires autochtones Québec, repéré le 25 avril 2019 à http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ ententes/ententes_conclues.htm
Secrétariat aux affaires autochtones (3 septembre 2014). « Ententes conclues. » Secrétariat aux affaires autochtones Québec, repéré le 25 avril 2019 à http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/moments-marquants.htm
Shimizu, A. (1996). “Cooperation, not Domination: A Rejoinder to Niessen on the Ainu Exhibition at Minpaku.” Museum Anthropology, 20 (3), 120-131.
Simpson, A. (2014). Mohawk Interruptus: Political Life across the Borders of Settler States. Durham/London: Duke University Press.
Siouï Labelle, R., réalisateur (1998). Kanata : l’héritage des enfants d’Aataentsic. [Documentaire] Montréal, QC : Office National du Film.
Skawennati & Lewis, J.E. (2017). Owerà :ke Non Aié :nahne. Combler les espaces vides. [exposition] Montréal, QC : Galerie Leonard & Bina Ellen/Concordia University.
Smith, L. T. (2012). Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. (2nd ed.) Londres, UK: Zed Books Ltd.
Soulier, V. (2015). « Analyser la reconnaissance du point de vue autochtone dans une exposition muséale. » Éducation et Francophonie, 43 (1), 97-115.
Swidler, A. (2001) “Repertoires, Cultured Capacities and Strategies of Action.” Dans Talk of Love: How Culture Matters (p. 24-40, 71-88). Chicago, IL: Chicago University Press.
Swidler, A. (2002). “Cultural Power and Social Movements.” Dans L. Spillman, dir., Cultural Sociology (p. 269-283). Malden, MA: Blackwell Publishers.
Tanguay, N. (2010). « Réflexion sur l’utilisation de groupes de discussion comme outil de documentation du savoir écologique traditionnel. » VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, doi : 10.4000/vertigo.9836
Task Force on Museums and First Peoples, Assembly of First Nations/Canadian Museums Association. (1992). Turning the Page: Forging New Partnerships between Museums and First Peoples. Ottawa, ON: The Task Force/ Le Groupe de travail.
Tourisme autochtone Québec (2018). « Les traditions au cœur de la modernité. » Origin(e). Le magazine touristique du Québec autochtone, Wendake QC : Tourisme autochtone Québec.
Treuer, A. (2010). Indian Nations of North America. Des Moines, IA: National Geographic Books.
Trimble, C.E., Sommer, B.W. & Quinlan, M.K. (2008). The American Indian Oral History Manual: Making Many Voices Heard. Walnut Creek, CA: Left Coast Press, Inc.,
Trovato, F. et Romaniuk, A., dir. (2014). Aboriginal Populations: Social, Demographic, and Epidemiological Perspectives. Edmonton, AB: The University of Alberta Press.
Truth and Reconciliation Commission of Canada (2015). Truth and Reconciliation Commission of Canada: Calls to Action. Winnipeg, MB: Truth and Reconciliation Commission of Canada.
Upton, J.N., dir. (2012). American Indian Arts and Crafts: The Misrepresentation Problem. New York: Nova Science Publisher’s.
Vaudry, S. (2016). « Un espace de rencontre entre Premiers Peuples et Québécois à Québec. Entretien avec Alexandre Bacon, cofondateur du Cercle Kisis. » Cahiers du CIÉRA, 13, 99-105.
Vernier, M. (2016). « Réappropriation du patrimoine autochtone : défis et nouvelles pratiques muséales et archivistiques. » Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, 11 (2), 1-20.
Vincent, S. (1995). « Les relations entre le Québec et les autochtones : brève analyse d’un récit gouvernemental. » Université McGill. Repéré à https://www.mcgill.ca/qcst/files/qcst/SylvieVincentpdf.pdf
Williams, S.J. (2001). “Introduction: Why Emotions, why now?” Dans Emotion and Social Theory: Corporeal Reflections on the (Ir)rational (p. 1-16), London: Sage.
Wiseman, F. M. (2001). The Voice of the Dawn: An Autohistory of the Abenaki Nation. Lebanon, NH: University Press of New England.
____________________________________________________________________
[1] Adopté le 16 février 2017 par le Groupe directeur sur les directions autochtones à Concordia. Il m’a paru important d’inclure l’énoncé de reconnaissance territoriale car il s’agit, à travers mon parcours, d’un moyen de plus de décoloniser l’univers académique qui officialise le savoir, moyen encouragé à Concordia. Pour davantage de détails sur la formulation de l’énoncé, voir https://www.concordia.ca/about/indigenous/territorial-acknowledgement.html.
[2] Tout au long de ce travail, j’appréhende « interculturel-le » suivant le concept de rencontre interculturelle où il y a différentes manières de voir le monde, l’autre, le territoire, et ainsi de suite, qui entrent en contact, et non selon le modèle de l’interculturalisme en tant que pluralisme intégrateur de l’immigration et impliquant un respect de la diversité et l’échange, élaboré par Bouchard (2014). L’auteur spécifie que ce modèle ne concerne pas les Autochtones, avec qui le gouvernement québécois doit entretenir des relations de nation à nation, et envisage donc le Québec comme état plurinational (p. 17). En outre, le rapport colonial au Canada complexifie la notion interculturelle, par exemple entre une Anishinaabe et une Québécoise, en ce qu’un rapport de pouvoir est déjà présent et influence l’identité des deux personnes avant même la rencontre, en contraste avec cette même Québécoise qui rencontre une Néo-zélandaise, suggérant un rapport spatial et culturel distant ou minimal à prime abord. À noter que ce modèle d’interculturalisme, qui caractérise de façon notable l’organisation de la société québécoise analysée dans ce travail, permet d’afficher publiquement le rapport de pouvoir existant et ses possibles dérapages, donc de rendre explicite cet aspect dans l’espace public. En effet, l’une des critiques du multiculturalisme canadien est précisément de masquer ce pouvoir réel qui offre un discours sur l’absence d’une culture nationale ou majoritaire (p. 170). J’appréhende aussi l’interculturalité selon les réalités (spécifiques à cet hémisphère et à sa transformation) de la transculturalité en tant que résultat du processus d’échanges culturels dit de transculturation (Côté et Benessaieh, 2012). Ces notions reconnaissent les rapports de pouvoir entre cultures, les identités culturelles plurielles, hybrides et en changement constant, et remettent en question les cultures nationales (avec leurs contours territoriaux) en tant qu’entités isolées. [3] Une variante de cette méthode décoloniale est d’également écrire « settler » (colon, immigrant) à côté du nom des auteurs à qui cette réalité s’applique ; je ne souscris pas à cette approche car au même titre que l’identité autochtone ne se limite pas à l’expérience de la colonisation (Alfred et Corntassel, 2005 ; Adese, 2015), l’identité des gens d’origine autre que d’une nation autochtone ne se résume pas qu’à des colonisateurs et des non-Autochtones. Cette décision ne revient pas à invisibiliser le fait que plusieurs voix soient non-autochtones, mais à valoriser les diverses identités des Premiers peuples présentées ici. [4] La légende entourant la transcription des entrevues avec les participant-e-s va comme suit, suivant le guide de James Paul Gee (2011) :Lettres majuscules = propos accentués
… = silence audible entre deux segments de parole
[…] = paroles entre deux segments de parole
Je reconnais que la traduction de l’oral à l’écrit a pour effet de perdre l’intensité, le rythme et le ton que portent la forme orale reproduite ici, autant que possible avec le souci de fidélité à la signification initiale des propos. Dans un souci de clarté pour publication, des modifications ont été réalisées à la demande de membres de l’équipe après transcription. L’apport des membres de l’équipe en entrevue constitue leur propriété individuelle et collective à La Maison amérindienne qui les conserve. Pour demander l’accès aux enregistrements officiels, cela relève de leur compétence. [5] À ce sujet, voir entre autres les articles de Ghislain Picard (26 sept. 2018, « Non, les Autochtones ne sont pas des Amérindiens », Huffpost Québec), Niosi (25 sept. 2018, « Une révision des livres d’histoire qui dépasse le retrait du mot “Amérindien” », Espaces autochtones Radio-Canada) et Cirino-Bélair et Noël (19 novembre 2018, « La révision des manuels d’histoire dérange », Le Devoir) accessibles en ligne. L’ethnonyme a été introduit dans les années 1960 pour être d’usage politiquement correct. [6] Cette méthode incluait la rédaction partielle de cette section sur place, dans le « paysage sensoriel » du musée comme l’appellent Classen et Howes (2006). [7] L’assiette végétarienne comprend davantage de riz « sauvage » et de salade de maïs pour remplacer le poulet à l’érable. L’introduction d’un aliment végétal protéiné inspiré de la cuisine autochtone, par exemple des « bines » au sirop d’érable, pourrait être une source supplémentaire de mise en valeur du fait de cette particularité végétarienne.